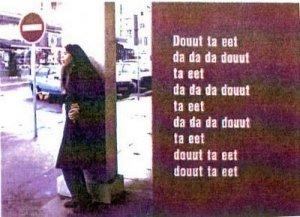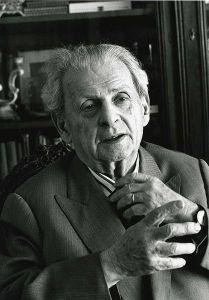« Tu la sens, l’immense tromperie de ta vie ? Tu l’entends, le rire de celui qui te trompe ? ». (Sous le soleil de Satan M. Pialat). Se demander : qui est celui qui trompe ? Est-ce le langage en lui même, ou la perversion de celui ci par les différents médias qu’on utilise pour le diffuser ? Auquel cas les medias pervertissent jusqu’à notre être même ! Est-ce les idées d’égalité, de fraternité, les principes sur lesquels s’appuie notre société ? Sont-ce les sentiments, socles de nos actes, matière aujourd’hui presque obsolète qu’il faut anéantir ? Si nous pouvons nous permettre de parler ainsi directement c’est que nous pensons que les trois œuvres proposent à leur manière des conséquences des tromperies de la communication… Elles mettent toutes trois en évidence l’impossibilité même de l’homme à communiquer avec ses semblables, à se faire entendre d’eux, quelle que soit l’époque et le lieu. Ambiguïté du langage : nous pensons qu’il permet aux hommes de se comprendre, de se voir, de se reconnaître chacun dans les autres comme une portée éthique et nous voyons à nos dépend que cela ne suffit pas, qu’il n’est parfois qu’un crie vide et sans fin. En même temps il est la seule expression possible du trop plein de vie, du débordement des sentiments qui nous envahissent si facilement. Que cherchent donc à exprimer ces trois œuvres ? Peut on parler d’un échec réel de la communication en les voyant, ou restera t il comme un espoir résiduel au terme de l’étude ? La non communication est elle une solution raisonnable ? Dans un premier temps nous analyserons donc les trois œuvres séparément afin en extraire la singularité de leur discours pour dans un deuxième les recoupés et voir les idées directrices ou antinomiques qui s’en dégagent.

La liseuse à la fenêtre est un tableau de Vermeer qui date de vers 1657. Les teintes de jaunes prédominent et font ressortir de manière délicate le rouge du rideau et ce qui semble être une nappe. Notre regard s’étend du visage de la jeune fille à la lettre, de la lettre à la fenêtre ouverte, se prolonge et s’attarde sur le plat dont les fruits s’échappent pour s’arrêter presque interdit sur la tringle et le rideau. La tension dramatique augmente au rythme de notre regard ; « quelles est cette lettre ? Pourquoi le plat a t il été renversé ? pourquoi le peintre a t il voulu ne mettre dans une position de voyeur indiscret ? » . Il y a quelque chose comme une confidence de la part de Vermeer, il nous projette dans la même situation de stupeur que si nous surprenions un ami, lisant comme paralysé une lettre juste ouverte. Le caractère tragique de la nouvelle qu’elle contient nous est quand à lui suggéré par le plateau de fruit que l’on a abandonné négligemment. La lettre intervient ici comme une rupture dans le quotidien, quelque chose s’est passé, qui nécessite que l’on s’arrête, que l’on respire un peu d’air frai, que l’on se laisse le temps d’appréhender la nouvelle. Les mots on créés une émotion trop forte pour nous, ils ont terrassé notre capacité à agir. La lumière dégage un sentiment d’intériorité, de solitude avec soi-même. Elle lit, quelqu’un semble lui avoir écrit (en partant de l’hypothèse qu’il s’agisse bien d’une lettre) et pourtant elle est seule. Elle doit négocier seule avec les événement, avec toutes les questions qui entourent le récit. Le reflet de son visage dans le carreau de la fenêtre accentue encore cette solitude. Comme une vision de l’âme perdu et désemparée. Le langage, la lettre est dans ce tableau le véhicule d’une émotion, elle donne à voir quelque chose de surprenant à la liseuse qui la stoppe dans le mouvement de sa journée.

L’installation d’Ange Leccia intitulée Conversation nous plonge dans une ambiance particulière. La encore nous semblons partager l’intimité d’une pièce, la encore nous sommes un peu comme des voyeurs qui observeraient l’attitude de deux personnes en train de se parler (ou pas d’ailleurs, de simplement se regarder, s’observer). Les fauteuils sont installés en vis à vis tout comme les projecteurs. l’ombre ainsi obtenu forme l’image de deux personnes installés. Elles sont l’une en face de l’autre et en même temps par ce jeu de face à face semblent se tourner le dos, comme après un affrontement, ou à cause d’une lassitude, elles ont l’attitude enfantine de celui qui boude. On peu y voir comme une référence à l’allégorie de la caverne (La République) de Platon, les projecteur envoient une image qui trompe nos sens, seulement ici contrairement à la caverne les projecteurs sont visibles comme pour nous dire : « regardez je vous trompe, je vous montre que je vous trompe et en plus vous êtes heureux d’être trompés, car ces images éveillent votre imagination, qu’elles vous mettent en face de vous-même, de votre propre solitude ». Le titre : conversation est en lui-même assez étonnant. Il n’y a pas de mots, pas de son, l’être (si l’on peu parler d’être) des deux ombres se heurte au mur et à l’affrontement des deux sources de lumières. Il y a comme une impossibilité essentielles de la communication qui se heurte à l’autre, fatalisme profond qui dis que rien de ce que nous ne pouvons dire ne peu changer les choses. Non mouvement des objets, pas d’actes, le mot est comme stérile, le mot n’est pas. Si l’on devait imaginer la conversation de ces deux personnages qui se tournent le dos, elle pourrait se ramener à des choses utilitaires, à des étiquettes du quotidien : « passe moi la télécommande, qu’est ce qu’on mange ce soir ». L’ombre est comme l’aboutissement de la non pensée, de la non création. Les deux personnages attendent que les images leur arrivent toutes prêtes, toutes mâchées sans efforts. Ils sont tels des oies qu’on gave, la sobriété de l’installation, l’enfermement capitonné qu’elle sous entend évoque une image de l’enfer vivant, de la monotonie du quotidien devenu prison. Les deux attributs de l’être selon Spinoza (étendu/corps et esprit) sont ici niés, l’homme n’est plus homme, incapable qu’il est à présent de supporter le poids que suppose cet honneur. La communication rompue, impossible engendre ici la mort de ce qui fait que l’homme est homme.
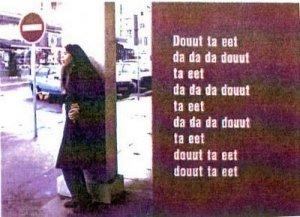
L’œuvre Douut ta eet de Ken LUM pose quand à elle d’emblée plusieurs question. D’abord le format photo / texte, nous donne l’illusion d’une publicité jusqu’à ce qu’on se rende compte que les mots n’ont aucun sens. Les caractères blanc sur fond rouge évoquent comme une mise en garde (rappelée dans la photographie par le sens interdit), un danger. Mise à l’épreuve donc du langage publicitaire, de la réalité même de la publicité. La jeune fille est appuyée à un poteau elle semble chanter et claquer des doigts. Personne ne l’écoute, elle est seule sur un cadrage serré. On ne sait d’ailleurs si les mots sont les paroles de la chanson, ou une sorte de discours sur la jeune fille, tout est faussé, brouillé, mélangé. Discours sur elle comme pour dire que l’être humain n’a plus de sens ni de place, que l’être humain par la multiplicité des moyens de communication mis à sa disposition traverse une crise. Une crise c’est a dire un effondrement des fondements. Husserl parle par exemple d’une crise des sciences lorsqu’il s’aperçoit que la physique moderne ne repose plus sur aucun principe philosophique (La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale E. Husserl, TEL Gallimard). Qu’est ce que l’homme, quelle éthique de l’homme après la atrocité du XXe siecle. crise que l’artiste ici choisi de porter par l’absurde, comme l’aurait fait un Beckett dans Le dépeupleur. On y retrouve les même thème d’ailleurs, l’humain contraint de s’appuyer sur un mur, dans un espace confiné, on dénombre on fait l’inventaire. Seule quelques échelles qui ne mènent à rien sont sources d’espoir, d’un espoir mort puisqu’elles ne mènent à rien, qu’elles ne donnent sur rien comme les paroles sans sens que l’on retrouve dans notre œuvre. L’alerte est donnée, et la question de l’identité, de l’individualité sont plus que jamais sources des questionnements, sur nous même.
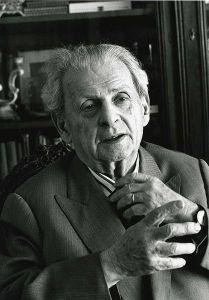
Ces craintes, ces incertitudes, cette fragilité de l’être meurtrie semble être au cœur du cinéma de
Maurice Pialat. Nous le citions en introduction, ce réalisateur qui restera comme l’un des plus controversé du XXe siècle n’a eu de cesse d’essayer de comprendre le devenir de l’homme, en allant au plus près de sa fragilité. Dés son premier court métrage, l’amour existe, il s’interroge : « mourir pour la patrie, un jour de gloire pour cent an de vie » ; « Enfant doué, que l’adolescence trouve cloué et morne, définitivement, il n’a pas fait bon resté là, emprisonné ». Il s’agira pour lui dans l’ensemble de son œuvre de retrouver la fragilité première sur quoi repose toute l’identité des individus. Pour ça aussi qu’il n’a pas toujours besoin de filmer des acteurs professionnels, dans l’enfance nue, une vieille dame, la « mémère » raconte sa vie, ce qu’elle raconte devant la caméra, même si elle est un peu actrice, c’est sa vie de femme, réelle, existante, ce que Pialat cherche à filmer, c’est cette vérité là, décharnée, il veut reconnaître l’être dans sa souffrance, dans sa vie, essayer de percer le noyau de sa fragilité. Le fondement dont nous parlions tout à l’heur y réside peut être, ce qui constitue l’être ce n’est pas ce qu’il consomme, ce n’est pas les images qu’on lui montre, ce n’est pas ce qu’il veut bien dire de lui. C’est quelque chose de résiduel, qu’on aperçoit comme ça de temps en temps dans une interstice, en par delà le discours une fragilité, Levinas dira une « vulnérabilité ». Il n’y a pas de tromperie chez Pialat, comme il peut y en avoir dans tout ce que l’on nous donne à voir. Warhol disait qu’un jour chacun de nous aurait son heure de gloire. Il n’allait pas plus loin, ne se demandait ce que serait cette gloire. Ken LUM nous montre une gloire absurde, confiné à un petit « Je » suis tourne sur lui même, sans impacte, sans conséquences. On dira que ce n’est pas grave alors, puisque c’est sans conséquences… Nous on se demandera aussi ce que c’est, le temps perdu à brasser du vent, toute l’énergie morte qui aurait pu servir à bien autre chose.
Etonnant aussi, dans ces trois œuvres, ou se trouve le visage ? La liseuse est de profil et malgré le fait que son visage soi inondé de lumière, son reflet est trouble et l’on ne distingue pas bien son expression. Chez Ken LUM nous serions bien en peine de dire ce qui signifie également l’expression de la jeune fille ? est ce qu’elle chante ? Est ce qu’elle prend du plaisir ? Est-ce qu’elle siffle ? Visages inexistant dans l’installation de Ange Leccia. Nous sommes dans une position de voyeurs meurtriers. Car il s’agit bien de ça, dans les trois œuvres nous sommes des intrus, cachés derrière un rideau, observant les ombres dans une maison faiblement éclairée, cachés par un mur rouge avec des inscriptions nous observons un jeune femme… Les visages nous sont refusés, nous sommes mis en fasse de notre propre capacité à faire le mal. Car comme dit Levinas c’est : « le visage (qui) me parle et par là m’invite à une relation sans commune mesure avec un pouvoir qui s’exerce, fût il jouissance ou connaissance. [...] L’épiphanie du visage suscite cette possibilité de mesurer l’infinie de la tentation du meurtre, non pas seulement comme une tentation de destruction totale, mais comme impossibilité – purement éthique – de cette tentation et tentative ». (Totalité et infinie, E. Levinas, Livre de poche). Ne pas entrer en contacte, entériner la solitude de l’autre, c’est donc presque comme une mise à mort. Préférer regarder des images préfabriquées à un spectacle de rue, une forme de crime. Cet ensemble d’œuvre hétérogènes forme dans notre esprit comme un grand crie, un appel au secoure, une mise en garde : « si vous persistez à ne pas vouloir reconnaître en l’autre un semblable alors vous êtes un meurtrier en puissance, à jamais incapables de vous élever devant les horreurs qui pourraient se passer sous vos yeux ».
En conclusion, y a t il vraiment ce qu’on peut appeler une tromperie du langage ? La tromperie, l’éloignement de la réalité réside dans les images elles mêmes manipulées, la publicité, la télévision, les agencements, l’art lui même parfois. Tout ceci éloigne de la vérité. Ce qu’il faut retrouver, c’est presque une sorte d’expression plus primitive, et c’est presque ce qu’on peut reprocher à ces trois œuvres, leur manque de rapport directe à l’être, comme si en tant qu’images manipulées elles s’éloignaient elles mêmes de ce qu’elles voulaient dénoncer. Cette crudité de la vérité, il faut la chercher coûte que coûte, au prix même de sa propre vie, comme l’abbé Donissan, dans Sous le soleil de Satan qui s’épuise dans sa quête de sens, qui va jusqu’à dire qu’il sacrifierait sa rédemption contre un peu de sens sur cette terre. C’est un épuisement, mais un épuisement nécessaire peut être, à la sauvegarde du sens, de la vérité, d’un certain type de rapport à l’autre, sans médiation, pure parce que directe.