


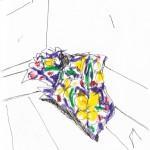
Untitled, 1975-76
Il n’y aura jamais assez de miroirs pour me refléter. J’aurais beau multiplier les effets, les projections et contre projections, ça ne marchera jamais. Je ne parviendrai jamais à me saisir. A me fixer. Si ce n’est l’image d’un chaos et d’une étagère mal rangée. Des bouts d’essais ratés. Des portes fermées. Aller voir ailleurs si j’y suis. Et si j’y suis, je n’y suis pour personne. Ma solitude me manque. Il y a trop de monde autour de moi. Trop dans la maison. Ma grand-mère ne cesse de déglutir, sa bave dégouline et se répand sur notre plancher. Je suis la descendante de cette femme gluante. Le dernier rejeton, le dernier ver de terre de la famille. Qui rampe, qui s’entortille, qui aimerait peut-être se faire une place dans ce monde, mais laquelle ? Il y a trop de monde ici, trop de monde en moi. Je voudrais m’enfermer dans une chambre noire pour y développer la lumière et ne plus jamais en sortir. Je suis noire de monde, évacuez-moi. S’il vous plait, que quelqu’un m’évacue. S’il vous plait, y aurait-il quelque part, quelqu’un pour me sortir de là ? De moi ? A l’aide, au secours. « Au secours ! »
Petite, ma mère me l’a interdit de le dire ce mot.
- C’est mal, à ne prononcer qu’en cas d’extrême urgence, tu comprends.
- Sinon ?
- Sinon quoi ? Eh bien, comme le loup qui hurle au feu dans la bergerie tous les soirs alors qu’il n’y en a pas, de feu, à la fin plus personne ne te croit. Et le jour où le feu survient, tu as beau crier, tu hurles en vain et tu brûles sur place.
L’histoire était terrifiante, elle était surtout absurde. Ca ne tenait pas debout. Ma mère a toujours confondu les histoires. Pourquoi le loup crierait-il au feu dans la bergerie puisque c’est lui le feu qui la menace ? Le coupable et non la victime. C’est à ne rien comprendre. Si je commets un meurtre et le crie à tue-tête, alors personne ne me croira ? Si je le tais par contre, je serai puni ? Ne pas crier à l’aide, c’est s’auto consumer dans ses propres flammes. La dyslexie de ma mère a quelque peu perturbé ma morale.
Untitled, 1975-76_Mamie
J’aurais beau crier, plus personne ne m’entend. Je suis enfermée dans une grande pièce vide aux murs délavés et aux portes fermées. J’oscille sur mon rocking chair pour me souvenir de mouvement. Avancer, qu’est-ce que c’était déjà ? Mettre une jambe devant l’autre, perdre à chaque instant son équilibre pour immédiatement le retrouver. Accepter la perte, la chute, l’oubli pour aller de l’avant. Oser. Bouger. Etre une femme. Tout cela, c’est du passé. Désormais, je ne suis que répétition. Sur place. Je tangue perpétuellement au gré de cette douce berceuse qui m’endort et me réveille, et m’assoupit encore…
Ils s’agitent tous autour de moi. Ils me fuient. A peine sont-ils entrés dans la pièce où je vis, ils ne pensent qu’à une chose : en sortir. L’odeur peut-être. Acre. J’ai toujours l’impression de sentir la pisse, la sueur qui a mal tourné et la naphtaline. Mon nez a toujours été mon sens prioritaire, celui qui me guidait. Au début, ma propre émanation était un véritable supplice. Alors que je pouvais encore parler, je leur suppliais de m’asperger de parfum. Pas un de ces parfums bon marché, pas un parfum de camelote, non, un parfum français, de luxe, lourd et capiteux. L’heure bleue, il avait pour nom. L’heure de la nuit, celle où j’étais entrée, dans mon crépuscule. Je me blottissais contre sa carapace et je respirais à travers ce mince filet l’air.
A chaque fois que ma belle-fille entrait dans la pièce, elle grimaçait. « Mamie, c’est irrespirable ici ! Ouvrez donc les fenêtres, voyons ! » Cruelle, comme si elle ne savait pas que je ne pouvais me lever pour ouvrir les fenêtres sans risquer la chute et le ridicule. L’hôpital. Sa grimace s’allongeait et, à travers la pénombre, je voyais nettement sa pensée se dessiner. Elle frissonnait comme si elle avait mis pied dans un salon funéraire d’un mort un peu trop populaire qu’on aurait submergé de bouquets et qu’on aurait oublié là quelques jours parce que quelque chose de plus urgent tout à coup avait fait reculer l’heure de sa mise en tombeau – une fusillade en ville ou l’assassinat du président que sais-je- et pendant cette absence des vivants, les fleurs se seraient flétries au même rythme lent du cadavre gisant et leur fragrance mêlée aurait eu le goût non pas rassurant du sang mais celui de la terre, du végétal et du fumier. En guise de réponse, je lui rappelais ma volonté de ne recevoir que des lys blancs lors de mes funérailles. Elle ouvrait la fenêtre et pestiférait entre ses dents que non, cela n’était pas possible, elle me l’avait dit cent fois, les lys blancs, c’étaient réservés aux jeunes filles. Ca n’aurait tenu qu’à elle, elle m’aurait couverte de ronces.
Et puis, un jour, ils ne m’ont plus acheté de nouveau flacon. « Désolée, mamie, nous n’avons plus assez d’argent, nous ne pouvons nous le permettre. » C’était ce seul luxe qui me retenait à la vie. Alors je me suis murée dans le silence et la haine. L’heure noire a commencé. Je leur ai fait payer.
Les meubles disparaissaient autour de moi. La nourriture était toujours la même. Des patates. Toujours des patates, jour après jour. Cela m’était bien égal. Francesca déambulait dans des robes trop courtes. Quant à son frère Vince, il portait immanquablement le même jean depuis des années. Ils ne m’avaient pas menti. C’était bien la dèche. Je leur en voulais. Parce que je ne pouvais rien pour eux, que je leur devais tout, que j’étais leur poids et qu’ils auraient aimé me dézinguer aussi facilement que le mobilier de la maison qu’ils vendaient au fur et à mesure pour pouvoir subvenir à nos moyens. Je leur en voulais de mon impuissance.
Je suis rentrée en moi. J’ai descendu mon ascenseur intérieur et j’ai retrouvé la jeune fille que j’avais été. Aux robes bouffantes et au visage joufflu. La jeune fille qui méritait des lys blancs pour son enterrement. La jeune fille déambulait avec moi dans l’espace aux deux portes fermées. Je marchais dans ma pièce délabrée. D’un mouvement de bras graciles, je mesurais l’air et le peu qui me restait à vivre. Et que je consumerais jusqu’au bout. Sans espoir et avec obstination.
Sloan, 1976
Le clitoris, c’est un bouton blanc que tu agites dans le noir et ensuite tout devient bon. C’est une petite lune qu’il faut saisir sur le mur froid de la nuit. L’embrasser, l’entourer et le caresser. Dehors, la neige peut se répandre à nos pieds, la végétation mourir. S’il reste la lune, tout est sauvé. Le mur peut être fissuré, les maisons aux alentours délabrées, s’il reste la lune, rien n’est perdu. Tu peux même courir dans la rue, traverser le passage clouté blanc sans prendre une balle. Tu sauras en vie. Son rayon de lumière te protège, ne l’oublie pas. La lune. Le blanc. Le petit point. La lumière. La réminiscence de la joie. Ne l’oublie pas.
Untitled, 1975-76_Mamie
Les échelles se sont mêlées, les horloges se sont déformées. Je suis entrée dans un tableau de Dali. La jeune fille s’est enfuie, loin de moi, tout au fond de la lumière. Un nouveau mot est apparu dans mon entourage. Ils le murmuraient tout bas, loin de moi, quand le médecin venait à passer : « Parkinson ». Et ce nom, tout beau, tout frais, était immanquablement accompagné de l’adjectif « incurable ». Puis, cette inflexion de voix pour dire : « je suis désolé. »
J’avais de plus en plus souvent des crises qui m’épuisaient. Je mettais toutes mes forces pour les contrer. Résister à ce bras qui ne cesse de se lever, sortir de l’obsession d’une combinaison de mots, empêcher mes yeux de dériver, cesser d’osciller, ne pas baver. Au début, je m’en rendais compte et de plus en plus de moins en moins. Je suis devenue le rocking chair. Une machine à répétition. Ce qui me paraissait normal, ce qui se passait dans mon corps, ne l’était plus aux yeux des autres. La jeune fille courait au fond de la pièce. C’était Alice au pays des merveilles qui poursuivait un lapin toujours en retard. Parfois je me trompais et je devenais immense, immense, ma tête sortait par la cheminée. Parfois je me rapetissais, rapetissais, au point de disparaître dans le trou d’évacuation du lavabo. Cette jeune fille à la taille changeante et mal ajustée, c’était moi.
Quelle trappe avais-je donc ouvert malgré moi et qui s’était méchamment reclaquée sur moi ? L’ascenseur que j’avais pris avait cassé, ses fils ne l’avaient plus retenu et il avait échoué dans les bas-fonds de mon enfance. J’appuyais sur tous les boutons, en vain. Il n’en faisait qu’à sa tête. J’étais définitivement prisonnière des contes des fées que ma mère me racontait. Il n’y avait désormais plus d’heure bleue dans laquelle se glisser pour disparaître. Même pas une corde ou une échelle de pompier que j’aurais pu attraper, grimper pour m’échapper.
Des voix me happaient, me martyrisaient. Elles me criaient : « Anne ! Anne ! » mais j’entendais les fous rires de mes camarades d’autrefois qui s’amusaient de mon nom et me traitaient d’âne, « espèce d’âne, hihan, hihan ! ». Tel Pinocchio, j’étais rabaissée à ma condition d’animal. Sans toutefois la dignité des quadripèdes. Non, j’étais déchue dans un fauteuil, des roues à la place des jambes et un cerveau dont j’avais perdu les rênes.
Moi aussi, j’aurais voulu mitrailler le monde de photos pour me rappeler le sens des réalités et garder en mémoire la taille des choses et des êtres. Vérifier sur la pellicule ce qui est fixé et vrai, et ce qui ne l’était pas. La jeune fille n’aurait pu apparaître sur les photos. Elle n’existait pas, n’est-ce pas ?
Untitled, 1976
Je m’abaisse, je me courbe. Tu me prends. Par derrière. Je me confonds avec les murs de la maison qui ne parlent pas. Je suis confondue. Il me faudra à l’avenir un papier peint pour me couvrir. Pour me cacher. Ne restent plus que mes jambes et mes bras de mobiles. Moi, je suis partie ailleurs. Tu m’as prise. Tu m’as aspirée. Je suis au pied du mur, je ne sais plus comment faire pour avancer. Il y a le mouvement encore, le désir de mouvement. De se mouvoir, de changer, de grandir. Comme autrefois. Je ne resterai pas dans cet éternel corps d’enfant. Est-ce cela être adulte ? Rester fixée avec un corps une fois pour toute. Ne plus se réveiller, en se disant rassurée, demain, mon corps sera autre. Désormais, les seins restent à leur place, les jambes gardent la même longueur, la tête n’oscille plus. Il va falloir s’habituer à cet ensemble, tout doucement, car sa dégradation sera longue et imprescriptible, contrairement à la fulgurante poussée de l’enfance. On ne pourra plus jouer à se cacher, on est là, bien là. Une bonne fois pour toute. Comme les murs d’une maison. Comme un objet défini. Déterminé. Déjà passé.

