
Zap back sur 2012
Pour faire le bilan de la production littéraire de l'année écoulée, d'aucuns établissent des tableaux d'honneur à valeur plus ou moins publicitaire, genre classement sportif. En matière de lecture, le procédé me semble douteux en cela qu'il n'obéit qu'à des critères quantitatifs liés au tirage des livres. À croire que le Top Ten est devenu un genre critique en soi ! Aussi discutable à mes yeux que l'invasion de certaines librairies par de pléthoriques "coups de coeur" où, à grand renfort de formules relevant plus de la pub que du jugement même concis, l'euphorie générale finit par tout diluer.
L'aperçu rétrospectif de mes lectures de 2012 sera tout autre, nullement lié au succès des livres passés en revue - même si le succès d'un bon ouvrage me réjouit naturellement -, ni par quelque influence éditoriale, médiatique ou personnelle que ce soit.
Le premier livre que je présente ici est pourtant bel et bien celui d'un ami, qui m'en a confié le manuscrit au début de l'année et que j'ai accueilli fraîchement, sans la moindre complaisance, tant l'amitié suppose à mes yeux le respect et des virtualités de l'autre, avant de le voir retravaillé en beauté.
 Max Lobe, 39, rue de Berne. Zoé, 2013, 180p.
Max Lobe, 39, rue de Berne. Zoé, 2013, 180p.
Dès la lecture de L'Enfant du miracle (à l'édition des Sauvages, 2010), premier récit de ce jeune écrivain camerounais établi à Genève, l'évidence d'un conteur de talent m'a saisi. Vivacité du regard et de l'expression, fusion d'une double source d'observation où contrastent l'Afrique truculente et la Suisse policée, thème immédiatement filé de la double différence raciale et sexuelle, qualité théâtrale des dialogues: tout cela révélait un auteur singulier, plein de vie et de malice, hélas desservi par une édition calamiteuse.
Grâces soient alors rendues à Caroline Coutau et Nadine Tremblay, chez Zoé, qui ont immédiatement repéré les qualités d'un nouveau manuscrit encore chancelant et ont aidé l'auteur a parachever ce premier roman drôle et poignant à la fois, pétri de vie vraie et ressaisi par une langue originale, aux africanismes parfaitement intégrés. Il y a du drame de moeurs dans 39,rue de Berne puisque Dipita, le jeune protagoniste homo dont la mère tapine avec les filles des Pâquis (réunies en association sous le sigle AFP), raconte ses tribulations de sa cellule de Champ-Dollon, après avoir tué par accident le bel et infidèle William rencontré sur la Toile. Substantiellement nourri par le vécu africain de Dipita (avec un aperçu corsé de la politique camerounaise), autant que par son observation du quartier chaud (avec ses dealers, ses courtisanes et autres marginaux), le roman évite le "folklore" de ces deux milieux autant que le "message" social ou moral, sans rien de cynique pour autant. Mélange de force vitale et de fragilité psychologique et affective, de gaieté et de tristesse sous-jacente, le roman, truffé de scènes piquantes, vaut aussi par la frise de ses personnages, de laquelle se détachent notamment l'oncle Demoney, très monté contre le Président Bya, et la mère de Dipita "vendue" par son frère. Les virtualités théâtrales de l'ouvrage lui vaudront une adaptation prochaine. Déjà disponible sur Amazon, il se trouvera en librairie dès ces prochains jours. Gérard Joulié, La Forêt du mal. Essai sur Racine, Baudelaire et Proust. L'Age d'Homme, 2012.
Gérard Joulié, La Forêt du mal. Essai sur Racine, Baudelaire et Proust. L'Age d'Homme, 2012.
C'est un livre bonnement extraordinaire, au sens littéral, que ce triple essai critique divagant, ne visant probablement que douze lecteurs, au plus: douze cents. L'auteur lui-même est un personnage hors norme, résolument anachronique. Français établi à Lausanne au mitan des années soixante, Gérard Joulié, avec sa dégaine de dandy dilettante se réclamant de l'Ancien Régime et de la contre-Réforme en religion, professant les idées les plus réactionnaires avec une candeur désarmante, n'est jamais vraiment sorti du monde enchanté de son enfance marquée par la lecture des contes de Perrault. Sa vision du monde en procède immédiatement, avec une passion pour tout ce qui relève de l'imagination créatrice, contre tout ce qui ressortit à ce qu'on tient pour la réalité réelle. Pour lui, le vrai monde est celui de la littérature. L'actualité? Foutaise et diablerie !
Grand lecteur devant l'Eternel, c'est également un traducteur de l'anglais prolifique, dont L'Age d'Homme a publié une quantité d'ouvrages de Chesterton ou de la romancière Ivy Compton-Burnett (formidable narratrice en dialogues annonçant les romans de Sarraute), de l'extravagant humoriste Saki ou des oeuvres de l'exquis Ronald Firbank, en passant par Gore Vidal et John Cowper Powys, entre beaucoup d'autres. Sous le pseudonyme de Sylvoisal (qui associe les termes emblématiques de Lys et Valois...), Gérard Joulié a publié des récits et des poèmes, mais ce triptyque ne se borne pas à commenter trois grandes oeuvres françaises: il fait en effet figure de testament critique et spirituel, voire d'autoportrait.
"La littérature ne sauve pas le monde", écrit Gérard Joulié, "elle nous sauve du monde tel qu'il est: un cloaque d'infamie". Nul angélisme pour autant dans sa vision. Ceux qui prônent l'établissement du Bien (philosophes, intellectuels, journalistes, politiciens) ne l'intéressent absolument pas, mais ce n'est pas par esthétisme désincarné. "Littérairement, seuls les tyrans domestiques, les monstres comme Vautrin, ou des hommes très bons victimes de leurs passions, comme le baron Hulot, présentent de l'intérêt".
Pour Gérard Joulié, il y a deux camps: celui du présumé Bien, de la démocratie établie en valeur absolue et du politiquement correct, et le camp du Mal où les pécheurs pèchent entre Barbe Bleue et les personnages de Dostoïevski, les héroïnes déchirées de Racine et les débauchés snobs de Proust, ce "possédé" qu'était l'apôtre Paul lui-même et tous les "fous" terriblement attachants de la littérature de partout et de toujours.
Pour réductrice qu'elle paraisse, cette vision manichéenne de western spirituel (les mauvais Bons d'un côté, les aimables Méchants de l'autre) offre du moins un cadre dramaturgique à la lecture de Joulié, qui a probablement beaucoup joué aux soldats de plomb en son enfance aussi protégée que celle du petit Marcel.
Racine identifié à la pensée de Port-Royal, Baudelaire à la fascination pour la débauche retournée par la poésie, Proust l'athée faisant du temps retrouvé une métaphore de la résurrection: tels sont les motifs majeurs autour desquels le critique développe une réflexion répondant une fois de plus à la question de Charles Du Bos: qu'est-ce que la littérature ?
Si Gérard Joulié n'était qu'un pion assenant ses arguments si contraires à l'air du temps qu'ils ont de quoi séduire ceux qu'on appelle les "nouveaux réactionnaires", je le laisserais pour ma part à son discours tellement français, par ailleurs, en son outrance binaire. Mais il y a bien plus chez lui, qui découle de sa vraie passion pour la littérature, par delà son idéologie de mousquetaire énervé. Il y a un lecteur merveilleusement cultivé, poreux et profond en ses intuitions, que sert une langue évoquant la plus belle conversation, sans faux brillant. On s'en agacera plus souvent qu'à son tour, tant le fieffé réac en remet, mais son livre n'en est pas moins un trésor de sensibilité et d'intelligence dont la compagnie est mille fois plus tonique que celle de fades humanistes des temps qui courent. 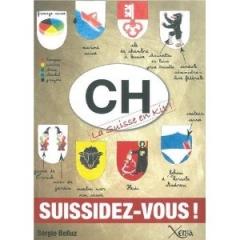 Sergio Belluz. CH, La Suisse en kit. Xénia.
Sergio Belluz. CH, La Suisse en kit. Xénia.
Les livres consacrés à la Suisse se reproduisent avec plus d'alacrité que les nains de jardins, et certains se vendent même comme des petits pains. Il faut dire que rien ne passionne autant les Suisses que leur drôle de pays, mais gare à qui oserait le critiquer hors de ses frontières, de Yann Moix (très piètre détracteur il vrai) à Jean Ziegler, au point que le gris docte domine trop souvent le genre, comme on l'a vu l'an dernier dans La Suisse de l'historien François Walter, joliment illustrée par les iconographes de la collection Découvertes de Gallimard, mais d'une platitude proportionnée à sa prétention convenue de "briser les clichés", et réservant à la culture et aux littératures de notre pays une place minable.
Or La Suisse en kit de Sergio Belluz rompt avec cette grisaille professorale par sa manière à la fois hirsute et substantiellement profuse, son insolence roborative et sa mise en forme originale. Je ne pense pas tant à la couverture de l'ouvrage et à sa typographie, d'un assez mauvais goût aggravé par l'absurde bandeau imprimé sur fond rouge Suissidez-vous !, qu'à la façon modulée par l'auteur dans l'alternance des chapitres descriptifs et des pastiches d'auteurs, avec de belles réussites du côté de ceux-ci, souvent plus faibles il est vrai.
Après un Avant-propos immédiatement caustique dans sa façon de désigner ce "pays orgueilleux qui n'aime pas parler de lui et qui déteste qu'on le fasse à sa place", l'auteur, secundo d'ascendance italienne (de quoi je me mêle !?) brosse un premier aperçu synthétique et pertinent de l'histoire de notre Confédération "pacifique" marquée par d'incessantes guerres picrocholines à motifs essentiellement religieux, avant l'établissement d'un consensus plus pragmatique qu'évangélique.
Suit un Who's who en travelling sur une suite de pipole surtout littéraires, de Rousseau à Milena Moser (star momentanée du roman zurichois qui ne méritait sûrement pas tant d'attention), en passant par une vingtaine d'écrivains et vaines plus ou moins signficatifs (Cendrars, Bouvier, Chessex, Bichsel,Loetscher, Ella Maillart) et par quelques "figures" helvétiques notables, telle l'inoubliable Zouc ou notre benêt cantonal Oin-Oin, la marque ménagère Betty Bossi et le non moins incontournable Godard.
Souvent surprenant dans ses approches (celle de l'immense Gottfried Keller est épatante, autant que son pastiche), Sergio Belluz est inégalement inspiré sur la distance, parfois expéditif dans sa façon d'égratigner un monument ou de singer un style (la présentation de Ramuz est carrément défaillante, autant que le pastiche de Cingria), souvent à la limite de la posture potache.
N'empêche que l'ensemble, complété par un glossaire gloussant autant que bienvenu pour le visiteur nippon ou texan, constitue le kaléidoscope documentaire le plus attrayant, renvoyant en outre, au fil de ses évocations littéraires, à de kyrielles d'autres lectures dans les quatre langues de notre culture. À celles-ci j'ajouterai - oubliée de l'auteur -, celle de la délectable chronique intitulée Ma vie et relatant les tribulations européenne de Thomas Platte, chevrier de montagne en son enfance et devenu, avec des bandes d'enfants cheminant à travers l'Allemagne et la Pologne, un grand humaniste bâlois de la Renaissance, père d'une père de deux autres savants médecins...
Cela pour rappeler avec Sergio Belluz, et sans chauvinisme patriotard d'aucune sorte, la richesse d'une multiculture multilingue souvent ignorée de nos voisins européens, à commencer par les Français. Ainsi La Suisse en kit a-t-elle ce mérite rare, non sans faire souvent sourire et rire, d'illustrer la réalité complexe et contradictoire, d'une espèce de laboratoire européen avant l'heure, dont le dernier paradoxe est qu'on y semble attendre que l'Europe devienne suisse...  Charles Dantzig, À propos des chefs-d'oeuvre. Grasset, 274p.
Charles Dantzig, À propos des chefs-d'oeuvre. Grasset, 274p.
L'art de la conversation à la française n'en finit pas de faire florès ici et là en dépit de la disparition des salons parisiens ou provinciaux. On le retrouve en tout cas bien allant chez quelques auteurs qui donnent le meilleur de leur talent à causer sur le papier comme s'ils étaient en compagnie, et tant mieux pour le lecteur s'il résume celle-ci.
Avec Philippe Sollers, en moins pontifiant et moins puissant, moins profond aussi, Charles Dantzig perpétue ainsi ce grand art de l'entretien avec quelques-uns ou avec soi-même en personne, tel qu'on a pu l'apprécier dans ses deux recueils monumentaux du Dictionnaire égoïste de la littérature française et de l'Encyclopédie capricieuse du tout et du rien.
Le nouvel objet des digressions de Charles Dantizg est le chef-d'oeuvre, sa nature pérenne ou passagère, avérée ou supposée, son évidence ethnocentrique ou sa prévalence universelle présumée (genre chef-d'oeuvre ab-so-lu dans le langage un peu sot des temps qui courent après le "cultissime", de la Recherche du temps perdu à Cent ans de solitude), entre autres critères variables.
"Les digressions, écrit Charles Dantzig, c'est merveilleux quand elles sont bonnes, et quand elles sont bonnes elles ne sont plus digressions. Un chef-d'oeuvre est une digression devenue discours central. IL nous a écartés de l'uniformité".
Cette conclusion relève évidement de l'approximation, comme toute digression relève le plus souvent de l'improvisation. Je revois à l'instant Dominique de Roux, dans son salon de la rue de Bourgogne, avec mon insigne jeune personne pour seul interlocuteur, improvisant magistralement à propos de Céline et de Gombrowicz, de Jouve et d'Alban Berg, de Pound et de la littérature parisienne de l'époque qu'il conchiait dans les grandes largeurs, multipliant formules ciselées et portraits au vitriol, définitions et digressions qu'on retrouve dans L'Ouverture de la chasse et plus encore dans Immédiatement, mais aussi chez Dantzig.
La forme des chefs-d'oeuvre est multiple. Le XIXe siècle en a cristallisé le projet de façon plus consciente et explicite, produisant le chef-d'oeuvre voulu, dont Madame Bovary est le plus bel exemple, rêve accompli du Monumentum.
Mais il y a bien plus de chefs-d'oeuvre "involontaires" et quantité de "petits" chefs-d'oeuvre qui nous sont souvent plus chers, parce que plus intimes, que les "grands". Adolphe de Benjamin Constant en est un exemple, ou le Dominique de Fromentin, ou encore Le chef-d'oeuvre inconnu de Balzac et La mort d'Ivan Illitch de Tolstoï. Et puis il y a les chefs-d'oeuvre constitués par des oeuvres entières, comme le Journal d'Amiel, le Journal littéraire de Paul Léautaud ou les chroniques de Saint-Simon, parangon sommital.
D'aucuns citeront tel ou tel chef d'oeuvre les yeux aux ciel, pour se faire bien voir dans les coquetèles où la seule "référence" vous tient lieu de certificat comme aux bonniches la recommandation d'un patron chic. Mais les références de Dantzig ne sont pas d'un cuistre ni d'un snob, tant ce monstre de lecture est omnivore, libre et anarchisant, amateur éclairé au sens de celui qui aime et sait faire aimer. Le grappillage de cette espèce d'essai-omnibus relève aussi du cabinet de curiosités à l'ancienne, version pré ou postmoderne, avec des raccourcis un peu voyous fleurant la punkitude ou l'aristocratique plaisir de déplaire. Je trouve, pour ma part, assez débile la façon de Dantzig de réduire Voyage au bout de la nuit à un faux chef-'doeuvre "inventé" par les "lecteurs incultes", sur un ton méprisant qu'on retrouve chez un Sollers ou un Nabe. Le tout mariole se la joue liquidateur de l'oeuvre ainsi rabaissée, mais le chef résiste. Il nous arrive à tous d'être un peu cons. À tel l'âge, j'ai mal jugé tel livre, que je redécouvre dix ou vingt ans plus tard. À l'oposé, tel présumé chef-d'oeuvre (je pense à Belle du seigneur d'Albert Cohen) m'a emballé à vingt ans, qui me fait aujourd'hui l'effet (en partie tout au moins) d'une logorrhée flatteuse.
Le grappillage de cette espèce d'essai-omnibus relève aussi du cabinet de curiosités à l'ancienne, version pré ou postmoderne, avec des raccourcis un peu voyous fleurant la punkitude ou l'aristocratique plaisir de déplaire. Je trouve, pour ma part, assez débile la façon de Dantzig de réduire Voyage au bout de la nuit à un faux chef-'doeuvre "inventé" par les "lecteurs incultes", sur un ton méprisant qu'on retrouve chez un Sollers ou un Nabe. Le tout mariole se la joue liquidateur de l'oeuvre ainsi rabaissée, mais le chef résiste. Il nous arrive à tous d'être un peu cons. À tel l'âge, j'ai mal jugé tel livre, que je redécouvre dix ou vingt ans plus tard. À l'oposé, tel présumé chef-d'oeuvre (je pense à Belle du seigneur d'Albert Cohen) m'a emballé à vingt ans, qui me fait aujourd'hui l'effet (en partie tout au moins) d'une logorrhée flatteuse.
Dire de Céline qu'il "permet de lire de l'antisémitisme légal", comme s'y emploie Charles Dantzig, est malhonnête en cela que ni Voyage au bout de la nuit, ni Mort à crédit, ni ces autres merveilles noires que dont Nord, D'un château l'autre ou Féerie pour une autre fois, sans parler de Guignols'Band (que je n'aime pas trop personnellement tant il se dilue dans le jazz verbal) ne sont entachés de l'antisémitisme qui ruisselle en revanche dans les pamphlets et la correspondance de l'énergumène. Passons encor.
Il y a donc à laisser à la lecture d' À propos de chefs-d'oeuvre, mais bien plus à prendre. La conclusion selon laquelle une vie peut être un chef-d'oeuvre m'a d'abord séduit, avant de m'apparaître dans toute sa niaiserie - celle-là que reproche, d'ailleurs, Dantzig à Mario Vargas Llosa quand il dégomme le discours de Stockholm de l'écrivain péruvien en son éloge de la lecture donné avec une belle simplicité augmentée d'un clin d'oeil à sa chère moitié, et qu'il conclut - comme Michel Tournier le fera graver sur sa tombe -, avec ces mots reconnaissants de: merci la vie...
(À suivre...)
Peter Sloterdijk. La Folie de Dieu. Pluriel.
Jörg Wegelin. Jean Ziegler. Favre.
Jacqueline Risset, Puissances du sommeil.Seuil
François Bon. Autobiographie des objets. Seuil.
Daniel Fazan. Millésime. Olivier Morattel.
Pierre Crevoisier. La dame en rouge. Sur manuscrit.
Jean Bofane, Mathématiques congolaises. Actes Sud.
Joël Dicker. La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert. L'Age d'Homme, Bernard de Fallois.
Metin Arditi. Prince d'orchestre. Actes Sud.
Marc Dugain. Avenue des géants. Gallimard.
Jean-Michel Olivier, Après l'orgie. L'Age d'Homme /Bernard de Fallois.
Arno Bertina. Je suis une aventure. Verticales.
Patrick Deville, Peste et choléra. Seuil.
Jean Echenoz, 14.Minuit.
Daniel de Roulet. Fusions. Buchet Chastel.
François Debluë. Portrait d'un homme ordinaire. L'Age d'Homme.
Bona Mangangu. Caravaggio le dernier jour. Sur manuscrit.
Jean Ziegler. Destruction massive. Fayard, 2011.
Jeandaniel Dupuy, Le cabinet de curiosités.
Quentin Mouron, Notre-Dame-de-la merci. Olivier Morattel.
Yasmine Char. Le Palais des autres jours. Gallimard
Henri Roorda, Le roseau pensotant. Mille et une Nuits.
Anne Wiazemsky. Une année studieuse. Gallimard.
Mais encore:
Gargantua de Rabelais; Voyage au bout de la nuit, de Louis-Ferdinand Céline; Les Frères Karamazov, de Fédor Dostoïevski; Notizen de Ludwig Hohl, Typhon, de Joseph Conrad; Paludes, d'André Gide. Au présent d'Annie Dillard. Etc.
