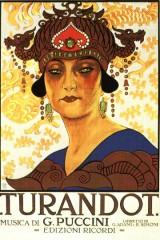
Scala de Milan, 25 avril 1926 : le plus célèbre théâtre lyrique du monde est plein à craquer ; plus une seule place disponible. Tous les admirateurs de Puccini sont là, pour assister à la première mondiale de son dernier opéra, Turandot, qu’il n’a pas eu le temps d’achever avant de mourir à Bruxelles plus d’un an auparavant. Toscanini est au pupitre de l’orchestre ; il a l’air très ému car c’est à lui que Puccini a confié son œuvre afin qu’il la mène à son terme. La représentation commence ; mais, au troisième acte, après la mort de Liu, Toscanini pose sa baguette et se tourne vers le public : « l’œuvre s’arrête ici, dit-il. Le maestro en était là lorsqu’il est mort. » Les lumières se rallument, la salle se vide lentement, sans bruit. Le spectacle est terminé. Ce n’est qu’à la seconde représentation que Turandot fut jouée dans son intégralité, avec l’ultime duo Turandot/Calaf et le final, composés par Franco Alfano à partir des notes laissées par Puccini.
Mais qui est donc cette Turandot dont la cruauté n’est plus à démontrer ? Son nom évoque l’extrême orient, les contes de la Chine antique ; et c’est bien une princesse chinoise, imaginaire, mise en scène par Carlo Gozzi au 18ème siècle et qui connut bien des avatars par la suite. On dénombre plus d’une dizaine de Turandot dans le domaine lyrique, la plus célèbre étant bien sûr celle de Puccini, les autres ayant sombré dans l’oubli. Il faut cependant mentionner la Turandot de Busoni, créée en 1917 à Zürich, car il y a tout lieu de croire qu’elle est à l’origine de l’intérêt que les futurs librettistes de Puccini portèrent soudain à la cruelle princesse de Chine. Sans doute assistèrent-ils à cette représentation, ou peut-être en eurent-ils des échos positifs ; toujours est-il qu’ils rédigèrent à la hâte un livret inspiré de la pièce de Gozzi et le soumirent à Puccini, lequel l’accepta avec joie.
Depuis La Fille du Far-West, le compositeur cherchait un sujet capable de vraiment l’intéresser et l’inspirer. Certes, il avait composé La Rondine, puis les trois opéras du Triptyque mais il était bien conscient que ce n’était pas, dans sa production, des œuvres majeures. Il souhaitait un « grand sujet », capable de rivaliser avec celui de Madame Butterfly. De plus, il avait situé ses précédents ouvrages dans les pays les plus variés : en France avec La Bohème et Manon Lescaut, en Italie avec Tosca, au Japon avec Madame Butterfly, en Amérique avec La Fille du Far-West. Giuseppe Adami et Renato Simoni, les librettistes de Turandot, lui permettaient de « partir » pour la Chine. Ce conte qui opposait cruauté et amour, et dans lequel la quête du nom était si importante (tout le troisième acte lui est consacré) lui semblait être une inépuisable source de possibilités. Et puis, le personnage de Liu, dans sa fragilité, son amour éperdu, rappelait fortement la douce Madame Butterfly. Il se mit donc au travail dans l’allégresse la plus totale.
Mais hélas, il n’avait plus vingt ans… La composition de Turandot accaparait tout son temps mais le travail n’avançait pas vite, car il s’épuisait à corriger sans cesse, reprendre au commencement la moindre scène, raturer, etc. L’inspiration même le fuyait. Diabétique, il était obligé de suivre un régime draconien qui l’empêchait de voyager, alors qu’il était repris par une envie violente de dépaysement. Et puis, il y avait cette petite toux qu’il ne parvenait pas à calmer. Sans être très âgé (65 ans), il n’avait plus la capacité de travail de ses belles années de jeunesse. Retiré dans sa villa de Viareggio, il recevait cependant nombre d’amis avec qui il discutait de musique. Parmi eux, l’ami de toujours, Toscanini. Les deux hommes se disputaient souvent mais s’aimaient beaucoup. Etaient présents également les librettistes, qui veillaient à ce que, malgré les difficultés, le compositeur n’abandonnât pas son œuvre.
Cette toux persistant, Puccini se décide à voir un médecin. Le verdict tombe, terrible : cancer. C’est à son fils qu’on apprend la nouvelle ; au musicien, on ne dit pas vraiment la vérité ; on l’engage cependant fortement à aller à Bruxelles se faire soigner au radium. Turandot n’était pas terminée ; Puccini avait achevé la mort de Liu, il restait le grand duo final à écrire, qu’il voyait comme le sommet de toute l’œuvre. Il donne donc ses dernières instructions à Toscanini ; ses amis l’accompagnent à la gare : savaient-ils qu’ils ne le reverraient pas ? Au moment où le train s’ébranle, Puccini se penche à la fenêtre, interpelle Toscanini « S’il m’arrive quelque chose, n’abandonnez pas ma chère belle princesse, ma Turandot. » (1) En novembre 1924, il subit une opération à la gorge. Mais le radium ne pourra pas le sauver ; le 29 du même mois, il meurt dans les bras de son fils.
Turandot, c’est, dans l’œuvre de Puccini, l’ultime évolution. Nous ne sommes plus dans le cadre intimiste de La Bohème ou de Tosca ; c’est un opéra à grand spectacle, où les chœurs prennent une place de choix et qui réclame de nombreux figurants. Ce drame lyrique exige aussi des interprètes de tout premier ordre, notamment en ce qui concerne le rôle de Turandot, sans doute un des plus difficiles du répertoire –sinon le plus difficile. Nombre de chanteuses ont laissé leur voix dans le « questa regia » du second acte, pour avoir osé aborder trop tôt, ou trop mal, un rôle qui exige à la fois vaillance vocale, endurance, et parfaite technique. Il faut une voix suffisamment puissante pour pouvoir couvrir les fortissimos de l’orchestre ou des chœurs, suffisamment étendue pour passer le nombre impressionnant de notes élevées, notamment à la fin de l’air d’entrée, suffisamment souple pour exprimer la dureté et la cruauté de la princesse puis son désarroi et enfin l’acceptation de sa défaite à la fin de l’opéra. Il exige aussi une très bonne comédienne, capable de montrer l’évolution du personnage qui, tout de glace dans la majeure partie de l’opéra, devient feu dans la dernière scène.
Que dire encore de ce rôle ? Même Callas ne s’y est pas sentie aussi à l’aise que dans Norma ou Tosca, et elle aussi a failli compter parmi les victimes de Turandot. Elle n’a chanté ce rôle sur scène que 24 fois environ, et cela en deux ans ; elle était pleinement consciente des dangers qu’il comportait. « A l’époque où il occupait une place importante dans son répertoire, elle confia à un ami que son seul espoir était de pouvoir mener à bien sa série de représentations et qu’il lui restât encore de la voix pour l’avenir. » (2) En 1948, lors d’une tournée en Italie, on lui fit remarquer que sa voix commençait à fléchir : aigus moins libres, moins stables. Elle eut la sagesse d’abandonner le rôle pour ne le reprendre qu’en enregistrement, partiel en 1954, intégral en 1957. La main vengeresse de Turandot n’avait fait que la frôler ; mais peut-être faut-il chercher chez la Princesse la toute première cause des défaillances vocales qui allaient par la suite mettre fin à la carrière de la Diva. Parmi les grandes Turandot, on peut citer Birgit Nilsson, Joan Sutherland, Montserrat Caballé, Eva Marton, Nancy Tatum… J’en oublie sans doute encore quelques-unes mais la liste n’est pas très longue…
Quant à la musique, elle est extrêmement riche et colorée. Si Puccini emploie des instruments orientaux tels que le gong chinois, les cloches ou le xylophone, c’est par la seule orchestration qu’il parvient à rendre la vraie couleur exotique, ainsi que par des procédés harmoniques. Les grands airs ne sont pas absents (ceux de Liu au 1er et 3ème actes, celui de Turandot au 2ème acte, celui de Calaf au 3ème acte) ; « mais l’œuvre entière semble moins un prétexte à virtuosité qu’une véritable fresque musicale. Toute la scène des énigmes est simple et impressionnante avec son motif trois fois répété, et les voix des huit sages tombant comme un couperet. » (2)
La fin, composée par Alfano, possède une vraie grandeur. Certes, jamais Puccini ne se serait permis les dissonances qu’on peut y trouver, et le duo n’a été composé qu’à partir des esquisses laissées par Puccini ; mais on peut essayer d’imaginer, à partir du travail d’Alfano, ce qu’aurait été ce final grandiose si le musicien avait eu le temps de terminer son opéra.
Turandot, c’est aussi un ouvrage qui peut se lire sur le plan symbolique, voire psychanalytique. Le grand monologue d’entrée de Turandot au second acte, dans lequel elle explique les raisons qui la poussent à agir d’une façon aussi cruelle, pourrait faire les délices d’un psychiatre ; mettre un nom sur le visage du Prince Inconnu est également primordial : Il est nécessaire de connaître « l’identité » de l’ennemi pour pouvoir agir contre lui. Mais, dans ce cas précis, apprendre le nom, c’est faire voler en éclats toutes les barrières psychiques empêchant la naissance et la reconnaissance de l’amour, ce dernier ayant besoin de savoir à qui il s‘adresse pour exister. Enfin, sur le plan dramatique, c’est l’affrontement de deux personnages principaux, de deux volontés, deux caractères. Non, il ne s’agit pas d’opposer Calaf à Turandot : leur confrontation n’a pour but que la réunion ultime ; elle n’a donc que peu d’importance. La vraie opposition, on la trouve entre la Princesse, fille de l’empereur de Chine, cruelle, vindicative et son contraire, la douce et tendre Liu, l’esclave fidèle et courageuse qui, par son sacrifice pour sauver celui qu’elle aime en vain, permettra à Turandot de comprendre l’inutilité de sa vengeance et la part de tendresse que tout être humain porte en lui.
La même année que la création à Milan, le Met de New York reprend l’opéra avec Maria Jeritza dans le rôle-titre. La création française a lieu à Paris en 1928 et l’œuvre va ensuite parcourir le monde entier. A cause des énormes difficultés que présente le rôle de Turandot, l’opéra n’a tout d’abord pas été très souvent joué, mais les productions désormais se succèdent quasiment sans interruption… Tant mieux. C’est une des plus belles œuvres du répertoire lyrique.
Mais attention à la casse, Mesdames les sopranos !...
(1) Cité par Jacques Slyper dans le livret présentation opéra.
(2) Jacques Slyper
ARGUMENT : A Pékin, dans l’Antiquité.
Acte I – La Cité Interdite, au crépuscule. La foule attend le résultat de l’épreuve qu’a dû subir le Prince de Perse, prétendant à la main de la Princesse Turandot, réputée autant pour sa beauté que pour sa cruauté. Un mandarin arrive et annonce que le prince a échoué : il n’a pas su résoudre les trois énigmes que lui a posées Turandot et devra être mis à mort, comme le veut la coutume imposée par la Princesse. Joie de la foule qui échange des grossièretés avec le bourreau et attend impatiemment le lever de la lune qui donnera le signal de l’exécution. Au milieu de la foule, se trouve Timur, roi de Tartarie, aveugle et banni de son pays. Il voyage incognito et est accompagné de sa fidèle esclave Liu. Un jeune homme le reconnait avec joie : il s’agit de Calaf, son fils, dont la vie est en danger car les usurpateurs du trône de Tartarie le tueraient sans hésiter s’ils savaient qu’il est seul et sans défense. Timur raconte comme il s’est enfui grâce à la complicité de Liu.
La foule presse le bourreau d’affûter l’épée rituelle qui va décapiter le Prince de Perse. La lune se lève, le Prince est conduit au supplice. Désarmée par sa jeunesse, la foule demande sa grâce. Calaf maudit Turandot pour sa cruauté. Cette dernière apparaît un moment au balcon et la foule demande à nouveau la grâce du Prince. En vain. D’un geste, Turandot confirme la sentence.
La beauté de la princesse a fait une nouvelle victime : Claf, qui ne pense plus qu’à la conquérir. Son père et Liu le supplient de renoncer, de même que Ping, Pang et Pong, ministres de la maison impériale. Mais la décision du jeune tartare est prise : il donne le signal (trois coups sur le gong) qui annonce l’arrivée d’un nouveau prétendant à la main de Turandot.
Acte II – Premier tableau – Dans un pavillon. Les trois ministres Ping, Pang et Pong se lamentent sur le malheur de la Chine. Ils prétendent que la monarchie est finie ; les têtes tombent comme des pommes trop mûres et personne n’est capable de donner la paix au pays bouleversé. Ils évoquent avec nostalgie leur foyer lointain. Puis, des roulements de tambour annoncent que l’heure de l’épreuve est proche. Une marche majestueuse retentit.
Deuxième tableau – La salle du trône, où l’épreuve des énigmes va se dérouler. L’empereur, entouré de ses sages et des gardes, domine l’assemblée. Calaf est introduit en grande pompe. Turandot arrive enfin. L’empereur, par trois fois, supplie le jeune homme de renoncer à cette épreuve car il est las de toutes ces morts inutiles mais Calaf refuse. Turandot entonne alors son grand air « in questa regia » -qui donne des sueurs froides aux interprètes du rôle- dans lequel elle raconte l’histoire de son aïeule qui, des milliers d’années auparavant, a été trahie par un conquérant étranger qui mit la ville à sac et l’emmena loin en exil où elle mourut de chagrin. C’est pour la venger que Turandot a imaginé cette épreuve. Elle conseille également à Calaf de renoncer et l’avertit : si les énigmes sont trois, la mort est une. Mais Calaf réplique avec assurance. Turandot pose alors les énigmes auxquelles le jeune prince donne les réponses attendues : L’espérance, le sang et… Turandot. Prise de peur et de colère, la princesse supplie son père de ne pas la céder au prince étranger, mais l’empereur ne peut que répondre que la parole est sacrée ; de plus, l’épreuve a été loyalement passée. Calaf, magnanime, propose un marché : que Turandot découvre son nom avant l’aube, et il acceptera de mourir, comme s’il avait échoué.
Acte III – Les jardins du palais. Il fait nuit ; on entend la voix des mandarins : Turandot a ordonné que personne ne dorme à Pékin tant qu’on n’aura pas découvert le nom de l’étranger. Quiconque enfreindra cet ordre sera puni de mort. Calaf a entendu cette proclamation mais reste impassible ; dans une célèbre aria « nessum dorma », il affirme être le seul à pouvoir révéler ce secret et qu’à l’aube, Turandot deviendra sa femme. Ping, Pang et Pong viennent lui offrir tout ce qu’il veut et la liberté en échange de son nom. Calaf ne se laisse émouvoir ni par les promesses, ni par les menaces. Mais les gardes ont arrêté Liu et Timur car on les avait vus parler à Calaf. Turandot arrive, exige que Timur soit torturé. Craignant pour la vie du vieil homme, Liu s’avance courageusement et affirme être la seule à connaître le nom du prince étranger. Mais elle refuse de parler sous la torture, attitude qui surprend Turandot : elle demande à l’esclave ce qui lui donne la force de résister ainsi. Liu répond dans une magnifique aria qu’il s’agit de l’amour. On appelle le bourreau, mais Liu déclare qu’elle ne peut plus en supporter davantage. Elle s’adresse à Turandot dans une seconde aria, toute aussi magnifique que la première, et lui prédit qu’avant l’aube, elle aimera le prince étranger. Quant à elle, elle n’a plus qu’à mourir. Elle se saisit du poignard d’un des gardes et se frappe au cœur. Timur et Calaf se désolent et on emporte le corps. Turandot et Calaf restent face à face. Le jeune homme reproche à la Princesse sa cruauté, puis la saisit dans ses bras et l’embrasse. Sans défense, Turandot abandonne toute idée de vengeance, toute férocité et tout courage. L’aube annonce un jour nouveau. Le règne de Turandot a cessé et la jeune fille pleure dans les bras de Calaf, lequel, pour preuve de son amour et de sa confiance, lui révèle enfin son nom. Triomphe de Turandot : « je sais ton nom, je sais ton nom ! »
Des trompettes annoncent que la cour se rassemble. Dans la salle du trône, Turandot s’adresse à l’empereur : elle connait le nom du prince étranger. Il s’appelle « Amour ».
VIDEOS :
1 – Acte I – Air de Liu : Barabara Frittoli
2 – Acte II – Air de Turandot « In questa reggia » : Birgit Nilsson
Pour l’entendre par Joan Sutherland, cliquez ici.
3 – Acte III – Air de Calaf « Nessum dorma » : Luciano Pavarotti
4 – Acte III – La mort de Liu : Barabara Frittoli

