Éditions Nous, Collection Now, 2013.
Traduits et édités par Jacques Demarcq.
Introduction de Rachel Stella.
Lecture d’Angèle Paoli
« UN PETIT LIVRE POUR ÉCLABOUSSER L’AUTRE CÔTÉ DE L’ATLANTIQUE »
« Un petit livre pour éclabousser l’autre côté de l’Atlantique ». Tel est le désir exprimé par Rachel Stella dans son introduction aux Portraits d’Amérique du photographe, poète et éditeur Jonathan Williams.
J’ignore encore si le but est atteint, le « petit livre » venant tout juste de voir le jour aux éditions Nous. Une chose est sûre, c’est que ce livre est jubilatoire. Aucun des portraits (trente-et-un en tout) réalisés par Jonathan Williams, photographies et textes, n’échappe à l’humour de leur auteur. Peut-être y a-t-il aussi, sous-jacent aux mots de l’Américain, l’humour propre à Jacques Demarcq, le traducteur de ces portraits miniatures. Tandem réussi, car chaque page apporte son lot de surprises et, à chaque page, le rire est au rendez-vous.
Condensés sur une seule page, le plus souvent répartis sur deux paragraphes, les portraits n’occupent pas plus d’une vingtaine de lignes (entre dix-huit et vingt le plus souvent). Sur la page en regard (page de droite ou page de gauche) se trouve la photo en corrélation avec le texte.
Album à double entrée, Portraits d’Amérique présente des poètes et des écrivains mais aussi des artistes ou des créateurs farfelus qui couvrent la totalité du XXe siècle. Les dates de naissance s’échelonnent de 1873 à 1947. La disparition la plus ancienne remonte à 1953. Quant au benjamin de la galerie, Thomas Meyer, né en 1947, il est toujours de ce monde et incarne selon l’écrivain-photographe le type du Puer Eternus décrit par le professeur Karl Jung.
Le lecteur croise inéluctablement, au cours de sa lecture, les grands noms de la poésie américaine : Mina Loy, Lorine Niedecker, William Carlos Williams, Louis Zukofsky, Ezra Pound, Allen Ginsberg, Charles Olson, Robert Duncan… et bien d’autres encore. À côté des plus connus, figurent d’autres noms dont la notoriété n’est sans doute pas tout à fait parvenue jusqu’aux confins des terres européennes. Eddie Martin, sorte de Facteur Cheval de Géorgie ; Vollis Simpson de Caroline du Nord (né en 1919 et toujours vivant), grand inventeur de machines éoliennes, combinant Miró et Dubuffet et qui se demande où diantre ses géniteurs sont allés dénicher un prénom pareil ; le coiffeur-pasteur-franc-maçon Elijah Pierce, l’« un des meilleurs sculpteurs afro-américains » qui « prie au-dessus [du bois] avant de l’entailler » ; James Harrold Jennings, un « visionnaire » qui vit dans sa campagne « sans eau courante ni électricité ni automobile ni téléphone »… et dont les inventions lui tiennent compagnie. « Des constructions brillamment colorées avec des bouts de bois récupérés ». Il y a aussi Thornton Dial, noir d’Alabama, peintre en bâtiment qui ne sait ni lire ni écrire mais qui sait ce qu’il a à faire et écrit tout de même dans son Thornton Dial : Image of the Tiger :
« y’a là
tous les visages de l’Amérique
tous les blancs tous les noirs
tous les bruns tous les rouges
tous les jaunes… »
Il y a là tous les visages de l’Amérique, en effet, toute sa folie qui fait sourire et qui surprend ; tout le côté « foldingue » de ses originaux qui laisse abasourdis nos esprits cartésiens.
Seule la première photo du « petit livre » impressionne. Il ne s’agit nullement d’un portrait de la sculptrice Laura Pope Forrester, la doyenne de la suite, mais de l’une de ses réalisations. Visage et main de morte engoncés dans la matière, regard incisif qui tente de déjouer le mystère. « Sérénité d’expression qu’on ne trouve que dans certains temples bouddhistes ou hindous », écrit Williams. Voire. Cette photo a spontanément exhumé pour moi l’une des « momies de Palerme » de la crypte des Capucins.
Chaque portrait surprend, cerné par une remarque incisive ou une expression du visage qui caractérise la personne. Ainsi de Mina Loy, dont la poésie érotique, définie comme « élégiaque et satirique », n’est pas appréciée. Parce que « les gens n’aiment pas ce genre de poésie », commente Williams. Son œuvre, inconnue de tous, constitue pourtant une exception absolue. Quant à Ezra Pound, qui suit immédiatement Mina Loy, son portrait se conclut sur cette remarque lucide mais probablement juste : « Tout ce que j’ai fait, c’est un peu de bruit pour quelques gus que personne n’écoutait. » Le docteur William Carlos Williams étonne par ailleurs par « sa féminité ». « Exaspéré par la fréquentation d’un monde insensible », il tient « sa force de sa vulnérabilité ». L’œuvre de l’écrivain Edward Dahlberg (1900-1977) est définie comme « un sommet impossible dans la Cordillère »… et les titres de ses ouvrages sont à eux seuls promesse de joyeusetés érotiques : Que ces os revivent, Les Puces de Sodome, Parce que j’étais de chair, Les Larmes de Priape, La Porte arrière de Cythère, L’Américain sans feuille de vigne. De Zukofsky, « Zuk », mort en 1978, Williams dit « qu’on se mettra à (le) comprendre dans une centaine d’années. » Robert Creeley apparaît en « portrait de l’artiste en assassin espagnol ». Gabardine noire et borsalino jouant de l’ombre sur le visage. Œil sombre et petite moustache, noire elle aussi. Denise Levertov, « de mère galloise, de père rabbin hassidique devenu prêtre anglican », bras croisés sur sa robe rapportée d’Oaxaca (Mexique), semble une petite fille sage. Allen Ginsberg, « Ginzy », à la barbe chenue et en salopette de travail, est un original qui chante William Blake en s’accompagnant sur un harmonium de l’Armée du Salut ». Il y a aussi James Laughlin, en ombre chinoise avec pipe, à qui Pound avait dit : « Non, Jaz, c’est sans espoir. Tu ne feras jamais un écrivain, même avec de la volonté » ; Jaz dont on découvre, à sa mort, « qu’il avait écrit davantage de bons poèmes classiques que Catulle, Martial, Properce et Horace réunis ». Seul le gros Charles Olson, « le Big O », père de l’énorme somme poétique Les Poèmes de Maximus, a droit à quatre pages. Deux pages de portrait et deux photos. Du maître du Black Mountain College, Williams, venu étudier la photographie, apprend que « TOUT HOMME EST SON PROPRE INSTRUMENT » et qu’un écrivain a tout à gagner à éditer ses propres ouvrages. Sans compter la leçon d’énergie contenue dans les formules intempestives : « MAKE IT NEW ! DO IT YOURSELF ! BE ROMANTIC… AND NEVER BE RUSHED! »
Chaque page de cet opus est une découverte qui invite à d’autres découvertes. Et chaque découverte réserve son moment de plaisir.
Si certains poètes présents dans ce petit opus sont issus du Black Mountain College, la plupart ont été soutenus par la Jargon Society et publiés par la Jargon Press, maison d’édition créée par Williams. Dont la ligne éditoriale est de s’intéresser aux auteurs d’un « modernisme » sans concession ainsi qu’à des créateurs marginaux. Les poètes bon ton bon genre, « les traditionalistes de Nouvelle Angleterre, les esthètes de l’École de New York » ainsi que « les Beat de la Côte Ouest » sont exclus du programme éditorial de Williams. Mais l’on apprend aussi que Williams s’est un jour détaché du Black Mountain, de son environnement et de son réseau d’influences. Parce qu’il faut bien couper le cordon, que le Black Mountain était devenu un club et que les chemins, inévitablement, se séparent.
Chemin faisant, on découvre que « le "milieu" de la poésie américaine est susceptible ». Qu’après la boutade de « la prose ventilée » de Richard Buckminster Fuller, survient une définition du poète : « le poète est celui qui rassemble les choses. » Que Louis Zukofsky résume sa conception de la poésie dans cette note : « Moins la poésie tient compte de la vie quotidienne et du sens rythmique d’un individu, moins elle a de chance d’être lisible. » Et que, derrière les formules d’Aaron Siskind (tout comme Harry Callahan, Siskind enseigna la photographie à Williams) : « quand je photographie un mur, je prends autre chose »/« quand je visite un nouveau pays, je trouve des vieux Siskind », c’est toujours de Siskind qu’il s’agit ; c’est toujours Siskind que l’on retrouve. Et l’on trouve aussi, formulée par la plume de Williams, toute son admiration pour Lorine Niedecker « la poétesse la plus absolue depuis Emily Dickinson… ». On est en présence, écrit-il encore, d’« un poète dont les pairs sont la Dame Ono Komachi et Sappho. Peu d’autres noms viennent à l’esprit. »
Les Portraits d’Amérique de Jonathan Williams, sont aussi, de manière indirecte, le portrait de Jonathan Williams. Un grand éditeur et un grand photographe. « Artilleur d’un autre canon ».
Angèle Paoli
D.R. Texte angèlepaoli
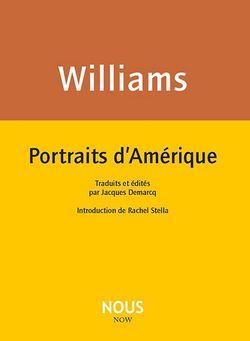
JONATHAN WILLIAMS
■ Voir aussi ▼
→ (sur le site des éditions Nous) la fiche de l’éditeur sur Portraits d’Amérique
Retour au répertoire du numéro de décembre 2013
Retour à l’ index des auteurs
Retour à l’ index des « Lectures d’Angèle »
