
Pourquoi Le Livre des Baltimore, roman décevant et phénomène d’époque, mérite d’être commenté. Comment l’auteur se soumet à la symbolique Maman du conformisme béat. Ce qu’on pourrait, bien amicalement, lui conseiller pour honorer son talent et, demain peut-être, écrire de meilleurs livres…
Premier constat.
La lecture attentive du Livre des Baltimore, dont j’attendais quelque chose, m’a plus que déçu : catastrophé après les cent premières pages. Je n’en croyais pas mes yeux à la découverte de cette vacuité saturée de superlatifs creux, devant ces personnages réduits à l’état d’ectoplasmes, ces situations « téléphonées » et ces dialogues filéscomme dans quelque photo-roman à la NousDeux et autres sitcoms dévertébrées. Or les 376 pages suivantes du roman ne m'ont guère rassuré ensuite.

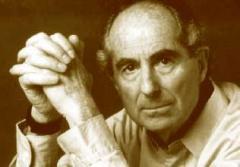
Ainsi,les motifs de Twin Peaks, imaginés par David Lynch, autant que le climat psychologique de certains romans de Philip Roth (notamment par la relation de Marcus avec sa mère, prototype de couveuse juive, ou aussi par la curée médiatique et populaire du politiquement correct, modulée dans La Tache ),constituaient-ils une substance riche et variée, où les stéréotypes de la littérature de gare (et d’aérogare) se trouvaient dépassés par l’énergie de la narration, l’évocation en 3 D du décor, le charme et la part de mystère de l’ouvrage.
Ensuite l’on vit la success story évoquée par le roman devenir réalité : non du tout par artifice de marketing, comme l’ont prétendu certains pédants jaloux ou mal informés, mais par les qualités primesautières du roman lui-même, lancé par les lecteurs et les libraires assez à l’écart de la critique instituée. Plus tard en revanche, snobés par les prix décrochés par le livre (Prix du romande l’Académie française et Goncourt de lycéens) et plus encore par le succès de Joël Dicker à l’international, les médias ont suivi le mouvement en bruyante troupe publicitaire.
Ainsi, un mois avant la parution du Livre des Baltimore, des pages entières étaient consacrées à Dicker, fort de ses 3millions d’exemplaires vendus, égrenant quelques platitudes consensuelles sur le roman lui-même pour mieux « angler » le sujet sur la personne du romancier soigneusement mal rasé ( autant qu’un Marc Levy), lequel ne tarda pas à se repandre à son tour en propos convenus, notamment sur le manque d’amour dont pâtit le monde actuel - un vrai scoop !
De l’utilité (éventuelle) d'une critique sévère-mais-juste...
Paul Léautaud, dont l’esprit critique s’exerçait en toute liberté, dit un jour qu’il était instructif de lire, parfois, des livres de « carton ».
Entendons plus précisément : de carton-pâte. Ce qu’on peut direaussi : de kitsch fabriqué.
Dans une chronique récente du Figaro-Magazine, Frédéric Beigbeder montre bien, citations (assez accablantes) à l’appui, en quoi Le Livre des Baltimore relève de la fabrication complaisante, relevant en outre l’invraisemblance de diverses situations qui signalent le manque de psychologie ou d’expérience vécue du romancier.
J’en ai repéré bien d’autres, comme la calamiteuse scène du génial ( ?) enfant Hillel taxant, à huit ans ( !) son prof de gymnastique de piètre« hypocondriaque » avant de l’obliger à monter aux perches, du haut desquelles le moniteur tombe et se casse les jambes. Ou, plus niaisement convenue qu’invraisemblable : cette autre scène où tel directeur decollège pour enfants (forcément) riches clame par devant son horreur du sexe,avant d’être surpris par le même génial Hillel en train de fesser une collègue par derrière.
Or tout le Livre des Baltimore accumule, à grand renfort d’adjectifs outrés, les situations attendues et les clichés à n’en plus finir, émaillés de dialogues d’une complète indigence. Exercice de lecture : trouver, derrière les superlatifs qui font de Hillel un type génial, de son cousin Marcus « l’étoile montante de la littérature américaine », de leur ami Woody un mec super, d’Alexandra la chanteuse à succès « la nouvelle icône de la nation », la moindre épaisseur humaine, la moindre touche de personnalité non formatée, le moindre frémissement de réelle émotion ou la moindre raison concrète de s’intéresser à ces stéréotypes de papier glacé, de carton-plâtre ou de marshmallow…
La question de Maman
Le personnage de la mère de Marcus, dans Lavérité sur l’affaire Harry Quebert, plus ou moins calqué sur telle mère juive de Philip Roth, était intéressante par son côté lourdement envahissant typique de la mère américaine ou de la mère juive (ou de la mère autrichienne, italienne, iranienne ou genevoise).
Dans Le Livre des Baltimore, éclipsée par la formidable (?) Tante Anita , épouse du non moins exceptionnel ( !) Oncle Saul, la mère de Marcus fait pâlotte figure alors que la grand-mère paternelle, du genre duègne snob et péremptoire, qui ne jure que par les Goldman de Baltimore au détriment des Goldman du New Jersey (les parents « seconde classe » de Marcus) compose un début de personnage réellement insupportable (donc intéressant) que le romancier ne fait hélas qu’esquisser.
Cela étant, tout le roman me semble marqué par le commandement sous-jaçent, omniprésent dans une certaine Amérique, selon lequel il est inapproprié de déplaire à Maman. Or un écrivain digne de ce nom peut-il se déployer sans braver cet interdit ? Pourquoi Le Livre des Baltimore, qui se veut célébration de la jeunesse, est-il à ce point dénué de sensualité. Comment ne pas être écoeuré par cette apologie de la réussite, suivie d’une évocation non moins factice des revers subis par les riches ?
Exercice proposé à Joël Dicker: lire Le petit bout defemme de Franz Kafka et y réfléchir…
La question du succès et del’argent.
Le succès phénonénal de La vérité surl’affaire Harry Quebert est-il à l’origine de l’affadissement du Livre des Baltimore ? Un« carton » mondial est-il forcément fatal à un écrivain ?
Philip Roth est l’exemple du contraire, dont le succès non moins extraordinaire de Portnoy et son complexe (Portnoy’s complaint) aurait pu marquer la chute, alors qu’il fut suivi d’une carrière en incessant crescendo, nourrie par la vie et une exigence littéraire sans cesse réaffirmée. Mais c’est en bravant Maman et sa famille juive que Philip Roth s’imposa d’emblée, avant de produire une œuvre travaillée par les névroses de l’auteur et les psychoses de l’époque, jusqu’à la trilogie américaine à la Thomas Wolfe, l’hommage au père de Patrimoine et l’uchronie politique du Complot contre l’Amérique entre autres livres mémorables d’une œuvre outrageusement ignorée par les académiciens du Prix Nobel.
À ce propos, ceux qui reprochent aux jeunes auteurs (notamment romands) de « faire américain » prouvent qu’ils ont une piètre connaissance de la littérature américaine d’aujourd’hui, qui ne se réduit pas à la fabrication de bonnes stories ou au succès monstrueusement disproportionné d’une Anna Todd, parangon stupéfiant de l’infantilisme, de la stupidité et de la vulgarité.
Bref, pas plus que le succès, ou l’argent qui en découle, ne sauraient, sans son consentement tacite, nuire à un auteur digne de ce nom, comme l’a aussi prouvé un Georges Simenon, auquel Bernard de Fallois a d’ailleurs consacré un beau livre.
De la transmission d’une expérience
GeorgesSimenon, précisément, estimait qu’il était impossible, à un père, de transmettre son expérience à ses enfants par le truchement de seuls conseils.
Un fils doit faire lui-même les expérience, jusqu’aux plus cuisantes, qui ont brisé et bronzé le cœur de son père, et c’est pourquoi je doute que quiconque puisse donner de bons conseils à Joël Dicker.
Cela étant, je trouve peu charitable, de la part de Frédéric Beigbeder,d’exclure le jeune romancier du domaine de la littérature, le renvoyant dans la catégorie des faiseurs de best-sellers à la Marc Levy, Guillaume Musso, Katherine Pancol et autres faiseurs.N’est-ce pas un peu tôt, s’agissant d’un auteur de trente ans soumis en peu de temps à l’inimaginable pression d’une notoriété mondiale ?
L’indéniable risque d’un tel succès réside, évidemment, dans le fait que, tout à coup, un jeune auteur se trouve propulsé dans un univers factice coupé de la « vie réelle ». Au moment de l’affronter, Philip Roth avait déjà été consacré aux Etats-Unis pour son premier livre, Goodybe,Columbus, et ses assises personnelles, sociales ou littéraires, étaient d’une autre solidité que celles du jeune Dicker, si doué qu’il fût.
Cependant, qu’est-ce que la vie réelle ? Un Bret Easton Ellis, ou, quelques étages plus haut, un Henry James, ont prouvé que l’univers des riches pouvait offrir un matériau littéraire aussi intéressant que celui des « antihéros » de la moyenne bourgeoisie. Et Proust, ou Martin Amis en Angleterre, Gore Vidal « retournant » les clichés médiatiques dans son mémorable Duluth, délectable gorillage de la série Dallas (publié en traduction française par Bernard de Fallois, et préfacé par Italo Calvino) ont montré que tout peut être intéressant dans tous les milieux, outre que le vrai style ou la littérature la plus raffinée n’ont rien à voir avec le compte en banque de l’auteur. Le millionnaire Raymond Roussel voyageait en voiture de luxe, tousrideaux tirés, et en tirait de fabuleux voyages poétiques.
L’enjeu de l’affaire Dicker en son époque
Le grand Céline, autre passion avec Proust de Bernard de Fallois, dit quelque part qu’un écrivain n’est qu’un turlupin s‘il ne met pas sa peau sur la table. C’est lui aussi, à propos de son expérience au front de la première tuerie du XXe siècle, qui dit qu’il y a des puceaux de la guerre comme il y a des puceaux del’amour.
Avec La vérité sur l’affaire Harry Quebert, Joël Dicker est parvenu, par une sorte de mimétisme saisissant, à pallier son manque d’expérience humaine en imitant les écrivains auxquels il rêvait de ressembler.Par sa fraîcheur et son ingéniosité, ce roman révélait un talent de narrateur très prometteur, supérieur (en tout cas à mes yeux) à celui d’un Paulo Coelho,dont L’Alchimiste a fondé le premier succès mondial avant la dégringolade d’une carrière de flatteur tous azimuts.
Mais voici Le Livre des Baltimore quenous sommes supposés lire comme « une série américaine à regarder en famille », dixit Dicker…
Passons sur l’image lénifiante d’un roman lu « en famille », mais que dire de la référence aux séries télévisées. Est-ce à dire que Joël Dicker se félicite de viser bas, comme ne manqueront pas de le conclure d’aucuns de leur haut ?
En ce qui me concerne, après avoir nourri les plus sévères préjugés contre les séries télévisées, de Dallas à Urgences, j’ai découvert, ces dernières années, des séries intelligentes, admirablement construites, dialoguées et interprétées,qui valent parfois mieux que des romans à prétentions littéraires.
De Twin Peaks à Breaking bad, en passant par Luther ou Borgen, The Wire ou Broadchurch, True Detective, Vera et quelques autres, j’ai trouvé dans ces ouvrages souvent collectifs un matériau réellement intéressant du point de vue littéraire et artistique, aux franges du cinéma et de la sociologie documentaire, avec de vrais stylistes (un Aaron Sorkin, dont la patte marque West Wing et plus encore Newsroom, remarquable aperçu critique des médias américains, est un scénariste-dialoguiste de premier ordre) qui fondent la culture vivante d’aujourd’hui n’en déplaise aux cuistres se posant en chiens de garde de la Littérature.
Dans ce nouveau contexte culturel, où l’intelligence talentueuse et l’ingénisoté le disputent aux sempiternels stéréotypes du feuilleton bas de gamme (la nuance s’imposait déjà du temps de Balzac, Hugo ou Dumas), il me semble assez sot de rejeter a priori tout recours aux nouvelles techniques« américaines » de narration, remontant pour le roman à Dos Passos – sans parler de l’héritage du cinéma chez Alfred Döblin ou chez le Jules Romains des Hommes de bonne volonté…), alors que la littérature contemporaine brasse et rebrasse tous les modes d’expression. De ce point de vue, l’opposition d’une Littérature recevable, selon les codes académiques frileux, et de sous-produits classés best-sellers, me semble non seulement vaine mais fausse du point de vue del’évaluation critique.
En Suisse romande, l’apparition soudaine d’un Joël Dicker, après le succès localde Quentin Mouron, ont semé une certaine confusion jamais observée dans le milieu littéraire, mais entretenue par une certaine sottise médiatique saluant même les beaux gosses…
Or ce qui est intéressant chez ces deux très jeunes auteurs, tient à leur expérience existentielle effectivement américaine (Quentin a passé son enfance au Canada et Dicker a baigné lui aussi dans le monde qu’il écrit durant ses vacances d’adolescent), mais surtout à ce qu’ils en ont tiré du point de vue de leur écriture, tous deux s’étant nourri de littérature autant que de séries télévisées. Cela étant, question thématique, processus narratif et succès en librairie, L’Amour nègre de Jean-Michel Olivier avait marqué peu avant une percée déjà spectaculaire. Or, la Littérature y avait-elle perdu ? Nullement.
Lesprofs de littérature du coin ont considéré Joël Dicker et Quentin Mouron avecune sorte de condescendance, parlant d’OVNI sans entrer en matière sur la thématique et le dynamisme narratif de La vérité sur l’affaire Harry Quebert pas plus que sur la frémissante braise stylistique du premier livre de Quentin Mouron (Au point d’effusion des égouts) et sur l’étonnante perméabilité émotionnelle de Notre-Dame-de-la-Merci).Plus récemment, les apparitions d’un Antoine Jaquier, avec Ils sont tous morts, après SwissTrash de Dunia Miralles, ont joliment « cartonné » eux aussi dans nos contrées. Maispeut-on pour autant parler de « renouveau de la littérature romande » ?
Peut-être à certains égards, mais qui englobe le renouveau de la culture dans son ensemble, la mutation des mentalités à plus large échelle, sans parler des composantes relevant de la sociologie littéraire. Mais encore ?
Au début du XXe siècle, vers 1914, un vrai premier renouveau fut marqué par l’apparition de novateurs stylistiques éclatants, avec Ramuz (qui écrivit trois grands livres avant 30 ans…) , Charles-Albert Cingria et Blaise Cendrars (aussi peu Romand à vrai dire que Dicker…), mais qui aurait parlé alors de « tirage » ?
Ensuite, le « renouveau » n’a cessé de se répéter à chaque auteur significatif, de Pierre Girard à Alice Rivaz ou de Jacques Mercanton à Catherine Colomb, publiés à Paris ou non, jusqu’à Jacques Chessex, prix Goncourt 1973 et publié à Paris ou Georges Haldas, Nicolas Bouvier et tant d’autres, renouvelant chaque fois ceci ou cela.
Tout cela pour dire quoi ? Qu’il faut faire la part, aujourd’hui, de l’amnésie des uns et de l’hystérie des autres, en considérant les œuvres pour ce qu’elles sont,
La vérité sur l’affaire Harry Quebert de Joël Dicker, succès mondial, est-il un livre marquant du point de vue littéraire ? Sûrement moins que le premier petit roman de Ramuz, Aline, pure merveille appréciée de quelques-uns seulement.
Mais Dicker ne sera-t-il bon qu’à aligner des best-sellers édulcorés, comme Le livre des Baltimore, probablement voué à un nouveau succès ? Qui peut en jurer ?
Un bêta de nos régions affirmait naguère que l’écriture d’un best-seller se réduit à un sujet + un verbe + un complément,réduisant le public à une masse de nigauds manipulés. D’autres ont longtemps considéré un Simenon comme un pisse-copie sans aucun intérêt littéraire, au motif qu’il était l’auteur francophone le plus lu au monde.
Bernard de Fallois,découvreur d’un inédit de Proust, fut un des éminents critiques littéraire qui ont défendu Simenon bien avant que celui ci ne fût intronisé à La Pléiade. Mais comment lui reprocher, aujourd’hui, de défendre son poulain aux oeufs d’or, même si Joël Dicker a encore bien à faire pour arriver à la cheville du petit Marcel ou à celle du non moins immense Simenon ?
Allons allons: bon vent Joël Dicker. J’ose croire, pour ma part, que tu (vous avez l’âge de nosenfants, donc je te dis tu) peux mieux faire que Le Livre des Baltimore…
Joël Dicker, Le Livre des Baltimore. Bernard deFallois, 476p.
FrédéricBeigbeder, Un scénariode roman. Le Figaro-Magazine, 3 octobre 2015.
