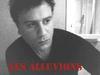La poussière œuvre dans le temps long : combien de semaines a-t-il fallu attendre pour que Man Ray puisse prendre cette photo dans l'atelier de Marcel Duchamp, à New York ? Près d'un siècle plus tard, à Sète, outre-Atlantique, Christian Bobin veut en prononcer l'éloge, se rendant par le train une nuit de Noël chez l'ami Pierre Soulages. J'ai dit comment le thème ne s'est pas imposé par irruption, invasion, effraction, mais par une lente sédimentation dans la conscience, répliquant en quelque sorte son mode physique d'envahissement des surfaces. Les étapes intermédiaires précédant l'avènement bobinesque, je n'en avais donc rien noté, mais j'avais besoin d'y retourner voir, pour m'assurer que je n'avais pas halluciné la répétition pulvérulente.
Il me fallut revenir à ce récit d'Annie Dillard, la merveilleuse écrivaine découverte en juin 2024, et dont je lisais Une enfance américaine, acheté en février chez un bouquiniste de Saint-Sauveur-en-Puisaye, le village de Colette.

Il est encore question du temps dans cet ouvrage, la quatrième de couverture donne le la : "L'éternité est amoureuse des productions du temps", disait Blake. Annie Dillard, qui grandit à Pittsburgh dans les années 1950, écrit ici les épiphanies qui ont marqué son enfance (...)"
Les chapitres du livre ne sont ni numérotés, ni titrés. Celui qui s'amorce page 60 débute ainsi : "D'un côté, notre jardin était longé par un court chemin à l'abandon et sans issue. Nous ne le voyions pas de la maison ; nos parents avaient planté une rangée de peupliers pour le cacher. J'y trouvai une vieille pièce de monnaie." Annie Dillard raconte comment elle fouillait la terre sous un des peupliers, avec un bâton d'esquimau, quand elle a senti la pièce et creusé pour la dégager. Plus tard, elle la montra à son père :
Il lut la date, 1919*, et me dit que c'était une vieille pièce, qui valait peut-être plus de dix cents.
Il m'expliqua que le passage du temps avait enterré la pièce ; la terre tend à s'accumuler autour des objets. A Rome, continua-t-il, en se penchant par la fenêtre de la cuisine tandis que je m'accoudais à un meuble pour le regarder - à Rome, il avait vu de vieilles portes, deux ou trois étages sous terre. Là où autrefois les enfants sortaient directement au-dehors, les visiteurs devaient maintenant gravir deux escaliers pour retrouver la lumière de la rue. Je cessai d'écouter pendant une minute. J'imaginai que, si les enfants de Rome étaient, par je ne sais quel horrible hasard, restés assis suffisamment longtemps sur le pas de leur porte, perdus dans leur pensée au point d'en oublier de bouger, ils auraient été eux aussi enfouis sous la poussière, jusqu'au menton, non, par-dessus la tête ! mais à ce moment-là, bien sûr, ils auraient été très vieux. Ce qui était justement arrivé aux enfants de Rome - et la force de cette image me frappa -, qu'ils soient ou non restés sur le pas de leur porte. [C'est moi qui souligne]
Ce qu'Annie Dillard montre excellemment, c'est bien cette puissance des images forgées dans l'enfance, à travers le plus souvent de minuscules événements comme celui-ci : "Ce furent ces quelques pensées qui m'occupèrent pendant de longues années et laissèrent des traces dans ma vie intérieure." Traces dans l'esprit mais aussi traces dans le corps, dans la mémoire du corps, comme l'illustre cette seconde apparition de la poussière : "C'était mon corps qui connaissait ces trottoirs et ces rues. Mes os me faisaient mal à les parcourir, j'avais le goût de leur poussière brûlante sur mes lèvres écorchées ; leur gravier s'enfonçait dans mes paumes et mes genoux et y restait, bleu sous la nouvelle peau qui se reformait."(p. 146)
Un autre livre, à peine entamé, forma aussi relais vers l'assomption de la poussière. En février encore une fois, je fis l'acquisition de la réédition chez Zoé du Petit traité de la marche en plaine de Gustave Roud.

Le premier texte, Adieu, n'est autre que le premier livre de Roud, commencé en novembre 1922, un mois après la publication de la photo de l’Élevage de poussière. Et la première phrase de ce premier livre est celle-ci :
Route aiguë au cœur du village rose là-bas comme une flèche, ah par pitié rejette sur ta rive ce corps brisé par ta houle de poussière et de parfums, les mains percées de taons et qui étouffe.
*
La photo jointe est la suivante :
Je regarde attentivement, et je réalise alors que le Doc m'a envoyé deux pages du roman Un peintre de notre temps, que je venais précisément d'acheter à un bouquiniste de la Halle au blé dimanche 30 mars, quatre jours plus tôt. Un roman dont je n'avais jamais entendu parler jusque-là, publié une première fois en 1958, retiré de la vente à cause des tensions de la guerre froide, et réédité en 1976. C'est l'édition française chez Maspero (1978) que j'avais achetée.

La coïncidence est d'autant plus incroyable que le Doc lui-même me confia ensuite qu'il ne savait même pas il y a dix jours que ce titre existait dans l’œuvre de Berger. L'édition qu'il avait était un fac-similé, "commandée livre neuf".
Il n'est sans doute pas anodin que deux des livres ici chroniqués soient issus des rayonnages de bouquinistes, en quelque sorte les braconniers du temps des livres. Et je songe tout à coup, en écrivant ces lignes, aux Chasseurs d'André Hardellet, qui donnent le titre de deux magnifiques recueils de poèmes. Dans le premier, édité chez Pauvert en 1966, le poème en prose, Les chasseurs, évoque l'apparition de cinq silhouettes à la lisière du bois des Arpents, "apparition qui semble née spontanément de la substance du taillis, très touffu dans ce secteur."
"Quelqu'un - vous, moi - grimpe au sommet du chêne Capitaine, d'où l'on peut voir la fin des Arpents et les champs qui leur font suite. Il attend, ce quelqu'un. Il attend que la scène se reproduise : le débouché des chasseurs en pleine lumière, l'alerte donnée aux corbeaux, des coups de feu, mais rien. Rien, personne. Le guetteur pourra bien demeurer des heures sur son perchoir, les Arpents ne relâcheront plus ce qu'ils ont capturé. Et pourtant le bois, limité à gauche par les murs de la Tuilerie, se termine à gauche par des coupes où cinq hommes passeraient difficilement inaperçus. [...] Les chasseurs ont peut-être fait halte, tout simplement, en attendant que j'aille les rejoindre lorsque j'aurai appris comment. Et qui sait s'ils ont bougé, depuis, sous le couvert ?"
La magie d'Hardellet, qui réside toujours dans ce jeu avec la suspension du temps, résonne pour moi aujourd'hui avec l'image des enfants de Rome dans le récit d'Annie Dillard.

___________
* 1919, année de naissance de Pierre Soulages.