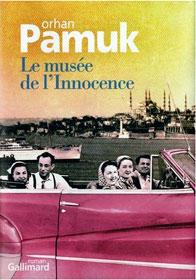
Insupportable : tel est le premier mot qui vient à l’esprit pour caractériser le héros du nouveau roman d’Orhan Pamuk. Kemal Bey, trentenaire, directeur général d’une société d’import-export, fils à papa et homme gâté, devient fou amoureux d’une cousine lointaine le jour où il achète dans le magasin d’accessoires de celle-ci un sac pour sa fiancée… Nous sommes en 1975 à Istanbul, dans la meilleure société bourgeoise, acquise à un certain Occident. Tout à son double bonheur, Kemal retrouve sa très jeune maîtresse, Füsun, dans un appartement insoupçonné de la famille, tout en planifiant la cérémonie de fiançailles au Hilton avec sa promise, Sibel. Incapable de sacrifier à la première son engagement avec la deuxième, il ne le rompt qu’au moment le moins opportun, quand tout a déjà été brisé. Mis au ban par sa famille, ses amis, ses associés, il va désormais devoir conquérir avec une patience infinie ce que la grâce lui avait donné sans partage. Le roman, lui, se transforme en terrible apprentissage des signes.
Dans le récit égotiste du bonheur de Kemal, sa bien-aimée Füsun n’apparaissait qu’en creux, fantasme à disposition, fantôme des réminiscences du héros, que celui-ci convoquait à loisir sur la scène de son petit théâtre intérieur. Désormais, Füsun a réellement disparu, et, dans un renversement ironique, Kemal croit la reconnaître en chaque passante dans les rues de son délire. L’amour se révèle une maladie, très littéraire, des signes. Tout devient pour Kemal matière à interprétation ; un rien le fait basculer dans la folie herméneutique. Symptomatiquement, le héros déchu de son nuage se met à collectionner tout ce qui constitue un témoignage de son idylle passée, mégots, réclames, boucle d’oreille… Ayant hésité à choisir une femme, il se voit condamné à sélectionner les signes évocateurs de son amour et à muséifier ce qu’il n’a su retenir.
Lorsqu’il retrouve Füsun mariée à un homme qui se pique de réaliser des films populaires, sa jalousie ne s’est pas encore convertie en art, et il devient une sorte de Pygmalion impuissant. Invité quotidien des dîners familiaux, il est condamné, pendant une dizaine d’années, à n’effleurer son ancienne maîtresse que du regard, par-dessus les non-dits qui planent à table. Chaque soir, après le repas, la mère de Füsun lui sert ce refrain infernal : « Kemal Bey, revenez demain, nous nous assiérons à nouveau. »
Rejouant le scénario fétichiste de La Prisonnière, Kemal ne peut, à l’instar du narrateur proustien, que tomber dans le propre piège que lui tend son miroir. Petit à petit, Le Musée de l’innocence, sans jamais se délester pourtant de son kitsch originaire, réussit à métamorphoser la passion amoureuse en initiation romanesque. Autrement dit, en leçon de littérature. Dépeindre cette passion avec force détails et lourdeurs, notamment dans l’intitulé des chapitres, n’est peut-être en effet que prétexte pour l’auteur à faire son autoportrait en kleptomane et collectionneur inconditionnel. Si, dans son précédent livre, le recueil autobiographique D’autres couleurs, Orhan Pamuk effeuillait avec un bonheur inégal ses souvenirs, dans ce nouveau roman, il parvient à restituer avec beaucoup de finesse l’atmosphère de la capitale turque des années 1970-1980, à partir de riens très concrets. On souhaiterait parfois qu’il développe davantage l’arrière-plan politique des coups d’État de 1971 et de 1980, comme dans certains passages où il évoque l’absurde rôle de la censure au cinéma ou les conséquences du couvre-feu sur la routinière vie amoureuse du héros. L’évolution des mœurs sexuelles en Turquie concentre une grande partie de son attention, notamment la question de la virginité. C’est à travers elle que l’écrivain met en scène la confrontation très drôle entre une bourgeoisie occidentalisée, et donc, forcément, autoproclamée moderne, et un milieu plus pauvre et en apparence plus traditionnel.
Placé d’emblée dans les métamorphoses d’une ville que scande le chant lointain et rauque des cornes de brume, Le Musée de l’innocence plonge ses personnages dans une ambiance vaporeuse. Le motif du sac à main de la marque Jenny Colon (nom de l’amour de Nerval), objet du délit amoureux auquel l’histoire se rattache, que vient relayer le flacon de parfum Spleen, double la futilité des bibelots omniprésents d’un sens tragique de la nostalgie. C’est dans les circonvolutions de la ville et les objets qui la parsèment que le héros sculpte le labyrinthe de sa mémoire, et que l’auteur met le mieux en scène les tours et les détours de l’écriture.

