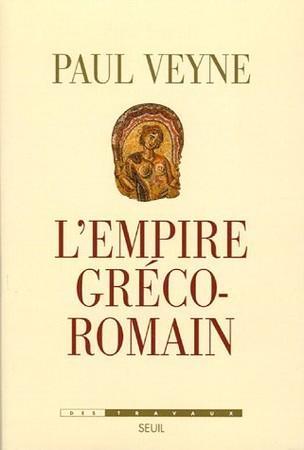
Paul Veyne
par François Busnel
Lire, décembre 2005 / janvier 2006
«Fabriquer de l'histoire
est l'équivalent athée d'une prière»
L'Antiquité gréco-romaine revient à la mode. Au cinéma et au théâtre, dans les restaurants branchés des actuelles Rome ou Athènes (où l'on dîne désormais couché à la romaine...) et, bien sûr, en bonne place dans vos librairies. Parmi les nombreux ouvrages consacrés à cette période fondatrice de l'histoire de l'Occident, une somme appelée à faire date : L'empire gréco-romain de l'archéologue et historien Paul Veyne. Un régal ! La plume de Paul Veyne est impertinente et drôle, érudite et originale.
Inclassable, Paul Veyne retrace l'histoire de l'Empire en convoquant la sociologie, la psychologie, la philosophie, l'histoire et les sciences. La politique est romaine, mais la culture est grecque, démontre-t-il brillamment avant de brosser le portrait-robot d'un empire bilingue et biculturel qui n'a rien à voir avec les clichés que véhiculent encore nos poussiéreux manuels. L'occasion était trop belle de donner la parole à cet éminent historien, titulaire de la chaire d'histoire de Rome au Collège de France, auteur d'une vingtaine d'ouvrages de référence et dont la renommée dépasse largement nos frontières.
Veyne avait révolutionné l'approche de la mythologie grecque (Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes?) et le regard de l'historien sur ses objets d'étude (Comment on écrit l'histoire), aujourd'hui il bouleverse radicalement, preuves et anecdotes à l'appui, notre vision de la Grèce et de Rome. Il va même plus loin, repérant dans ce passé méconnu les traces de notre modernité.
Comment êtes-vous devenu historien ?
Paul Veyne - Tout a commencé par un choc psychologique. À l'âge de huit ans, je suis monté sur une colline

L'année suivante éclate la guerre... Vous avez alors neuf ans. Fut-ce un autre choc ?
P.V. Je vivais dans un milieu qui, par conservatisme social et peur du Front populaire, était plus que collabo. Le journal qui était lu chez mes parents était une espèce d'infection nommée Gringoire. Et je vais vous dire, je regrette que l'on n'ait pas foutu douze balles dans la peau de Carbuccia, le type qui l'a dirigé et qui a été gracié à la Libération ! C'est dans ce journal que j'avais lu, à neuf ans, que les Anglais venaient de commettre les pires atrocités lors de la révolte des Cipayes. Je me vois encore expliquer à l'un de mes camarades qui, lui, était pour les Anglais et contre les Allemands : «Mais enfin, tu ne peux pas être du côté des Anglais... Ils ont fait des horreurs.» Il faut rappeler l'ignorance quasi totale dans laquelle les gens de province étaient alors - et tout particulièrement un gosse de neuf ans qui a spontanément les opinions de ses parents. Du coup, c'est vrai, je n'ai pas éprouvé de joie à la Libération.
Vous avez tout de même quitté votre milieu pour intégrer Normale sup. Que cherchiez-vous alors ?
P.V. Sortir de mon milieu, en effet. Je suis arrivé à Paris pour faire ma khâgne et ce fut un autre choc effrayant : le bas-relief célébrant la Libération de Paris en bas du Boul'Mich'. Celui-là n'a rien à voir avec les Romains mais ce fut, brusquement, l'image de la conversion. Naturellement, je suis entré dès que j'ai pu au Parti communiste... pour expier. Et puis, je me disais : «Tu te fiches totalement de la politique, tu n'es pas très sûr d'être courageux, donc grâce à la discipline du Parti tu es certain que tu ne trahiras jamais.»
Vous n'êtes resté que quatre ans au Parti communiste. Pourquoi avez-vous rompu, si vous n'aviez aucune conscience politique ?

Un autre choc ?
P.V. Oui, car je fus médusé par les rapports entre colons et indigènes. On m'avait envoyé en Algérie pour raisons archéologiques. Et je n'ai vu que les rapports humains. Cela m'a paru invraisemblable ! La façon dont se comportaient les colons avec les indigènes était pour moi insupportable, révoltante, intolérable. Au point que, je l'avoue, j'ai eu un moment de joie en 1961 car je voyais dans la guerre l'occasion de mettre un terme à ces rapports qui n'étaient pas moralement supportables. Mais il y a eu, ensuite, les révélations sur la torture. Et ce fut pire encore! Chaque matin, pendant des mois, je me suis réveillé avec une idée dans le crâne: «Nous sommes en train de faire en Algérie ce que les nazis ont fait en Europe.» Là encore, je précise que ce ne fut pas un choc social ou pro-prolétarien, mais un choc moral.
À quel moment décidez-vous de ce qui va devenir votre spécialité, l'archéologie et l'histoire gréco-romaine ?
P.V. Tout de suite. Ma famille était très ignorante, je vous l'ai dit, et très hostile au Front populaire. Mais il y avait un notaire qui, voyant que je lisais sans arrêt des ouvrages d'histoire romaine ou grecque, a convaincu mon père que je devais faire l'Ecole normale supérieure. J'ai donc suivi ce chemin pour faire de l'archéologie et de l'histoire ancienne mais je n'avais aucune admiration particulière pour les Romains, ni aucune valeur humaniste ou autre. Je sais que ça brise le mythe de dire cela, mais c'est la vérité : les événements se sont enchaînés et je suis devenu archéologue et historien parce qu'enfant j'avais découvert un bout d'amphore sur une colline, voilà tout.

P.V. C'est une histoire curieuse. À cette date, j'avais publié beaucoup d'articles mais peu de livres. En 1968, sans qu'il y ait aucun rapport avec les événements, je me suis mis à écrire un livre qui se présentait comme une rêverie sur la façon dont on écrit l'histoire (Comment on écrit l'histoire, NDLR). J'y racontais en partie ma vie, ce qui n'était pas très orthodoxe à l'époque. Or ce livre n'était ni soixante-huitard ni marxiste, et ne relevait pas davantage de la toute-puissante école des Annales. Je me foutais de Mai 68 (même si j'étais pour, mais pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le métier d'historien), de Marx et de Braudel. J'étais plutôt fasciné par les philosophes Georg Simmel et Max Weber. Je me souviens que Braudel, à la sortie de mon livre, m'a écrit quelque chose du genre: «Plutôt que d'aller chercher toutes ces choses fumeuses dans la philosophie allemande, vous feriez mieux de faire appel à la clarté française...» Allusion à peine cachée au fait que je ne prenais pas la peine de le citer. Lisant mon livre, Raymond Aron a, quant à lui, trouvé un type qui rigolait du marxisme, de Mai 68 et des Annales tout en ayant une capacité à faire des bons mots à toutes les pages. Or Aron ne cherchait pas un héritier spirituel mais quelqu'un qui s'occuperait de ses travaux après sa mort. Et il fallait que ce soit un normalien ! Pour Aron, ce dernier point était capital. Comme Pierre Bourdieu, son dauphin désigné, venait de lui claquer la porte au nez, il s'est replié sur ce type qui ricanait grassement quand on parlait de marxisme, n'arborait pas la moindre trace de soixante-huitardisme et n'appartenait pas à l'école braudélienne. Et qui, de plus, était normalien. Et voilà comment Aron m'a proposé pour le Collège de France. Est alors arrivé l'incident fatal, lors de ma leçon inaugurale. J'étais tellement perdu dans mes rêves intérieurs que, contre toute convenance, je l'admets avec honte, j'ai oublié de citer le nom de Raymond Aron. Oui, cela semble invraisemblable mais j'étais dans la lune. Pour Aron, ce fut un choc terrible, le signe de mon ingratitude. Et à partir de ce jour, il se mit à me persécuter après m'avoir fait élire...
Cet épisode confirme donc l'image dont on vous affuble parfois, en toute sympathie : celle d'un professeur Nimbus...
P.V. Eh oui, hélas. Je le crois.
Mais comment expliquez-vous que vous soyez si souvent «dans la lune» ? Est-ce le signe que rien ne vous intéresse hormis vos Grecs et vos Romains ?
P.V. Fabriquer de l'histoire - ou n'importe quel travail désintéressé - est l'équivalent athée d'une prière. La dépersonnalisation que produit cet effort pour dire ce que l'on croit être la vérité vous met dans cet état et parfume votre bureau d'une sorte de sécurité intérieure. C'est mystique, si vous voulez.
Revenons à notre sujet : en quoi consiste votre travail d'historien ?
P.V. Il consiste à dessiner, dans toutes ses vérités et sans poncifs, une certaine figure lointaine. Pour cela, il faut inventer des idées, c'est-à-dire conceptualiser. Pour arriver à dire l'individualité, qui ne ressemble pas à nous et dont la ressemblance est fausse, vous devez utiliser des concepts : plus il y a de conceptualisation, plus il y a d'individualisation. Loin de renvoyer à des généralités, les concepts abstraits sont l'unique moyen de définir avec exactitude une individualité. Sans eux, on tombe dans les lieux communs. Michel Foucault n'avait pas son pareil pour inventer des concepts, il est à ce titre le plus important des historiens de l'Antiquité.
Donnez-nous des exemples de concepts historiques...
P.V. Dire, par exemple, que le pouvoir de l'empereur romain est un pouvoir clanique, qu'il est mandataire et non souverain, que la cité grecque est un corps concret et non une constitution dans laquelle les gens entrent après être passés à la toise...
Votre ton est également très particulier : quelle est votre conception de l'écriture ?
P.V. Il faut être léger. Et se poser des questions. Mais attention, des questions élémentaires du type:

Comment expliquez-vous ce retour de l'Antiquité ?
P.V. Le Moyen Age a été tellement bien traité par l'école des Annales que le sujet est désormais épuisé !

Jusqu'à présent, on dissociait la civilisation grecque de l'Empire romain. Qu'appelez-vous, au juste, l'Empire gréco-romain ?
P.V. Cette dissociation est propre à la France où les chaires de latin et de grec sont distinctes et où les hellénistes contemplent Rome comme une duchesse toise un cancrelat tandis que les latinistes ne jurent que par l'originalité romaine. Les Allemands, les Anglais ou les Américains qui liront mon livre vous

Cela veut donc dire que cet Empire fut bilingue...
P.V. Oui, bilingue et biculturel.
Fut-il également bicéphale ?
P.V. Il finira par le devenir, lorsque Constantinople prendra son essor et deviendra capitale de l'Empire romain d'Orient.
Mais comment est-on passé du modèle politique grec, proche d'une totalité, au modèle politique romain où ce n'est plus le tout qui prime mais l'individu ?
P.V. Dans l'Italie ancienne, chez les Etrusques, le centre de la vie est la cité. Comme en Grèce ou dans les parties civilisées du Proche-Orient. On ne sait pourquoi ce modèle, composé d'un petit groupe d'un millier de personnes, s'est retrouvé en Phénicie, diffusant très rapidement son modèle politique dans l'Asie Mineure, puis dans le monde étrusque et dans le monde romain. Mais la Grèce et Rome ont en commun le système de la cité. Rome est une cité. Le monde conquis par les Romains vit comme aujourd'hui les dominions du Canada : en état d'autarcie. Dans chaque cité, ce sont les notables qui commandent. Le pouvoir central n'a pas à se mêler des affaires de la cité. Il n'intervient que lorsque surviennent des troubles. Disons que Rome n'instaure pas l'équivalent d'un préfet. On pourrait parler d'un Commonwealth de cités. Rome n'a qu'une seule particularité, par rapport à la Grèce : un instinct de commandement.
D'où vient-il ? Pourquoi ne le trouve-t-on pas chez les Grecs ?
P.V. Il est difficile d'affirmer avec certitude d'où vient cet instinct. Je ne crois pas une seconde à l'idée, véhiculée par les historiens italiens notamment (chez qui l'empreinte marxiste est très forte), qu'il s'agit d'un intérêt de classe. Il faut chercher du côté de la psychologie : je suppose qu'il y a chez les Romains une conception spontanée de la sécurité et de la politique étrangère qui consiste à tout faire pour que Rome ne soit pas menacée. Pour cela, les Romains ont mis fin à toute forme de politique étrangère : ils ont absorbé tout ce qui était autour d'eux. Rome s'est ainsi retrouvée seule au monde. C'est une attitude que l'on peut comprendre : si vous devez mener une politique étrangère, c'est-à-dire des relations diplomatiques, avec un voisin qui vous fait sans cesse des ennuis, l'une des solutions consiste à le conquérir - il n'y a alors plus de

Vous montrez que l'on ne peut réduire l'Empire gréco-romain à la volonté de conquête. Il se met en place une forme d'absorption des cultures au sein de l'Empire. Peut-on parler de ce que l'on appelle aujourd'hui le multiculturalisme ?
P.V. Non, je parlerais plus volontiers de collaborationnisme. L'idée consiste à ne rien changer aux mœurs du pays que vous venez de conquérir, à ne faire aucun prosélytisme. Les Romains n'ont donc pas répandu la civilisation romaine, laquelle n'existe d'ailleurs pas. Il faut aussi rappeler que tout le monde avait déjà adopté la civilisation grecque : elle s'était développée d'elle-même. Les pouvoirs locaux savaient donc que Rome les laisserait en place. Mieux encore : ils savaient que toute révolte contre eux serait considérée comme une révolte contre Rome et serait sévèrement réprimée. D'une certaine manière, ils étaient garantis. Cette collaboration fut un des ressorts les plus répandus et les plus efficaces.
Les citoyens de cet Empire se sentaient-ils gréco-romains ?
P.V. Cela dépend des régions. Un Syrien se dit syrien d'abord, et précise ensuite : fidèle sujet de

Il n'y a donc que peu d'unité dans cet Empire ?
P.V. Aucune, même ! Aucun patriotisme de masse. Seuls les notables et les lettrés se sont fait une grande idée de Rome lorsque les Barbares ont menacé.
Mais peut-on parler de cet Empire gréco-romain comme d'un tout ?
P.V. Oui, car les Grecs, bien qu'ils se considèrent très supérieurs aux Romains, sont contents de la domination romaine puisqu'elle garantit le règne de la bonne société, des notables, et que Rome les défend contre les Barbares qui vivent de l'autre côté de l'Euphrate. L'empereur n'a pas de nationalité ; il est

Quelle est la spécificité du mandat de l'empereur ?
P.V. L'empereur doit d'abord être clairement distingué du roi. C'est un grand citoyen qui, avec son clan, a pris le pouvoir pour gouverner, protéger et défendre la chose publique, c'est-à-dire l'Empire. Il ne se réclame d'aucun droit mystique pour gouverner, comme le feront les Germains. Il est au pouvoir et tout le monde trouve cela très bien. Tant que ça dure... Il n'est qu'un mandataire. Mais dire qu'il est mandataire du peuple romain est une autre façon de dire que, s'il ne se conduit pas bien, il sera vidé et remplacé par un autre. Et comme la seule sanction en politique romaine est la mort, son éviction coïncide fatalement avec son assassinat.
Est-ce pour cela que si peu d'empereurs moururent de mort naturelle ?
P.V. Oui, en partie. Mais aussi parce que le sénat, qui était la classe gouvernante, était composé de cinq cents familles à l'intérieur desquelles n'importe qui pouvait devenir empereur. Il lui suffisait de proclamer publiquement qu'il était le meilleur et qu'il allait sauver l'Empire... Il ne rencontrait aucune des oppositions qui existent aujourd'hui, du type des syndicats ou même des partis politiques. D'autre part, le moindre mécontentement donne lieu à une révolte. Les soldats mécontents de la soupe ou les propriétaires fonciers mécontents de l'impôt prennent le premier notable venu et hurlent partout qu'il vient de se proclamer empereur. La plupart du temps, ce n'est pas vrai mais le pauvre type n'a plus qu'à essayer de sauver sa peau car il sait que dès que la rumeur aura propagé la fausse nouvelle il y passera... On peut dire que la forme d'opposition des populations consiste à faire un empereur, et souvent malgré ce dernier. C'est un acte de résistance dans un monde où il n'y a pas d'opposition possible de l'opinion. D'où une série de batailles pour le pouvoir.
L'empereur Marc Aurèle envisagea-t-il vraiment de rendre le pouvoir au sénat ?
P.V. C'était le vieux rêve d'un philosophe. L'empereur n'a aucun droit à gouverner : il est au pouvoir parce qu'il l'a pris. Il n'a pas l'autorité sublime du roi : il n'est pas né tout-puissant, il l'est devenu. Cette idée

Quel fut l'apport de Rome ?
P.V. D'abord l'idée, sublime, d'une vaste réunion de territoires tenus par un homme digne de ce pouvoir. Cette idée survivra jusqu'à Charlemagne et aux empereurs d'Allemagne. La notion d'empire a tenu à peu près aussi longtemps que celle de cité, qui a tenu de 2000 avant J.-C. à 500 de notre ère. Ensuite, l'idée que

Comment autant de violence a-t-elle pu cohabiter avec autant de beauté : l'art, la philosophie, la poésie...?
P.V. La grande époque de la littérature grecque est en effet celle de la guerre du Péloponnèse. Les Grecs étaient, en fait, plus militaristes et guerriers que les Romains : les guerres entre cités n'ont jamais cessé. L'état de guerre était l'état normal de la société, du coup les artistes savaient ce que signifiait la brièveté de la vie et se lançaient davantage dans la création.
Le poète Horace avait-il raison d'affirmer que «la Grèce conquise a conquis son sauvage vainqueur puisqu'elle apporte chez lui les arts» ?

P.V. Oui, certainement. Mais Rome a ajouté au génie artistique grec le génie politique : l'autorité et le sens de la règle du jeu en politique sont romains. Et cette règle du jeu s'est perpétuée jusqu'à nous. Son principe est très simple : une grande collectivité obéit certes aux clans et aux pouvoirs sociaux mais il faut aussi suivre un certain nombre de règles de droit public.
À quoi ressemblait la vie économique ?
P.V. La masse de la population, à Rome, vivait avec l'équivalent d'un ou deux dollars par jour. Et on construisait le Colisée ou bien des aqueducs ! Ces derniers ne servaient d'ailleurs pas à grand-chose : à une partie des bains publics. Il y avait donc les milliardaires et les pauvres. Mais si, dans une société, vous atteignez un niveau de vie moyen plus élevé, apparaît alors une large classe qui remplace la plèbe : la bourgeoisie. Or, les bourgeois ne sont pas respectés : ils ne sont pas assez riches pour fasciner les pauvres et un mouvement social des prolétaires se développe assez rapidement en réaction contre leur pouvoir. En réalité, les bourgeois sont assez riches pour pouvoir dire qu'ils ne veulent pas de maître mais trop pauvres pour fasciner les vrais pauvres. Ils se mettent donc à réclamer la démocratie, le pouvoir de contester tel souverain, de le renvoyer... À Rome, ça les aurait envoyés aux galères ! A Rome, il n'y a qu'une mince classe moyenne. L'affaire se divise entre les grands et le peuple, exaspéré.
Quel était le statut de la religion ?
P.V. Il n'y en a pas. S'adressent aux dieux ceux qui veulent le faire. Les dieux sont considérés comme une nation supérieure et étrangère. On peut les prier si on en a envie, et on le fait parce que c'est la coutume. Mais il n'y a pas d'organisation ecclésiastique, pas de pape et chacun adore le dieu qu'il veut. À Athènes comme à Rome. Les dieux sont des voisins. Mais il est vrai qu'il n'y a pas eu, à Rome, d'âge des Lumières.


Justement, les Romains ont-ils cru en leurs mythes ?
P.V. Absolument pas. Un lettré romain ne croit pas une seconde que la mythologie est vraie. Les dieux sont comme les saints du Moyen Age : on leur invente une personnalité et cette personnalité leur sert de biographie. On écoute la légende, qui est une belle histoire, mais on n'est pas obligé de croire à la légende.
Les Romains étaient-ils des débauchés et des individus dépolitisés ?
P.V. Non, pas du tout. Encore une image d'Epinal! Il ne faut pas lire trop de bandes dessinées...
Alors pourquoi l'Empire gréco-romain s'effondre-t-il ?
P.V. À la suite d'une série d'accidents. Mais il n'y a jamais eu de décadence romaine. Aucune. L'Empire a, au contraire, été très énergiquement reconstruit aux alentours de 300 par les tétrarques, et autour de 310-320 par Constantin. Les Romains ne sont donc nullement des dégénérés ou des avachis langoureux. Ils seraient plutôt complètement hystériques ! Ce sont des furibards ! L'accident est le suivant. Il n'existe peut-être aucun pays au monde où la longueur de frontière, rapportée à la surperficie, est aussi disproportionnée. La Méditerranée est un trou énorme au milieu d'un Empire de 60 millions d'habitants. Et avec des Barbares tout

Aujourd'hui, que reste-t-il à découvrir sur l'Empire gréco-romain ?
P.V. Beaucoup de choses mais il faudra le faire par conceptualisation plus que par des recherches sur le terrain ou par l'étude de documents. Travailler sur la sexualité, par exemple. Rome, c'est l'amour. J'entends encore Michel Foucault me dire: «Ecoute, Veyne, tu ne crois pas qu'au fond il y a eu trois périodes : les plaisirs antiques, la chair médiévale et le sexe des modernes ?» Il s'agit d'apercevoir comme étrange un phénomène que l'on avait jusque-là tenu pour banal.
Le combat pour le maintien du latin et du grec dans le secondaire est-il le vôtre ?
P.V. Non, pas du tout. Pour être franc, je m'en fous complètement.
Comment !
P.V. Il serait plus utile que les enfants étudient l'allemand plutôt que le latin et le grec : c'est une langue à déclinaison difficile. Je ne crois pas que savoir le latin fasse mieux connaître le français. Par contre, connaître le bon français facilite la compréhension du latin. Combien d'étudiants en grec et latin peuvent-ils lire couramment les poètes latins ou grecs ? Je lis la prose grecque mais pas la poésie grecque car c'est un langage très différent du grec usuel, très compliqué. Quand un Grec fait de la littérature, il n'écrit pas en grec mais en prose d'art, et quand il écrit de la poésie, il use d'une langue spéciale. Cela dit, je n'ai pas envie de fâcher les défenseurs du latin et du grec à l'école : ce qui est important n'est pas de maintenir le latin et le grec mais qu'il y ait à chaque génération et dans chaque pays cinq cents types capables de traduire du latin et du grec.
Mais pour cela, il faudrait commencer dès le secondaire, non ?
P.V. Mais non !
Bon. De quelle philosophie gréco-romaine vous sentez-vous le plus proche ?
P.V. Aristote. C'est mystique ; il est snob et aristo, vit dans l'utopie complète... Mais sa philosophie me plaît : une bonne gymnastique dont le but est de nous habituer à l'abstraction.
http://histoireparis8.canalblog.com/archives/2006/05/26/1...
L'Empire gréco-romain
Paul Veyne
Seuil, 2005
Prix : 25 € / 163,99 FF
Je précise que cet article n'est pas de moi (lien vers la page citée et si possible son auteur)mais que je suis auteure et que vous pouvez commander mes livres en cliquant sur les 11 bannières de ce blog

