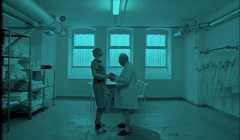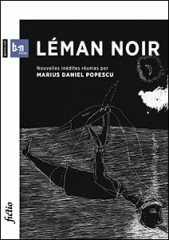Lettres bleues et or.
De Daniel Vuataz, dit le Kid, à JLK, dit le Papillon.
Des tribulations du Kid au Service civil. De son blues au milieu des mecs. D'une réunion de jeunes auteurs au Val d'Aoste. Des sottises brassées par le succès de Joël Dicker. De la vie qui va, des potes qui voyageent et d'un accès de mélancolie
Schwarzenburg, le 29 novembre 2012
Cher Oldie,
Je suis pris au piège. La neige se mêle à la pluie en cette fin de soirée fédérale. Des silhouettes encapuchonnées circulent, la braise orange aux lèvres, entre les deux gros dortoirs du Centre d’instruction pour civilistes de Schwarzenburg. Quelques fenêtres sont illuminées. Un automate à soda clignote bêtement, la baie vitrée de la salle de cours de « Résolution des conflits sans violence » lance des lumières bleues et jaunes. Trente bicyclettes rouges, estampillées Zivildienst Schweiz, dégouttent dans l’herbe sombre. Les lumières du sinistre village, à deux kilomètres, transpercent parfois le crachin qui recouvre les forêts noires et mes pensées black. Un trou à rat, crois-moi, voilà d’où je t’écris. Je perds mon temps. A l’étage du réfectoire, musique sur les oreilles et thé en main, je reste assis de longues soirées mortes. Un groupe de Suisses allemands joue au billard. J’entends les billes de porcelaine s’entrechoquer et rouler sur le tapis de velours. Des rires gras viennent de la mezzanine. Un type en shorts noirs sort courir dans la buée. Ça sent le cordon bleu et les frites molles. Je pourrais être ailleurs. Je devrais être ailleurs. Mais non, voilà une semaine que je me dépêtre dans ce sac de nœuds coulants.
Le temps : je t’ai laissé sans nouvelles depuis trois mois. Et ces cinq seuls petits jours passés ici, à Schwarzenburg, me semblent déjà mille fois moins supportables, et mille fois plus longs ! J’ai avec moi un vieil ordinateur qui ne veut plus tellement être transporté, quelques habits inadaptés, des films de zombies et le gros machin de Dicker. Toi, tu connais bien la valeur du temps : le sablier majestueux de ton balcon à phalènes, face à la France ; les ellipses fulgurantes de tes lectures partagées diffusées dans toutes les directions de la blogosphère ; la dilatation des nuits faibles et les sursauts de nos sommeils paradoxaux, tout ça, tu le connais. Moi je ne savais pas. Que le temps pouvait être lent à ce point. Frustrant. Insupportable. Dicker ? Peut-être que je devrais tenter d’y entrer maintenant, dans son roman dont tout le monde parle depuis quelques semaines, peut-être que je devrais m’y plonger, m’y glisser comme dans une chaussette propre et me laisser porter par le temps de Dicker, celui de l’Amérique, de la narration, pour oublier celui qui m’oppresse ici ? Peut-être que c’est le bon moment ? Je pourrais alors te raconter, au jour le jour, mes impressions de lectures. Confronter mes notes aux tiennes. Mais va savoir pourquoi, j’hésite. A la place, je t’écris, à toi.
Dicker : on en a beaucoup parlé à Aoste le week-end passé. Un éditeur des Préalpes fribourgeoises a fait miroiter son nom (un peu obscène) devant la petite dizaine de lauréats réunis de l’autre côté du tunnel du mont Blanc le temps d’une cérémonie : celle du PIJA (Prix Interrégional Jeunes Auteurs, créé par les Editions de l’Hèbe), dont je m’occupe depuis quelques années. On y a érigé son livre en modèle éditorial, économique, on a fait du parcours de Dicker la panacée de l’écrivain « romand », celui qui brise le signe indien, qui fait mieux que quiconque avant lui. Celui qui inaugure l’ère – mais y en aura-t-il d’autres pour qu’on puisse parler de phénomène ? – des écrivains « de chez nous » qui créent le buzz à Paris. Et bientôt dans le monde. Hollywood n’est pas loin. J’ai compris ta leçon : je n’en parlerai pas avant de l’avoir lu, ce livre. Mais j’aime bien l’enthousiasme qu’il suscite chez les jeunes et les académiciens, hors des discours habituels. Bon, c’était un peu mauvais ton de dénigrer Frochaux publiquement comme l’a fait Dicker, mais c’est sûr que pour lui, revendiquer la figure de feu Dimitri, qu’il confesse avoir vu « une fois avant la sortie du bouquin », c’est plus costaud, niveau légende et légitimité. J’ai un ami libraire un peu cynique qui a une théorie : il prétend que « les gens qui ne lisent pas » forment une catégorie exigeante, et que cette catégorie attend, tous les deux ou trois ans, qu’on leur désigne un bon gros livre qu’ils pourront « lire » sans avoir à choisir dans la production, ou qu’ils pourront acheter et poser dans leur bibliothèque (majorité de Folio et de hardcovers traduits), ou qu’ils pourront éventuellement offrir, parce qu’on leur aura bien expliqué qu’il s’agit du bon objet, chiffres et critiques se combinant à merveille. Dicker, ce serait ce livre. Right time, right place. On en pensera ce qu’on voudra… Moi je ne retiens que ce qui m’arrange : on découvre soudainement, les bras ballants, qu’on écrit bien (ou plutôt, dans ce cas, qu’on raconte bien des histoires) quand on a 26 ans et qu’on habite (tout juste) en Suisse romande.
Laisse-moi te dire deux mots d’Aoste, encore, si tu veux bien. Ce Prix jeunes auteurs a le génie de proposer un week-end complet à ses lauréats (en plus de récompenses en espèce). Il sait susciter les rencontres, les contacts, les découvertes. L’AJAR, pour bonne partie, n’est pas née d’autre chose. Il y avait cette année des Français, des Belges, des Suisses, une Lettone, une Argentine, des Valdôtains. Le ciel bleu et dégagé laissait passer des nuages rapides au-dessus des petits villages enrochés. Pendant quatre jours, on a causé, écrit, mangé du saucisson, bu du Petit rouge et de l’Arvine locale, visité d’étonnants châteaux transformés en musées d’art moderne, des charcuteries familiales, des caves immenses, des coopératives, des sculpteurs sur bois peint, des cafés-librairies, on a flâné dans les ruines nettoyées par la Restitution ou logées sous les montagnes ou posées en plein cœur des villes, on a parcouru de long en large ce drôle de Valais parallèle, un peu plus sauvage, un peu moins bétonné, un peu plus sinueux que le nôtre. Le premier prix de cette année (un Valaisan justement), répondant au nom un peu ramuzien de Lucien Zuchuat, nous a bluffés. Son texte, pour commencer : La Jeune fille et les néons est une pièce de théâtre claire obscure, dure et poétique, un conte noir sur la jeunesse urbaine, la fin de l’innocence, la perversion sourde des rapports humains, l’angoisse des adultes. Une œuvre intense qui possède des vraies qualités, un style sûre, une histoire. Et qui se joue bien. En plus, Lucien a une gueule d’ange. Il paraît qu’à l’autre bout du lac c’est un argument béton pour vendre un quart de million d’exemplaires en trois semaines. Je ne crois pas trop m’avancer en te disant que Lucien Zuchuat, tout comme d’autres jeunes auteurs de la volée du PIJA 2012, possède ce qu’il faut pour se faire une place. They’ve got what it takes, comme on dit dans les bons rom-coms américains. L’éditeur a d’ailleurs répété tout le week-end, à qui voulait l’entendre, que Dicker lui aussi est « issu » du PIJA : promotion 2005, eh oui. Tu devrais essayer de mettre la main sur son « Tigre » d’alors, la nouvelle sibérienne qui avait charmé Anne-Lise Grobéty et ses compères du jury final (au point que des suspicions de plagiat avaient flotté sur le texte pendant une partie des délibérations…) Je ne sais pas si Joël s’en souvient. En tout cas, à lire son site web, ce texte et ce prix marquent le vrai début de la carrière du juriste prodige. Sera-t-il le chef de file de cette relève que tu as décrite en partie dans ton dernier Passe-Muraille, et qu’au regard de « l’histoire » tu as malheureusement sorti six mois trop tôt ? Cette relève qui possède un point commun troublant : ce fameux PIJA. Fais le compte : Burri, Fournier, Rychner, Flükiger, Urech, Dicker, et la moitié de l’AJAR… On écrira peut-être cette histoire un jour. Bon, il y a aussi des anomalies : Quentin a essayé mais s’est fait recaler. Comme quoi…


Cette nuit il a neigé sur tout l’Oberland, pour de bon. Les alentours en sont allégés, l’atmosphère plus supportable. Le huis clos s’éternise. Je ronge toujours mon frein, oscillant entre amusement détaché, cynisme placide et dévissages intérieurs. Je me dis que c’est comme ça qu’on formate des esprits : non pas pour la guerre ou la survie ou la dureté ou une quelconque idéologie totalitaire, comme de l’autre côté, mais (est-ce pire ?) pour la petite citoyenneté bien pensante, fière, dénuée de tous préjugés et équipée d’outils psychologiques faits de bric et de broc peints à la sauce fédérale. Une bombe de conneries à retardement. Tu devrais nous voir jouer aux apprentis « médiateurs », reproduisant nos schémas simplifiés, nous érigeant doctement contre les violences qui nous entourent. Le retour de manivelle sera terrible. Toi qui prévois un grand livre sur la Suisse, toi qui l’ausculte sous toutes ses coutures, ses filigranes et ses faux-fils, ne rate pas ce chapitre encore trop méconnu (ces centres d’instruction pour civilistes sont tout nouveaux) : certes, le Service civil est une alternative intelligente à l’obligation militaire (ce n’est pas moi qui dirai le contraire), mais cette semaine de cours préalable est une énormité qu’il ne faut pas laisser passer.
L’étang au milieu des baraquements a disparu sous la neige, à présent. Il fait nuit. Camille m’a dit qu’à Lausanne le ciel était de plus en plus gris, mais qu’il ne tombait toujours rien. J’imagine que sous ton chalet, par contre, les pentes sont aussi blanches qu’ici. Peut-être que tu sors fumer sous le balcon, que tu tires sur un de tes petits cigarillos ou que tu prends des notes dans ta cuisine, attablé devant une omelette aux pommes. Ici, le courant est coupé par l’intempérie depuis le début de matinée. Ça dure encore : la cafétéria est à présent un bunker éclairé aux chandelles et aux lampes de secours. Des types à moustache s’activent. Mon gros camarade de chambre est parti faire la sieste dans la cellule en béton. J’écoute les Andrews Sisters swinguer leurs ballades, attablé à côté d’une pile de journaux. J’écoute de la milongas, j’écoute de l’électro danoise. Je crois que je couve une petite mélancolie. Et un feu de révolte froide.
Peut-être parce que je viens de jeter un œil sur les derniers articles de Matthieu sur son blog, sa traversée de l’Atlantique en cargo et son arrivée à New York, ses errements dans la Grosse Pomme hipster, ses photos merveilleuses ; autant de choses qui me rappellent que je pourrais y être, moi aussi, de l’autre côté du miroir atlantique. J’aurais dû poursuivre sur ma lancée. Je t’ai parlé un peu du Pays basque, déjà, en sa compagnie. De nos expériences de couch surfing épatantes dans les Bardenas Reales, à San Sebastian, à Saint-Jean-de-Luz. Il y a des amitiés qui comptent, et qui se décident sur quelques coups de dés. Tu sais ça.
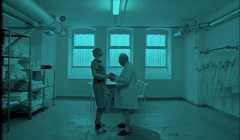
Ensuite il y aura juin. Un nouveau tournant, je crois. Je t’en parlerai, comme de mille autres choses, mille autres projets, mille autres chemins de traverses et faux-fuyants fous qui nous projettent dans toutes les directions. L’AJAR qui s’active, échappe aux « composantes séculaires » d’ici avec bonheur, je crois. On prépare une lecture autour de Lovecraft et de la peur, prévue dans l’obscurité la plus totale ! En 2013 on fêtera Cendrars et le centenaire de sa Prose du transsibérien. Il y aura un Persil de luxe sur la nouvelle constellation des petits éditeurs romands avec l’ami Vincent. De nouveaux livres, de nouveaux auteurs, de nouvelles planètes, de nouveaux novembres insipides aussi, forcément, de nouvelles déceptions. Il faudra garder les épaules bien serrées et ne pas perdre pied quand la vague se brisera, juste devant moi, juste devant toi, juste devant le Jura. C’est une surfeuse de San Sebastian qui nous l’a enseigné, à Matthieu et à moi, alors que nous buvions l’Atlantique à gros coups de planche en mousse. Il n’y a pas de place pour le répit, je crois. Ni pour la glorification.

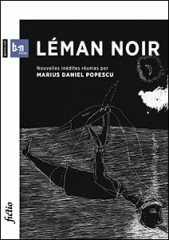
A un de ces jours, cher vieux, prends soin de tes jeunes osses et de ta bonne amie !
Le Kid