Steve Mcqueen - Once upon a time
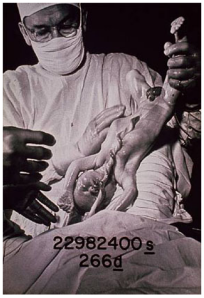
[Notes : Revenir brièvement sur la guerre franco-prussienne qui court du 19 juillet 1870 au 29 janvier 1871. Ignorer la chose militaire elle-même, les motivations « diplomatico-stratégiques » qui la travaillent – on prête à Bismarck l’intention du prétexte d’une guerre pour réunir l’Allemagne[1] – ou les manœuvres et les mouvements de troupes qu’elle calcule, pour s’occuper de ce qui intéresse la Commune : les conséquences de cette guerre sur le clivage terrifiant qu’on a pressenti dans la partie précédente…
S’arrêter sur les chiffres. On compte 265 000 soldats français face à près d’un million d’Allemands[2]. Cette estimation prend curieusement l’échelle basse pour le côté français et haute pour celui allemand… Grossièrement, au début de la guerre on aurait quelque chose comme 265 000 soldats français et 500 000 soldats prussiens, puis après la mobilisation et le rassemblement des États allemands, on aurait 900 000 français contre 1 200 000 allemands et prussiens[3]. Bref… Noter que « Les Allemands l’emportaient en outre sur leurs adversaires par la supériorité de leur artillerie »[4]…
Avant de poursuivre, s’attarder sur ces descriptions de Zola dans la Débâcle d’une organisation ahurie de l’armée française : une attente à n’en plus finir, où les généraux ne savent plus quoi faire pour occuper les hommes[5] ; des troupes qui s’avancent jusqu’à l’Aisne pour reculer vers la vallée de la Marne à l’approche de l’ennemi ; des jours, des semaines à attendre et à tourner et tourner encore… Et des corps épuisés, affamés, plus même capables de se tenir debout au moment où il s’agit finalement de se battre… « Il n’y avait donc ni direction, ni talent militaire, ni bon sens ? »[6] fait-il se demander à un soldat qui n’en peut mais de reculer encore… Et de s’interroger : « C’était donc vrai que cette France, aux victoires légendaires, et qui s’était promenée, tambours battants, au travers de l’Europe, venait d’être culbutée du premier coup par un petit peuple dédaigné ? »[7].
Noter encore une phrase de ce roman pointant un soupçon qui va venir tracasser la France : « Oui, oui ! on les avait amenés là pour les vendre, pour les livrer aux Prussiens. Dans l’acharnement de la malchance et dans l’excès des fautes commises, il n’y avait plus, au fond de ces cerveaux bornés, que l’idée de la trahison qui pût expliquer une telle série de désastres »[8]. Ne pas se prononcer sur la question de savoir si ces soupçons de trahison sont le fait de cerveaux bornés ou un goût que l’on retrouve souvent qui veut qu’on ne sache pas s’expliquer l’accident, l’impuissance, autrement que par le complot, c’est-à-dire que l’événement accidentel doit forcément être contrôlé par quelqu’un quelque part, un dieu, une malice, autre. Le corps humain ne connaît pas la passion. Peu importe… Toujours est-il que le soupçon est posé. ]
[Incise : Si la révolte tient de l’acte politique, l’acte politique tient de la parole. La parole en tant qu’outil de perception : se révolter c’est percevoir et, ou, être perçu. Il y a des cours proliférants d’effectuations et la perception qu’à un moment ces cours se fracassent. La perception nous dit qu’il y a événement, forcément, mais l’intelligence ne se résout pas à trancher et à découper arbitrairement… On pourrait penser par intensités : il y a des protestations dont l’intensité franchit le seuil de la révolte, et déterminer les seuils… Mais ce serait encore accommoder, tordre, corrompre, plier le cours proliférant à l’usage de la langue et de la pensée. J’insiste : le point de passage n’est qu’affaire de perception et de parole. S’il ne s’agissait que de praticité et de commodité… Mais c’est que le mot est voué à se faire axiome et dogme. Poser le mot, c’est déjà ne plus pouvoir s’en dépêtrer. Et nous voici avalés, ravis par un délire de paroles qui vient poser ici le mot révolte, là son différentiel, puis le différentiel du différentiel et ce qui semblait fait pour flatter notre perception en se pliant à sa façon, déjà nous bouche la vue… Je veux dire : même le corps révolté, travaillé par ses perceptions et ses paroles, ne saurait plus s’y retrouver… La parole ne doit pas être faite pour désigner mais pour pressentir ; on ne pose pas des certitudes, on esquisse des intuitions, on dégage des incertitudes inaperçues… Des mains négatives… La parole suggère qu’il y a là quelque chose qu’on ne sait pas, qu’on ne sait pas tenir dans ses mains.]
[Notes : Poursuivre la récolte d’éléments utiles à notre étude quant à cette guerre… Le 2 septembre, Napoléon III capitule et est arrêté à Sedan. Le 4, des mouvements du Peuple à n’en plus finir, on y reviendra, proclament la déchéance de l’Empereur et la Troisième République. Un gouvernement provisoire, le gouvernement de la défense nationale, est nommé.
Relever ce passage, issu d’un livre disons discutable, qui résume les événements qui suivent : « Trois temps, fort inégaux, vont alors se succéder : celui de l’euphorie républicaine qui se brisera sur la volonté de Bismarck, celui de « la guerre à outrance » mené par Gambetta dans un style plus politique que militaire, puis, devant la famine qui menace Paris, la signature, mais aux conditions de Bismarck, de l’armistice »[9]. Mais on est loin d’en être là…
S’arrêter sur la perception de la chose… D’abord la composition de ce gouvernement, les généraux de son armée, ses administration, qui ne sont pas faits pour inspirer confiance aux républicains. Par exemple, à la date du 28 janvier 1871, on peut lire dans le Rappel : « ‘République française’. Je vois bien ce nom sur les murs, sur les affiches, au fronton des monuments et au début des proclamations. Mais je cherche vainement la chose. Le mot « République » est partout; les actes républicains ne sont nulle part. Étant donnée la situation, qu'est-ce que le gouvernement de la défense a fait, que l'empire n'eût pas fait comme lui ? »[10]…
Mais surtout les accusations de connivence ou de trahison enflent…
Dans son étude sur le journal communard le Cri du Peuple, Maxime Jourdan note : « Du 22 février au 12 mars, on relève 12 occurrences du verbe ‘vendre’ et 20 occurrences du verbe ‘livrer’ »[11]. Une dernière bataille, le 18 janvier 1871, lancée par Trochu, celle de Buzenval, perdue d’avance, les convainc qu’on mène le peuple à la mort, sciemment, pour s’en débarrasser… : « ‘Le plan de M. Trochu, écrit Jean-Baptiste Clément, était une série de désastres et de capitulations prévus et médités par les hommes de l’Hôtel de Ville, revus et corrigés par de Moltke et Bismarck’ (Le Cri du Peuple, J.-B. Clément, 5 contre 1, 5 mars 1871). De cette assertion naît une idée-force, répétée par le journal comme une antienne : la France n’a pas été défaite, Paris n’a pas capitulé, ils ont tous deux été « livrés, vendus » par des hommes qui pouvaient vaincre mais qui ne l’ont point voulu. »[12].
S’arrêter sur le soupçon d’entente avec l’ennemi.
Passer sur le compte-rendu des entrevue entre J. Favre et Bismarck, dont la publication est dirigée par celui-là, qui a quelque chose qui tient plus d’une mise en scène où il tente de se justifier et d’accuser les autres Nations[13].
Et s’attarder sur l’accusation qui aura été la plus fracassante, celle qui concerne la défaite de Bazaine à Metz. Gambetta lui même parle de trahison[14]… Remarquer que le ressentiment de cette défaite est forcément à la mesure de l’espoir, le dernier, qui s’effondre… On ne comprend pas qu’on ait perdu Metz autrement que par malice. Et voilà qu’on découvre une note que le Maréchal adressait au quartier général prussien : « La question militaire est jugée et Sa Majesté le roi de Prusse ne saurait attacher un grand prix au stérile triomphe qu’il obtiendrait en dissolvant la seule force qui puisse aujourd’hui maîtriser l’anarchie dans notre malheureux pays. Elle rétablirait l’ordre et donnerait à la Prusse une garantie des gages qu’elle pourrait avoir à réclamer. »[15]. La question est posée : les généraux, le gouvernement, préfèrent-ils s’entendre avec l’ennemi pour écraser les républicains ?
On s’étouffe. Un type effarouché, qui doit s’ennuyer assez pendant le siège pour consigner tout ce qui lui passe par la tête, note dans ses carnets des propos qui seraient tenus au cours séances de Clubs parisiens où on prononce à l’unanimité la condamnation à mort par contumace contre « le traître Bazaine »[16].
Bazaine sera traduit devant le conseil de guerre… Récapituler.
Regarder ce qui lui est reproché. Les républicains l’accusent d’avoir livré Metz aux Prussiens par peur du Peuple. Le gouvernement, le corps militaire, ne comprennent pas la capitulation, qui paraît précoce, de Metz alors que des pourparlers sont en cours. Insister sur la distinction.
Noter que la note découverte ne prouve pas la trahison. Bazaine a pu utiliser un argument qu’il imaginait pouvoir être entendu par les Prussiens pour les convaincre d’épargner ses troupes, censées être à même de rétablir ou maintenir l’ordre. Ce qui étonne, c’est la capitulation avant même de s’être battu tout à fait et les contacts avec l’ennemi lors même que le gouvernement négocie de son côté…
Dans un extrait du conseil de guerre devant lequel il est traduit, on peut lire le Président s’interroger : « En somme, vous aviez les indications de tentatives faites sous des formes diverses de négociations dont la paix aurait pu être la conséquence. Vous ne deviez pas ignorer que le plus sûr moyen d’assurer les négociations était de prolonger la résistance et que c’était aussi le moyen le plus sûr de les faire réussir… »[17]…
Ce président examine ses motivations et revient sur cette question d’ordre social. La réponse de Bazaine est piquante : « P. : Dans la proclamation que vous avez adressée à l’armée, je lis les lignes suivantes : ‘Continuons à servir la patrie avec le même dévouement et la même énergie, en défendant son territoire contre l’étranger, l’ordre social contre les mauvaises passions.’ Ne pensez-vous pas que la seule préoccupation d’un commandant en chef devait être la défense du territoire ? L’ordre social n’était pas menacé à ce moment et il y avait 400 étrangers sur le sol national.
B. : Je considérais l’ordre social comme menacé, par la révolution seule du 4 septembre. » [18]. Préciser que le président fait référence à une proclamation faite par Bazaine après qu’il a réuni les commandants de corps le 12 septembre 1870…
Laisser le lecteur conclure. Noter simplement qu’ il sera condamné à mort avec dégradation militaire pour avoir capitulé en rase campagne, traité avec l'ennemi et rendu la place de Metz avant d'avoir épuisé tous les moyens de défense dont il disposait[19]. Préciser que la peine sera commuée en vingt ans de prison, avant qu’il ne parvienne à s’évader et trouve refuge à Madrid.
Faire le point.
Relever, dans les paramètres qui encadrent l’action du gouvernement et des généraux, ces préoccupations : la négociation de paix, la peur de l’insurrection du Peuple…
Noter cette déclaration du général Ducrot au cours de son audition par une commission parlementaire : « Il faut le dire : il y avait là deux idées qui dominaient tout. L’une, c’était l’espoir de la paix pour beaucoup. Du moment que M. Thiers était en pourparlers avec M. de Bismarck, on espérait, qu’en confirmant les pouvoirs du Gouvernement de la défense nationale et surtout du général Trochu, qui pour beaucoup était l’arbitre de la situation, on avait des chances d’obtenir la paix ; puis la seconde idée, c’était l’espoir que le Gouvernement puiserait dans ce vote assez d’énergie pour dominer complètement le parti insurrectionnel. »[20]. Et plus loin, on peut voir qu’il mesure la méfiance que la défaite va provoquer : « Les gens de Belleville […] peuvent donner à leur soulèvement un prétexte auquel les uns se laisseront prendre, et que les autres exploiteront. Ils diront, comme ils le disent déjà, que la paix, au prix qu’elle a coûté, est une lâcheté, un crime contre la nation, et ils trouveront des hommes résolus. »[21].
Remarquer que ce « prix » que coûte cette guerre est épinglé par Trochu, président du gouvernement provisoire, qui raconte dans ses mémoires qu’à ses collègues qui insistent pour parler de « négociations pour un armistice »… il dit répondre : « Oui, ce sera notre euphémisme gouvernemental vis- à-vis des Parisiens ; mais soyez sûrs que lorsqu’une cité renfermant deux millions et demi d’habitants, qui vont notoirement mourir de faim, entre en négociations pour un armistice, elle capitule, et capitule à merci. C'est une cruelle réalité dont il faut que nous sachions envisager les effets. »[22]…
Noter pour l’anecdote que dans une lettre Flaubert affirme que les bourgeois se rassurent de l’approche des Prussiens : « ‘Ah ! Dieu merci, les Prussiens sont là !’ est le cri universel des bourgeois »[23].
Se demander, s’ils avaient si peur d’un Peuple auquel Napoléon III avait donné des armes en lui ouvrant la garde nationale en 1868, pourquoi ne pas tenté de récupérer les fusils en les rachetant comme en 1789 par exemple[24]…
Se dessine donc quelque chose qui oppose la défiance des républicains quant à la trahison supposée du gouvernement et de son armée et la peur de la bourgeoisie quant aux républicains qui perdent patience et nourrit les soupçons de ceux-ci en réduisant les marges de manœuvres de ceux-là face aux prussiens… [reprendre cette phrase dont la construction est bizarre…].
[Notes : on voit la limite de la méthode utilisée pour cette partie, puisqu’on pioche parmi tout le matériel « guerre franco-prussienne » ce qui peut venir éclairer la chose Communarde… on est déjà en train de dérouler et de monter une sorte de raisonnement convergent vers un point, ici le point « défiance Républicains/bourgeois »… Et si on n’a pas de parti pris ou de biais ex ante, j’espère, le point fonctionne pour autant comme un parti pris, qui classe, organise, ordonne, utilise, etc. et fait entendre une voix, i.e. forcément une voix autoritaire… Essayer de continuer de procéder plutôt par touches contrariées…]
Dimanche prochain, on s’arrêtera sur le siège de Paris…
[1] Cf par ex. Alain Favaletto, Allemagne : la rupture ?, ed. L’Harmattan, 2013, p. 18.
[2] Ibid., p. 19.
[3] Ibid.
[4] Marc Debrit, La guerre de 1870, Genève, 1871, p. 74.
[5] Émile Zola, la Débâcle, bibliothèque électronique du Québec, p. 82.
[6] Ibid., p. 197.
[7] Ibid., p. 119.
[8] Ibid., p. 267.
[9] Odile Rudelle, la République absolue, publications de la Sorbonne, p. 15.
[10] Henry Maret, le Rappel, daté du 28 janvier 1871.
[11] Maxime Jourdan, Le Cri du Peuple, ed. L’Harmattan, p. 67.
[12] Ibid.
[13] Cf G. d’Heylli, Jules Favre et le comte de Bismarck, Entrevue de Ferrières, Paris, 1870.
[14] Cf la proclamation de Tours du 30 septembre 1870.
[15] Cité par exemple par J. Jaurès in Histoire socialiste, T. XI, la Guerre Franco-allemande, p. 11.
[16] Francisque Sarcey, le Siège de Paris, p. 168.
[17] In François-Christian Semur, l’Affaire Bazaine, ed. Cheminements, p. 100.
[18] Ibid., p. 97.
[19] Cf par ex. Henry Willette, l’évasion du maréchal Bazaine de l’île Sainte-Marguerite, Perrin, 1973, p. 33.
[20] Enquête parlementaire sur l’insurrection du 18 mars, T. III, Versailles, 1872, p. XII.
[21] Ibid., p. XXVI.
[22] Général Trochu, Œuvres posthumes, Tome 1, Tours, 1896, p. 543.
[23] G. Flaubert, lettre à George Sand, 30 avril 1871.
[24] cf la conférence d’Henri Guillemin sur Robespierre du 12 février 1970.
