Claude Closky - Marabout bout de ficelle...
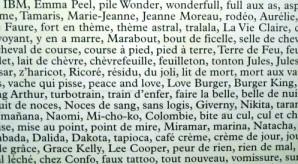
Le 20 janvier, des gardes nationaux, des camarades, des proches se retrouvent à l’enterrement d’un des leurs, le colonel Rochebrune, tombé à la bataille de Buzenval. On chuchote. Les nouvelles tombent… ou plutôt les nouvelles chutent et se fracassent… Le général Clément-Thomas, celui dont on sent encore en s’approchant l’odeur du sang des républicains qu’il fit couler, au soulèvement de juin 1848, hanter ses vêtements, ses cheveux, sa peau, prend la tête de la garde nationale. Et puis, il vient à l’idée de Jules Ferry de rationner le pain… Enfin, Vinoy, « ce complice de Bonaparte en décembre 1851 ! »[1], devient gouverneur militaire de Paris, après la démission de Trochu, qui reste quand même à la tête du gouvernement… [note : à ce moment-là, ils ignorent que Vinoy remplace Trochu (voir plus bas), modifier le début de la phrase par : On ne sait pas encore que…]. Les dents grincent et se choquent… de colère, de faim. On se tait. On regarde la terre avaler le cercueil. On repense à quelques souvenirs de notre ami. On le revoit sourire surtout. Toute cette vaillance farouche enterrée là… Et puis on voit celui-ci, ce fuyard, qui a osé venir et qui serre les mains. On ne l’a pas vu de toute la bataille… Qu’est-ce qu’il a sur la veste ? La légion d’honneur ? Ils décorent les traitres en plus ?[2]
[Brouillon : Le 21 janvier, « les délégués de tous les clubs se réunissent à la Reine-Blanche à Montmartre »[3]. On sent cette résolution ferme et sûre animer les têtes, courir sur les visages, dans les yeux, plus fixes que d’habitude, sur les lèvres, dans les poings, qui n’en finissent pas de se serrer. On décide de manifester à l’Hôtel de Ville, le lendemain. Les gardes nationaux sont invités à venir en armes[4], les femmes les accompagneront pour protester contre le rationnement du pain [Comment dire… Sic !]. Pendant ce temps, après un repérage de la prison de Mazas dans l’après midi[5] par une poignée d’hommes, soixante quinze hommes armés se retrouvent et marchent pour libérer Flourens[6]. On le conduit à la mairie du XXe, où il est adjoint. Le tocsin sonne. On proclame la Commune. Personne ne répond[7]. Quelques compagnies de garde nationale parviennent à évacuer la mairie : « à six heures et demie, l’ordre est rétabli »[8].]
[Raconter la manifestation du 22 janvier à l’Hôtel de Ville.
Noter qu’après la libération de Flourens et les appels à la déchéance de la part des républicains dans les clubs ou dans les journaux[9], le gouvernement s’inquiète. Le gouvernement fait « bonder l’Hôtel de Ville de ses mobiles bretons »[10] et Clément-Thomas fait circuler un ordre qui invite « ses camarades de la garde nationale à marcher au secours de l’Hôtel de Ville menacé »[11].
A midi, « une foule énorme »[12] pour certains, des « bandes armées peu nombreuses »[13] pour d’autres, occupe(nt) la place de Grève.
Pour Louise Michel, cette foule est « en grande partie désarmée », cependant « grand nombre de gardes nationaux avaient leurs fusils sans munitions, ceux de Montmartre étaient armés »[14]. A noter que Louise Michel, elle-même, a résolu de prendre son fusil[15]. Le témoin dont le récit est publié par Le Journal des débats, qui n’est pas favorable aux républicains, reconnaît que « les fusils étaient la crosse en l’air »[16].
D’après ce témoin, les manifestants ne semblent pas savoir que Vinoy a remplacé Trochu[17] dont il demandent la démission et s’exclament en l’apprenant que « Vinoy ne valait pas mieux »[18]. Le gouvernement ne siège plus à l’Hôtel de Ville, on sera reçu par Chaudey, un des adjoints au maire de Paris, dont « l’hostilité pour la Commune était connue »[19]. L’entrevue n’est pas… comment dire… concluante… Selon un autre témoin, toujours, évidemment, défavorable aux républicains, cité par Le Journal des débats, l’un des délégués « est redescendu sur la place dans un état d’excitation très grand »[20]. Pour Louise Michel, ces délégués ne furent pas reçus[21].
Les mobiles bretons, amassés aux fenêtres de l’Hôtel de Ville, inquiètent les manifestants : »[ils] nous regardaient, leurs faces pâles immobiles, leurs yeux bleus, fixés sur nous avec des reflets d’acier. » (Il faut toute la poésie de Louise Michel pour distinguer la couleur des yeux de ces hommes…). Certains les désignent du doigt : « Voilà les Bretons qui onttiré ou qui vont tiré sur le peuple »[22]. Le bruit se répand que Chaudey va « donner l’ordre de tirer sur la foule »[23].
Louise Michel ne précise pas d’où les premiers coups partent mais donne à penser que la fusillade vient des mobiles bretons, dont « les balles faisaient le bruit de grêle des orages d’été » [24]. Le témoin du Journal des débats indique qu’il lui est « impossible, dans la bagarre, de voir d’où sont partis les coups de feu »[25]. Pour Gustave Lefrançais la « fusillade furieuse, partant des fenêtres de l’Hôtel de Ville et des deux annexes aux angles de l’avenue Victoria, prit les gardes nationaux entre deux feux »[26]. Le second témoin du Journal des débats croit savoir que « le feu a été commandé par un des chefs insurgés, par l’ex-commandant Sapia » et de préciser : « dit-on »[27]… À noter que Sapia est tué « d’une balle dans la poitrine »[28].
Une barricade de fortune est organisée, « faite d’un omnibus renversé »[29]. Les tirs sont échangés entre mobiles bretons et gardes nationaux. Pour Louise Michel : « Certains gardes nationaux avouèrent depuis avoir tiré non sur ceux qui nous canardaient, mais sur les murs où en effet fut marquée la trace de leurs balles. »[30].
Des passants, des femmes, des enfants sont touchés. Le Journal Le Rappel écrit : « Des curieux qui stationnaient rue du Coq-Saint-Jacques et sur l’avenue Victoria ont été blessés. D’autres ont été atteints par derrière à 400 mètres du point où les mobiles ont fait feu. On ramasse les morts et les blessés. Il y a quarante blessés et vingt morts. Parmi les morts, un enfant de neuf ans. Un vieillard qui regardait de loin avec une petite lorgnette en cuivre… »[31]. Je crois comprendre que ce témoignage impliquerait que les mobiles n’ont pas pu tirer ces coups depuis l’Hôtel de Ville… On a vu que, selon des témoins, des mobiles se tenaient dans des annexes de l’avenue Victoria… Je crois que cette avenue Victoria, c’est cette petite rue qui va du Châtelet à la place de Grève… Je confirme après vérification… Ces annexes font donc face à l’Hôtel de Ville… des manifestants ou des curieux ont donc pu être touchés soit par des mobiles depuis les annexes soit par des insurgés…
Le gouvernement fait procéder à « des arrestations en masse »[32] pour les uns, ceux qui voient cette insurrection « noyée dans le sang », ou évaluées à « une centaine »[33] pour les autres, ceux qui, par ailleurs, trouvent Trochu plein de « prudence ». Selon Gustave Lefrançais, si mille mandats furent lancés, on ne put arrêter qu’une centaine de personnes… Il précise : « arrêtées au hasard dans les rues avoisinant l’Hôtel de Ville »[34], et de moquer une police qui appréhende des personnes « comme toujours, en presque totalité, absolument étrangères aux événements… ». Louise Michel cite ce passage de l’étude de Lefrançais, qui s’étend sur les conditions rudes, sévères de ces prisonniers qui attendent deux mois le jugement des conseils de guerre[35] [Note : les verbes étendre et attendre dans la même phrase… corriger…]. Delescluze, rédacteur en chef du Réveil, qui vient d’être supprimé par décret (voire plus bas), compte parmi les prisonniers[36]. ]
Le 25 janvier, le Rappel note que le gouvernement vient de signer trois décrets : les clubs sont fermés ; le nombre de conseils de guerre est doublé[37] ; et deux journaux républicains le Combat et le Réveil sont supprimés[38]. [Noter que si certains clubs sont fermés « sans difficulté » (ceux des salles Molière ou de la rue d’Arras), d’autres ouvrent « cependant leurs portes »[39]]. Charles Hugo conclut ces décisions ainsi : « Qu’est-ce, en un mot, que ces trois décrets, éternelle redite de la violence de l’autorité, répondant, même sous la République, aux détresses et aux colères de la rue ? Des actes de dictature. »[40]. Dans les considérations du décret qui ferme les clubs, ceux-ci sont vus comme « le foyer d’excitations criminelles »[41]. Dans une sorte d’éditorial du Journal des débats, l’auteur, même s’il « ne versera pas de larmes », rappelle que les clubs « nous ont au moins rendu le service de nous apprendre à l’avance quel jour, à quelle heure et en quel lieu le parti démagogique se proposait de nous livrer bataille »[42]. Plus loin, dans le même numéro, on peut lire que si cet autre éditorialiste comprend la suppression de titres de presse, qui représentent « une opinion à peu près homogène », il s’étonne de la fermeture des clubs, qui ne « représentent pas une opinion, mais une tribune » où « il s’y dit des paroles détestables, mais il peut s’en dire aussi de bonnes… »[43]. Dans le décret qui concerne les conseils de guerre, dont les considérations soulignent « la nécessité de maintenir la paix publique en face de l’ennemi », il est précisé qu’ils pourront statuer « sur les attentats contre la paix publique et les tentatives armées contre les lois »[44].
[Notes : ajouter ici ce texte que j’ai écrit pour le film Commune que je prépare. Préciser que je ne me prononce pas, je ne m’occupe pas de théorie politique, c’est un personnage que je fais parler… J’imagine ce que ce personnage pourrait faire à partir du mot fraternité qui est laissé vacant dans la devise républicaine combiné au devoir d’insurrection que l’on retrouvait dans la déclaration des droits de l’Homme de 1793, formulé ainsi « Dans tout gouvernement libre les hommes doivent avoir un moyen légal de résister à l’oppression ; & lorsque ce moyen est impuissant, l’insurrection est le plus saints des devoirs. » et dans la constitution jacobine de 1793 : « Quand le Gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. ».
C’est dans un discours qui s’interroge sur la constitution d’une garde nationale comme contrepoids aux tentations despotiques des princes et garantie de la liberté publique et des droits de la nation, que Robespierre, celui qui défendit l’abolition de l’esclavage et de la peine de mort, celui qui appelât au suffrage universel et à l’égalité des droits, celui qui condamnât les responsables de massacres dans les provinces françaises et celui qui mit des limites à la propriété privée, prononce pour la première fois ces mots : Liberté, égalité, fraternité.
Ces trois mots ne désignent pas trois choses distinctes, ici la liberté, là l’égalité, plus loin la fraternité… qui se verraient appareillées par une fantaisie naïve, non. C’est une seule association de mots qui désigne une seule et même combinaison conceptuelle.
La liberté, prise séparément, ce n’est rien. Ce n’est pas même une idée que l’on pourrait définir et dont on délimiterait les contours avec précision… C’est tout au plus un pressentiment… L’égalité, pareil… On sait tout au plus dire quand ce n’est pas l’égalité, quand ce n’est pas la liberté, quand c’est la tyrannie.
Cette combinaison conceptuelle désigne un équilibre entre une liberté qui avance quand l’égalité recule, une égalité qui avance, etc…, un jeu de forces qui se repoussent et se balancent. Et la puissance qui assure l’équilibre entre ces forces contradictoires, c’est la fraternité.
La fraternité, ce n’est pas un pressentiment, c’est une action.
Il faut relire les constitutions de la grande Révolution. En 1791, on compte parmi les droits imprescriptibles, la résistance à l’oppression. En 1793, l’idée se précise : Quand le gouvernement viole les droits du peuple, la résistance à l’oppression, c’est-à-dire, le mot est lâché, l’insurrection est un devoir. Et il y a oppression contre le Corps social lorsqu’un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le Corps social est opprimé.
En d’autres termes, lorsque les droits d’un membre du corps social sont violés, ce sont les droits du corps social qui sont violés et c’est plus qu’un droit, c’est un devoir de résister. C’est cela, selon moi, la fraternité. Je ne la vois pas comme un sentiment de charité religieuse qui se satisfait de regarder des gens plus malheureux que soi, non, ni une émotion larmoyante ou romantique… Je la vois, la fraternité, comme l’action qui équilibre et garantit la liberté et l’égalité : le devoir d’insurrection.]
Dimanche prochain, on se rapprochera encore un peu plus de l'insurrection du 18 mars...[1] Gustave Lefrançais, Étude sur le mouvement communaliste, Neuchatel, 1871, p. 112.
[2] Cf Louise Michel, La Commune, citant Amilcare Cipriani, coll. Classiques des sciences sociales, p. 127.
[3] Louise Michel, ibid., p. 130.
[4] Le Journal des débats, 22 janvier 1871.
[5] Ibid., pp. 131-132.
[6] Ibid., p. 132.
[7] Ibid., p. 133.
[8] Jacques-Henry Paradis, Le siège de Paris, Paris, 1872, p. 828.
[9] Le Journal Le Réveil par exemple appelle au « renversement du gouvernement » in Le Journal des débats, 22 janvier 1871.
[10] Louise Michel, ibid., p. 134.
[11] G. Lefrançais, op. cit., p. 113.
[12] L. Michel, ibid.
[13] Le Journal des débats, 23 janvier 1871.
[14] L. Michel, ibid.
[15] Ibid., p. 131.
[16] Le Journal des débats, op. cit.
[17] Le Journal official l’annonce le jour même, cf le Journal des débats, 23 janvier 1871.
[18] Ibid.
[19] L. Michel, op. cit., p. 134.
[20] Le Journal des débats, op. cit.
[21] L. Michel, op. cit., p. 135.
[22] Le Journal des débats, op. cit.
[23] L. Michel, op. cit., p. 136.
[24] Ibid.
[25] Le Journal des débats, op. cit.
[26] G. Lefrançais, op. cit., p. 113.
[27] Le Journal des débats, op. cit
[28] L. Michel, op. cit., p. 138.
[29] L. Michel, op. cit.
[30] Ibid., p. 137.
[31] Le Rappel, 24 janvier 1871.
[32] Le Conseil général de la Première Internationale 1870-1871, éd. du Progrès Moscou, p. 123.
[33] Georges Carrot, Le maintien de l’ordre en France, Presses de l’Institut d’études politiques de Toulouse, p. 597.
[34] G. Lefrançais, op. cit., p. 114.
[35] G. Lefrançais, ibid., p. 115 et L. Michel, op. cit., p. 140.
[36] L. Michel, ibid.
[37] Cf J. H. Paradis, op. cit., p. 842.
[38] Le Rappel, 25 janvier 1871.
[39] Général Vinoy, Campagne de 1870-1871, Paris, 1872, p. 134.
[40] Ibid.
[41] cf le Journal des débats, 24 janvier 1871, recoupé avec le décret n° 271 du Bulletin des lois de la République française, Tome du premier semestre de 1871.
[42] Ibid.
[43] Ibid, recoupé avec le décret n° 272 du Bulletin des lois, op. cit.
[44] Ibid.
