Éditions L’Amourier, Collection Fonds Poésie, 2013.
Lecture d’Angèle Paoli

On aimerait s’arrêter là,
en apesanteur au-dessus du prisme vertigineux
de la couleur.
Image, G.AdC
« CES LUEURS QUE DISSIPENT LES SOUFFLES »
Qui sont-elles ces riveraines ? Longtemps le lecteur s’interroge pour poser un visage, un nom, sur celles qui donnent son titre au recueil d’Alain Freixe. Vers les riveraines. Longtemps le lecteur s’interroge pour comprendre par quels cheminements de mots le poète va passer pour les rejoindre. Happé par d’autres titres qui jalonnent l’œuvre d’Alain Freixe, on pense croiser au hasard des pages quelqu’une de ces « Dames de nuit » ou d’autres encore, momentanément échappées de Madame des villes, des champs et des forêts. Peut-être la « table » sur laquelle se clôt ce nouveau recueil poétique apportera-t-elle son lot d’indices ?
Il y a bien, dans l’intitulé de la première section, l’idée d’un mouvement. Échappées réfractaires. Et avec le dernier, une direction. Qui n’est pas exactement un écho au titre du recueil mais le prolongement d’une itinérance, peut-être un aboutissement : Vers les jours noirs. Entre les deux cairns, trois étapes. Chacune introduite par un infinitif en « p », qui porte en lui les marques implicites d’une démarche à entreprendre pour lever les obstacles : « Parler/Porter/Parier ». Et trois noms qui accompagnent les verbes : « Morts/Temps/Dorveille ». À l’intérieur, la seule image de femme présente — par le titre — est celle de « l’étrangère ». Il faut donc s’immerger dans le recueil, alternance de fragments en prose et de poèmes, pour croiser, peut-être, en chemin de lecture, celles que le titre du recueil promet.
Cela commence avec des murs. Des murs qui enserrent le monde. Monde fermé, pris en étau, barré, empêché. « Ici, on ne passe pas ». Encerclé, cerné. Partout les ombres de la mort tiennent prisonnier. Sous le boisseau, « dans la nuit du sens ». De sorte que la première tentation est celle de la recherche désespérée d’une issue. Qui dit mur dit brèche, faille, césure par où s’infiltrer pour retrouver l’air libre. « Par où passer ? » Le poète lui, cherche les fissures par où faire que les mots traversent. Meurtrières/Nuit/Noir. Qu’ils trouvent la faille pour des échappées, plus ou moins réussies, douloureuses, meurtries, cerclées de noir. Dès les fragments de la première section — « Échappées réfractaires » —, le ton est donné et la couleur dominante du recueil sera le noir. Le noir parsème le texte — vers et prose — de ses gemmes d’ombre. « Les veines du noir/Fichu noir/Virage au noir/Velours noir de la nuit… » Jusqu’au « silence noir de l’été »… Pourtant le livre est là, qui progresse vers. Et le lecteur est là, lui aussi, qui chemine dans le sillon du poète, dans son propre déchiffrage des énigmes. Solitaires l’un et l’autre sur « l’avancée des phrases ». Aux prises l’un et l’autre, dans un même partage, avec les mots du froid. Avec « le temps disjoint ».
Avec le mot « temps » s’ouvre la brèche qui porte en elle deux questions, intensément chevillées l’une à l’autre :
« Comment portez-vous le temps qui vous porte ? »
« Comment parlez-vous des morts ? »
Mot sésame, le temps pousse la porte de la première section : « Parler des morts ». Puis celle de la seconde section : « Porter le temps ». Image d’une circularité dont, semble-t-il, il soit impossible de sortir !
Pour parler des morts, il faut d’abord parler de leur terre, du lieu qui recèle dans le silence et l’oubli, les noms effacés de ceux qui ont vécu là avant nous et dont nous portons le nom. Ce mystère. La terre du poète est celle d’un passé défunt. Un pays ancestral. Un village, son abbaye en ruine, des pierres abandonnées ou ruiniformes. Mais aussi « les eaux fatiguées d’un étang qui se ferme ». « Une odeur de terre et de soleil ». Une maison. Quelques images qui persistent encore à trouver leur place dans la mémoire. Celle d’un bleu écrasant des chaleurs de l’été, d’un olivier de Bohême dont le feuillage tremble sous le vent, d’un cheminement de femmes. Premières riveraines nouées au noir, déjà. Et vouées à l’oubli. D’autres viendront. La servante qui « veille », « en attente des souffles » ; les lavandières qui « étreignaient/dans les linges blancs/la poussière des jours » ; « la porteuse d’eau/et de lait » ; « Marie la noire… ». Puis, plus tard, dans le poème final « Vers les jours noirs », « la dame des jours noirs » dont le poète guette la venue. Silence. Sévérité. Feuilles mortes. Ombre. Douleur. Folie. Le poète traverse. Il est « l’homme qui passe ». Il passe dans cet oubli, parmi les tombes. « Dans l’impasse des noms. » « Nom de mort » que la « voix silencieuse du poème » ne parvient pas à exhumer. Muni de sa « lanterne des morts », le poète se livre à un long cheminement solitaire (il a abandonné le « nous » qui le liait à son lecteur) pour tenter de saisir ce que « l’autre côté » recèle. « J’ai écouté le vent/J’ai caressé le velours noir des nuits/J’ai cherché parmi les morts… ». Il a arpenté « les gorges obscures par où était passée la vie ». « Je marche parmi les os », écrit-il dans « La voix perdue des morts ». Il ne recueille sur son passage que squames de terre qui s’écorcent en lamelles successives de morts, effilochements d’histoire (souvenirs de la Grande Guerre), « images dépareillées ». Pareille au cyprès noir qui dresse sa silhouette et « se tait », la langue des morts est muette. Surgissent dans la langue d’autres « riveraines ». Avec les mots-stèles qui jalonnent la marche : tombes, croix, mousses, herbes, « pauvres et souveraines ». Autant de traces sur lesquelles trébuche le poète. Qui ne livrent des origines qu’une « fiction d’oubli ».
Comment, dès lors, poursuivre ces errements ? Le temps n’est pas encore celui de la révélation. Il est celui de la quête. Délaissant la prose fragmentée, le poète se lance dans un long appel, scandé comme un chant qui étoile le silence. « Qui appeler » ? interroge le poème. Une voix survient qui accompagne celui qui déjà est rejoint par un âge avancé. Une voix intérieure dissuasive, qui murmure : « N’appelle pas la mort/n’appelle pas les morts ». Puis, plus loin : « ne poursuis rien/il n’y a rien au bout/invente donc/sans y croire/ce qui embellit/le gris du jour. » « Appelle les hommes »… Aucun espoir pour guider vers une autre lumière que celle du souterrain qui attend, « de l’autre côté du monde », que les chemins se referment sur celui qui s’avance. Pas même un cheveu d’or pour distraire un instant le poète de « ce noir humide » qui le guette. Les « musements » de Perceval ne lui sont pas d’un grand secours. « Une fois dépassé le rouge/et les bords couturés de neige », la vie va son chemin « sans nous ». La première section du recueil se referme et « personne n’est là/pour lever les yeux. »
S’ouvre alors « Porter le temps ». Cet ensemble, qui alterne poèmes et fragments en prose, est inauguré par le poème dédié « À l’étrangère ». Les images sont là, identiques, obsédantes. Nuit, noir, caverne humide. Rien ne semble avoir changé, sinon le rapport au temps qui s’articule sur un mouvement de balancier « avant/après ».
« Je vois des flammes/d’avant les flammes/se balancer » ; « J’entends une neige/d’après la neige/se perdre » ; « silence/d’avant tous les silences » ; « attente/d’après toutes les attentes »… Peut-être est-ce là, dans ces interstices d’un temps circulaire, qu’une lueur va pouvoir poindre ? Une lueur conduite par le mouvement de la main qui cherche dans le vertige de la spirale le point où s’originent les mots. Peut-être le poète retrouvera-t-il alors, l’espace d’un instant, « les restes de l’ombre/d’une robe rêvée rouge »… Pourtant, l’impuissance du poète demeure. « Les murs aveugles » restent sourds à la misère. Le poète a beau racler quelques mots, « nul futur n’arpente leur épaisseur ». L’ordre du chaos est inchangé et « la chute se poursuivait/dehors ».
Le poète, lui, poursuit sa marche. Poursuit sa quête à travers mots. Écrire comme marcher, l’un et l’autre soudés dans la même fatigue, confrontés aux mêmes obstacles. Poursuivre malgré tout, « passer les ronces ». « Marcher vers cette soif qui renoue l’eau au corps qui l’aime. » Aller au-devant de soi, opter, enfin !, pour la légèreté :
« Surtout ne pas peser. Suspendre ses pas, ses pensées du jour et ses mots de toujours. Ne rien faire. Laisser le soleil agir. Laisser transpirer la pierre et que le ciel boive son ombre. »
Est-ce là une étape ? Une escale nouvelle où prendre appui pour d’autres dispositions, d’autres départs ?
« J’avais désencombré un espace. Décidé à maintenir nue et propre la déchirure, cette porte du cœur. Par où passer pour d’autres voyages. »
Le voilà parvenu au bord. Guidé par « l’oiseau du soir ». « Un oiseau troué d’air ». Avec lui, survient « le ciel sans trace. Sans plaie. Sans cicatrice ». Le voilà parvenu au bord de la « Dorveille ». Ce n’est pas que « la nuit souterraine » retienne désormais dans ses lacs, les images de « lune noire » et d’os blanchis par le temps. Ce n’est pas non plus que les mots aient enfin trouvé leur espace pour entourer la mort de davantage de douceur. C’est plutôt que l’état de demi-sommeil de Perceval gagne. Cet état hypnotique que le chevalier, dans l’expérience de son recueillement, a traversé. Voilà que les poèmes de cette section se teintent de l’empreinte du mythe gallois. Dans la lettre et dans l’esprit. Ainsi du poème « Rose couleur nouvelle » qui prend explicitement appui sur le récit de Chrétien de Troyes :
« s’avancent un cheval
et son cavalier
sous un ciel laiteux
déchiré par les ailes
d’un vol d’oies sauvages
que l’attaque d’un faucon
rend erratique... »
De ce « musement » ancré dans un récit qui habite le poète naît l’oubli et de l’oubli naît l’écriture. Celle-là même qui s’empare de la couleur et transforme l’apparition de « trois gouttes de sang » dans la neige en une vision qui transfigure le réel. Entraînant le poète dans un monde autre qui jusqu’alors lui demeurait inaccessible.
« Couleur naturelle
couleur nouvelle
ni rouge ni blanche
mais rouge avec blanc
et blanc avec rouge
comme un rose
un rose incarnat
mais de juxtaposition
comme l’épaisseur d’un flux
l’intensité de l’air traversé
la profondeur d’un courant... »
On aimerait s’arrêter là, en apesanteur au-dessus du prisme vertigineux de la couleur. Sur les bords du volcan des mots pris dans la fluidité de la matière. On aimerait, avec le poète, laisser filer l’oiseau « jusqu’au ciel/que ces ailes creusent/avant d’y disparaître. » Et, « dans le feu humide/des herbes du sommeil », saisir avec lui « ces lueurs que dissipent les souffles ».*
Angèle Paoli
D.R. Texte angèlepaoli
__________________________
* in dédicace de l’auteur à A.P.
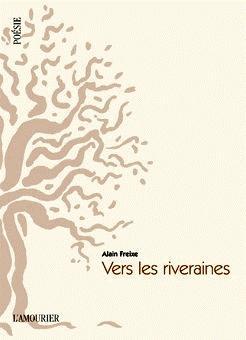
ALAIN FREIXE
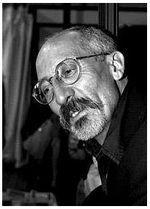
■ Alain Freixe
sur Terres de femmes ▼
→ Vers les riveraines (lecture de Sylvie Fabre G.)
→ À l’étrangère (extrait de Vers les riveraines)
→ Bleu plié au noir
→ Septième pas (extrait de Comme des pas qui s’éloignent)
■ Voir aussi ▼
→ (sur le site de L’Amourier éditions) une page sur Vers les riveraines
→ (sur Terres de femmes) Alain Freixe & Raphaël Monticelli | Chère
→ P/oésie, le blog d'Alain Freixe : La poésie et ses entours
Retour au répertoire du numéro de décembre 2013
Retour à l’ index des auteurs
Retour à l’ index des « Lectures d’Angèle »
