Éditions Les penchants du roseau, décembre 2013.
Illustrations et postface de Didier Manyach.
Lecture de Sylvie Besson

Toile de Nicolas Vial
Source
MÉLODIE EN SOUS-SOL POUR POINT D’ORGUE !
Il fait froid, l’air est bleu comme les lèvres d’une morte. […] Je veux ramener à ma mémoire les corps des anciens pour donner sens à ce que je suis [...]. Il faut que j’ouvre toutes ces tombes… »
Mais quel chemin parcourir encore pour ne pas trahir les mots en mémoire ? Pour les dire « sans s’écorcher les doigts jusqu’au sang » ? Comment restituer ces souvenirs en cale ? Comment décharger ce cargo où est stocké ce que l’on a peur de perdre alors qu’il ne s’est rien passé, l’espace ne se retirant pas de sa trajectoire. L’auteur va alors, par le cheminement de ses attentes et de ses blessures, rendre possible l’offrande des mots retrouvés. Yasmina Hasnaoui avance en marchant sur des débris de verre et le Blues enclenche un cri qui questionne, secoue, bouscule, déchire la langue et l’esprit. Le texte faisant sortir l’attente de toute inertie, permettant à une « parole-corps » de naviguer entre brûlures et colères. Car il faut rager, même à quai, même en cale sèche, pour vivre de nouveau :
« Seule la pluie peut assassiner le silence mais le ciel refuse de rincer la gueule du monde. Qu’il sue donc ses plaintes ! […] Mettre hors de portée [l’] attente. La faire crever entre les lignes »
Aussi c’est au plus près de la chair que la poète nous propose d’aller, enfermée en elle-même jusqu’à l’os. Il ne s’agira pas de s’en tenir à l’effleurement d’une glissade mais bien de pénétrer plus avant dans la chair du monde et du corps, dans la chair de la langue aussi. Yasmina Hasnaoui part donc à l’assaut de ce qui la dévisage comme ce qu’elle envisage en lieu propice à l’errance. Elle combat ce qui parle en elle, depuis la violence des passions circulaires, une ombre en soi qu’il faudrait qu’elle s’arrache. L’auteur fait front. Elle avoue les lames de fond, les crues du chagrin et les inondations des angoisses, les vagues brisées, les tempêtes qui vous brisent en deux. Elle accepte d’être cette femme endeuillée par l’Absence, cette mariée en noir qui peint son propre cri. Et si le nom chanté se confond avec celui de la Nuit, le culte consenti à cet Obscur n’est pas de tout repos. De la même façon qu’elle frappe aux portes de la nuit, Yasmina Hasnaoui refuse d’être une Artémis-Hécate funèbre. Son art s’apparente davantage à l’univers de la grande Isis nervalienne de l’Origine retrouvée, pacificatrice de toutes les tensions. N’affirme-t-elle pas que n’importe quel geste éclabousse « le rêve de l’amour » ? Tant mieux, ce n’est qu’une flaque sale, et seule la réalité de cet Amour redoublé tisse une sorte de moire énonciative sensible, et s’élance dans l’immensité Océane de l’existence. D’où les fragments remotivés du discours quotidien, allant parfois jusqu’aux familiarités syntaxiques, cassant toute forme d’onirisme comme un contre-sens à la vie :
« Hier l’ampoule a cédé. Grillée. Je voulais rêver, laisser mon corps sur le lit, en vrac et m’en aller te rejoindre peut-être, mais je n’ai pu me quitter »
Surgit dans chaque page auréolée de son « sillage » la vibration d’une chair vive, refusant de tourner le dos à la terre, mais désireuse de reprendre toujours la mer, une poésie à laquelle on doit « céder le pas du chemin » (Char). On est proche d’une expérience du réel, mais surtout de ce sur quoi elle débouche – l’exploration de soi, ici et ailleurs, la vie d’un Bateau ivre avec la descente fiévreuse des mers. Chacune des phrases faisant apparaitre la vie. Non pas la vie en surface, grise et froide comme la brume, mais celle souterraine et transparente des éclats de vie dont la sourde rumeur fait l’objet d’une pressante communion, la lumière jouant sur le souvenir des corps entrelacés :
« Nos os tremblent sous les éclairs, prêts à se détacher les uns des autres. Dislocation. Retour à la source. »
Et l’écriture à tout courant se rapproche des contrées de Moazon mais aussi des flux lyriques de Conrad. La remontée ne se fera que dans la trouée des forêts impénétrables de l’attente, au milieu des larges eaux que recouvre le désordre des îles. Avec, au bout, l’espoir d’un chenal qui couperait court au désir de se perdre et davantage encore à celui de soliloquer. Le poète refusant de n’être rien d’autre qu’une absence.
C’est sans doute en ce point que tous les fils de l’œuvre se nouent aux yeux du lecteur. En effet, si un voyage est souvent la forme indirecte de l’amour, réciproquement un amour n’est qu’un temps visité par une zone laissée en blanc. Et toutes ces zones sont justement comme des terrae incognitae du désir, un passage ouvert vers tous les possibles que reprend l’entêtant motif du retour. D’abord en une dénégation puis en lueurs renaissantes. On songe ici au portrait du poète en voyageur, dont les infinies variations assurent à l’ensemble le caractère d’une partition musicale, à l’instar du plongeur nageant en eau profonde sans savoir qu’il invente d’autres passages. L’ensemble du paysage exploré peut enfin métaphoriser le corps du monde comme modèle de l’errance, lequel structure à la fois la progression dans le réel et dans la page d’écriture : « Seul sur le papier on peut revivre ses propres absences ». Le désir de ré-incarnation d’une poétique est certes imaginable, mais le poète préfère ne pas ignorer que « la grâce » ne peut s’atteindre qu’en rapport d’équivalence avec l’expérience bouleversante de la finitude logique du vivant.
Ainsi, particulièrement émouvantes, déchirantes, toutes les scènes s’enchevêtrent intimement, l’espace du dedans et l’espace du dehors. L’univers entier est exil. Seul l’amour peut lui donner une terre d’accueil, et le poète cravache les angoisses, les blessures du quotidien et les violences communément admises pour ne pas attendre en vain. Sa voix réclame la fin du mensonge et refuse de disparaître sans mordre, sans dissoner, sans ébranler. Elle trace, à travers des paysages qui chutent et se relèvent, en flux et reflux, une vie de femme qui scrute, dans les gestes du quotidien, le pourtour du soi et l’eau du poème où se désaltérer : « J’ai soif / La lune est à sec / […] / La nuit / rien n’est gris ». L’écriture laisse par conséquent remonter le Passé à la surface pour cerner les déchirures et garder des îles sous les paupières, pour conjurer enfin la fatigue et l’oubli des espoirs passés :
« Te souviens-tu ?
Tu m’as dit : « les jours sont des îles que nous foulons ».
Je n’ai pas oublié. »
Et, de toutes ces désillusions, Yasmina Hasnaoui dit avec ténacité, au sein de son texte ciselé d’extrême pudeur, les chagrins, les éblouissements, les paroles mortes, les respirations lumineuses. Elle livre une sensibilité abrasée par les silences, mais lance le poème en ligne de défense afin de se soustraire de ce qui s’amenuise. Voilà pourquoi le lyrisme intrigue. Le recueil ne sombre jamais dans l’effusion sentimentale pour la raison que ce lyrisme est celui de chacun. Une lumière juste dont les corps pourront se vêtir. La parole est celle de tout individu qui, sensible à la seule présence de la Vie, qu’il soit seul et couché sur le côté, continue de croire que rien n’est entier : sous chaque éclat danse une intensité qui, sans faire sortir de l’exil, donne à avoir lieu. Dans un cargo, par exemple, où s’échoue la souffrance et à laquelle le poète assigne la beauté. Il faut écrire et regarder le monde depuis l’abîme, dire l’agressivité et l’angoisse qu’il suscite et, au-delà, chercher malgré tout un besoin inextinguible de plénitude. Si le recueil est tout en lignes de failles, en instants fissurés, c’est qu’il s’agit de révéler une nuit qui pétrifie autant qu’elle illumine, une nuit qui irise le poids sensuel des mots, le visage incertain des attentes, le navire perdu dans l’écho du temps, le regard écorché par la vision des départs. En somme, le sang finit par rejaillir des tangages du cargo et un mouvement nocturne de vagues circule dans les veines ; la mer redevient nuit agitée de marées, désireuse de pouvoir s’étendre aux sables chauds des îles :
« Tant d’îles foulées et tu es là. Je ne te connais pas. Des jours et des îles. Certaines étaient si vastes, si longues... Des déserts où l’on trainait notre peau. Regarde-moi, regarde-les ! ».
Et même si les bateaux semblent l’unique recours qui reste pour fuir, l’écriture cependant seule enivre. Yasmina Hasnaoui le dit en parole libérée, dans la fluidité de sa prose ou dans la mélodie de formes brèves. Exerçant un art de la composition où la disposition visuelle cherche à marier émotions et formes, rythmes et enchainements, strophes brisées et longues laisses. Un livre comme une gestation perpétuelle saisissant tout ce qui fait de l’homme une âme insulaire, délivrant enfin un geste poétique entre attentes rêvées et traces bien réelles. Mais les rêves finissent toujours par se briser sur la morsure du réel qui secoue l’âme de sa torpeur. Réveillée, exilée du voyage intérieur, la poète s’adonne à la certitude du Blues, peur nauséeuse de la solitude, peur de ne plus entrer en communion avec le corps de l’autre, peur tangible des mondes qui nous échappent. L’aube brûlée de gris recouvrant les signes d’une langue qui ne serait plus rempart contre la vérité.
Alors tous les instants d’exil que sont les incertitudes et les déséquilibres — car toute rupture est bien perte d’un équilibre — ne sont plus seulement des vacillements de sens. L’effritement des amours perdues fait désormais écho à l’effondrement des illusions, des leurres et des bonheurs trop facilement distillés. L’écriture regarde, selon la belle formule extraite de la postface de Didier Manyach, « au plus profond des eaux de la mémoire », Yasmina Hasnaoui fait de ses mots une plongée en eaux troubles et troublantes. Son Verbe dit les jeunes et vieilles blessures de ce monde auquel il faut savoir s’arracher tout en s’amarrant à la terre inconnue qu’est l’Amour. Cet Amour qui, ne digérant pas les cadavres, tente de les rejeter dans l’infini terrible des abysses. Tout au long de l’œuvre, la langue mouvementée de la poète est capable de prendre en charge l’expression du drame du désir humain. Et seul le langage donne sa force à l’œuvre, et cette force est celle-là même de la poésie. L’écriture se joue alors de la malléabilité des ombres, éclabousse la langue de mots bouleversants, et la poète s’inquiète à l’idée de voir ses jours coaguler ou son esprit piégé dans un corps qui s’épuise. C’est pourquoi sa voix élève son cargo-somnambule et le projette déjà en pleine mer, au cœur de la vie. Yasmina Hasnaoui crie des tréfonds de l’abîme en des phrases qui se saccadent, saturant de mots son angoisse à exister. Elle compose ainsi un poème du désarroi existentiel comme de la lutte et du renouveau artistiques, expériences encrées à fleur de vif, au fil du recueil. Les dessins de Didier Manyach convoquent en ce sens, par leur tracé, tout en fausse candeur et en grâce sincère, un pays au-delà du noir. Il plonge dans la présence de l’ouvrage pour en retirer les formes idéales qu’il propose à l’œil en profondeur. Ses images nous transportent dans ce cargo, dans les voyages comme dans les escales, rappelant que les mots du poète finissent toujours par se transformer en paysages. En effet, si le cargo bouge, si la main s’agite sur la feuille, c’est que la Nature seule donne au navire son mouvement et à l’encre ses inspirations comme un « brûlot d’étoiles dans le brouillard » (Didier Manyach) ; Yasmina Hasnaoui et Didier Manyach marchent ainsi l’un à côté de l’autre sur les digues comme dans les vagues luminescentes du monde.
De même que la poète évoque en paysages l’attente insupportable, la tentation de disparaître, la douloureuse absence ou, au contraire, des instants où le corps se retrouve en pleine conscience, elle expose, malgré le pesant isolement que nourrit son esprit, l’immanence de l’être et de sa poésie à même la terre ou dans le bruit des océans. Son beau cheminement est complexe, imposant des motifs qu’il disperse en cailloux semés et qu’on retrouve tout au long du parcours. Traçant, en cercles fugaces, les balancements, les gouffres, les percées d’une pensée qui se découvre au fil d’une perte et qui travaille à se reconstruire par un absolu dénudé, sensible et juste. Malgré la noire souffrance, malgré les chairs meurtries, la voix n’hésite pas à dire l’éternelle réinvention de soi, permettant à l’écrivain de faire peau neuve et de s’élancer à la conquête de nouveaux mondes. Lire Yasmina Hasnaoui, c’est donc muer de l’ombre à la lumière, dans une lente acmé forgeant sa persona d’écrivain. Plonger dans Cargo blues, c’est effectivement assister à la renaissance d’un mythe, celui d’une sorte d’Orphée au féminin qui sombre aux Enfers pour y chercher la poésie, et qui en ressort la vie chevillée au corps : « c’est la dernière nuit et je suis toujours vivante ». La puissance orphique de la poète est telle qu’elle entraîne son lecteur avec elle, le guidant de terres en mers, gouvernail au poing. Et l’on entend, dans cet éloge indirect à la Nature, l’écho des houles les plus poignantes. Yasmina Hasnaoui nous emmène finalement loin des Enfers de l’obscur, nous rapprochant ainsi des échos possibles de l’Amour. Puisque seul Aimer justifie de Vivre. Ancrant ses mots aux îles les plus incandescentes, non point îles dénuées de ciels gris, non point sous un soleil si bleu qu’il en deviendrait si bas, encore moins en des lieux irradiés de lumières, mais sur des terres cendrées, là où il n’est pas rare de trouver les plus fascinantes braises.
Sylvie Besson
D.R. Texte Sylvie Besson
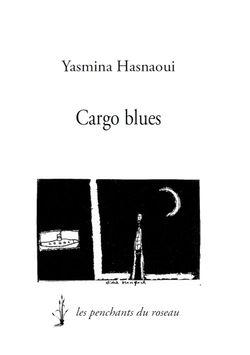
■ Autres notes de lecture de Sylvie Besson
sur Terres de femmes ▼
→ Les variations poétiques de Philippe Beck ou le tempo universel du monde
→ Hélène Dorion, Ravir : les lieux
→ Lorine Niedecker, Louange du lieu et autres poèmes
→ Richard Rognet, Un peu d’ombre sera la réponse
Retour au répertoire du numéro de janvier 2014
Retour à l’ index des auteurs
