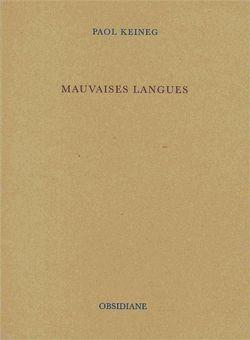LE DÉSENCHANTEMENT
C e Journal de deux années (2010-2012) a d'un carnet l'allure errante, mélange de notations prises sur le vif et de réflexions brèves. Après de longues années outre-Atlantique, Paol Keineg revient sur la terre de son enfance, ce pays de Bretagne " si petit au regard / de l'histoire universelle ", dont il a fait une manière de paradigme. Il y constate la disparition quasi totale de la langue (l'une des mauvaises langues du titre) et de la civilisation qu'il a défendues dans sa jeunesse (au sein de l'Union Démocratique Bretonne), engagement si passionné qu'il lui a valu d'être chassé de son poste à l'université, si bien qu'après divers aléas il s'est résolu à s'exiler.
Paol Keineg part de la réalité ordinaire, de son quotidien, celui de la cuisine, du jardin ou de la bibliothèque, celui surtout de la campagne bretonne qu'il arpente incessamment, à pied ou à vélo, aussi attentif à la nature et aux bêtes (les oiseaux ! corbeaux, geais, hirondelles... rossignol philomèle... sternes, cormorans...) qu'à la vérité économique et sociale d'aujourd'hui, celle des champs déserts, des vastes usines à cochons et des bancs d'abattoir (" cinq cous coupés à la scie circulaire "). Il écrit " les yeux sur la page, et par-dessus ", dans un aller-retour constant entre aujourd'hui, où il vit en immigré, et hier ‒ non à proprement parler pour regretter (encore que : " les vieux morts / appuyés aux murs de pierre / nous contemplent, / arriérés et radieux "), ni même pour donner sens, mais plutôt pour tenter de se réconcilier avec lui-même. Cela ne va pas sans une bonne dose d'amertume :
[...]
Pour vivre ici
il faudrait offrir à jamais
le visage heureux du sot
à qui on a promis le paradis.
Est-il moins sot
d'avoir renoncé à faire descendre
le paradis sur la terre ?
Avec presque rien, son visage dans un miroir, des poires tombées et des guêpes, Paol Keineg érige de " petites constructions de hasard ", aigres ou mélancoliques, qui s'évadent presque aussitôt du concret. De la confrontation de notre époque avec l'après-guerre (la perte de la langue, l'effacement de la société ancestrale), comme aussi de l'âge avec la jeunesse (le militantisme, l'amour, les illusions), de ces deux silex heurtés, impossible qu'il ne jaillisse pas quelque chose : des éclairs de pensée, des questions sans réponses, des aphorismes (" le maïs partout, pas les soviets "). Une poésie qu'il faut bien dire politique, mais pas une once de rhétorique ‒ la pensée y naît souvent sans relation de causalité flagrante avec la scène qui l'a inspirée. Ni aucun humanisme ( " les discours sur l'homme puent " 22) ; du reste, hormis l'auteur lui-même, presque aucun être humain dans ce journal, qui donne l'impression d'un pays abandonné. Sévérité tempérée par un humour constant, le plus souvent grinçant ‒ cette sterne à l'image de l'auteur, " mi-réaliste mi-socialiste "...
On l'aura deviné : ici, aucune glorification de la poésie (" à bas, à bas la poésie "), vécue comme une activité sans doute nécessaire mais aussi banale que celle des paysans qui peinent dans leurs champs ou nourrissent leurs batteries de cochons. La poésie de Paol Keineg ne vise pas à enchanter le monde mais, bien au contraire, à le désenchanter ‒ à nommer les choses dans leur vérité, à les inscrire dans le mouvement historique (" répondre à l'espoir que font naître / Les choses sans importance "). Je ne sais pas si, pour Paol Keineg, Seamus Heaney est une référence qui compte. Certaines pages m'ont fait penser au poète irlandais, non seulement pour la relative parenté de leurs univers (la civilisation de la pomme de terre...) mais aussi pour leur façon de tirer du quotidien de petites leçons qui, dans leur modestie, manifestent l'universel (l'Histoire, la Langue, etc.), telle cette bicyclette renversée dont les rayons semblent parler : " on assiste en direct / à la naissance du langage ".
C'est, à mon goût, le livre le plus achevé de Paol Keineg, auteur pourtant, récemment, du bel Alabamour (Éditions Les Hauts-Fonds, 2012). Une poésie " simple comme la mort / avec des complications utiles ", dont le pouvoir, indéniable, ne tient à aucune sorte de sortilège. Parmi de nombreuses pages qu'on aimerait citer ou donner en exemple ‒ tant ce livre est, en effet, exemplaire ‒ cet hommage à la mère disparue :
Ma mère voyait clair à la veille
de sa mort,
elle avait fait le pari de l'irréalité
pour gagner sa place au paradis.
Le cimetière n'est pas le paradis,
c'est un lieu de passage
soumis aux contrôles d'identité,
à la politique des corps.
Débarrassée du sien
ma mère ne demande pas la résurrection
des corps,
tout à son âme
qu'elle n'a pas noire
elle ne demande pas pardon,
en rêve elle crie au secours.
À sa droite, je me lave les mains,
je monte la garde en centurion romain.
Gérard Cartier
D.R. Gérard Cartier
pourTerres de femmes