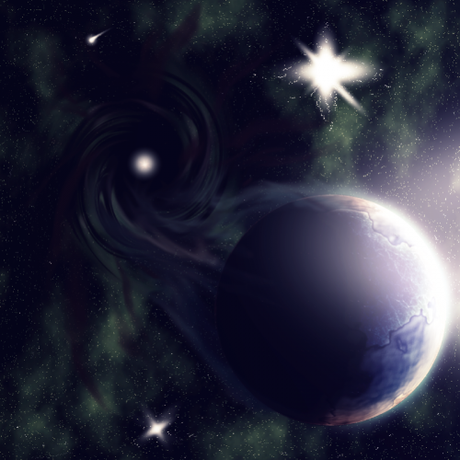J’ai écrit il y a déjà cinq ans un article intitulé Le trou noir, replongeant dans des périodes de ma vie où j’étais très angoissée et où je me sentais vide à l’intérieur – d’où le titre. Je renouvelle l’expérience suite encore une fois à ce que traverse une personne chère à mon cœur –pas la même cela dit… Cela faisait un moment que je pensais à parler d’une façon ou d’une autre de ma dernière rechute que je crois qu’on peut sans exagérer appeler un épisode dépressif.
J’ai longtemps voulu ignorer ce mot, dépression, qui fait peur et qui évoque pour moi des situations bien plus sérieuses. Mais la dépression, ce n’est pas être malheureux et désespéré tout le temps, et c’est un piège que de se sentir coupable ou malade imaginaire parce qu’on a aussi des moments de joie. Je déplorais également la tendance à appeler dépression toute période de déprime, l’étiquette de dépressif qu’on colle aux gens, et puis je crois que je refusais d’absoudre de toute responsabilité le système scolaire et les personnes qui m’ont fait du mal par méchanceté ou par bêtise, comme si c’était ma fragilité qui était en cause et pas eux… Alors voilà, je refuse l'étiquette de dépressive, je suis joyeuse le plus souvent, je pardonne pour ma propre sérénité mais je n’oublie pas le mal qu’on a pu me faire, mais j’admets à présent que j’ai traversé des périodes vraiment difficiles.
Depuis toujours je suis très angoissée. Mes lecteurs les plus assidus se souviennent peut-être de ce que j’ai pu raconter sur mon rapport au temps : enfant, je pleurais souvent le soir si je m’apercevais après une journée géniale que je n’avais pas eu le temps de faire quelque chose que j’avais prévu. J’ai aussi un rapport très compliqué avec le changement et les choix. J’ai besoin de me préparer à l’avance aux bouleversements, aux décisions à prendre, et pour cela j’ai souvent eu la méchante tendance à remâcher toutes les éventualités possibles et imaginables, et notamment les pires. L’avenir me terrifiait, je ne savais pas quoi en faire. Et puis, ça je ne l’ai compris que plus tard, j’étais minée par la culpabilité pour tout et pour rien. Si je « bâclais » des devoirs jugés inintéressants (ce qui pour moi signifiait simplement les finir sans perfectionnisme), je me sentais coupable. Si je ne disais ou ne faisais pas ce qu’il fallait dans une situation, et fillette puis adolescente mal à l’aise en société, cela m’arrivait souvent, je me sentais coupable...
J’ai eu la chance d’avoir une famille proche très stabilisante, des parents géniaux qui m’ont accompagnée dans des années difficiles. Mais pendant longtemps, j’ai gardé une partie de ce mal-être enfoui en moi, pour ne pas leur faire peur, pour ne pas me l’avouer à moi-même, parce que je ne le comprenais tout simplement pas. Une réflexion qui revient dans nombre de mes écrits adolescents, c’est – je paraphrase – « Je sais que j’ai de la chance, mais… » Mais ça ne va pas. Mais j’ai peur. Mais je me sens vide. Mais je ne sais pas où aller. Et – devinez – je me sentais coupable.
Ceux qui me lisent régulièrement savent peut-être aussi que j’ai une maladie auto-immune, une thyroïdite de Hashimoto, qui depuis quelques années est en bonne voie de « guérison » - même s’il faudra continuer à y prêter attention régulièrement. Ce type de maladie peut quasiment toujours être relié à un élément déclencheur émotionnel – on a des gènes et un « terrain » plus ou moins favorable, on est exposé à certains facteurs de risques environnementaux, mais en général c’est au moment d’un deuil, d’un choc que l’on déclenche la maladie. J’ai beaucoup cherché après qu’on m’ait parlé de cet aspect quel pouvait être ce facteur déclencheur. Le décès de ma mamie ne correspondait pas en termes de timing. Rien dans ma vie familiale ne pouvait l’expliquer. Je me suis donc dit que cela devait être le collège puis le lycée, qui me rendaient très malheureuse jusqu’à ce que je quitte le circuit scolaire classique pour faire ma 1ère et ma Terminale au Cned. Et effectivement, c’est là que les choses allaient mal. Mais ma surprise à l’époque que cela puisse avoir de telles conséquences montre bien à quel point je continuais à minimiser mon mal-être…
Avec le temps, avec ce passage au Cned qui m’a permis de me reconstruire, de prendre le temps de découvrir qui j’étais et qui je voulais être, puis une année sabbatique après mon bac qui m’a permis de souffler et de voyager, j’ai évolué, j’ai limité ces aspects négatifs. Puis lorsque je suis entrée à nouveau dans un contexte « scolaire » dans mon école de traduction, j’ai régressé. Relire récemment mes écrits de l’époque m’a montré à quel point j’étais encore loin du but.
Ces écrits, je les ai ressortis pour cette personne qui traverse des moments difficiles, que j’ai rencontrée à l’époque et qui me considère depuis lors comme « la personne la plus zen qu’elle connaisse ». Je lui avais raconté bien des choses, mais avec ce recul que donne le temps. « J’ai quitté le lycée parce que je m’y sentais mal » n’équivaut pas tout à fait à « Je pleurais au moins une fois par semaine, je me disais le soir dans mon lit que j’allais mourir si je devais subir une journée de plus, et je disais ‟J’en ai marre” à longueur de journée sans que personne au lycée ne s’aperçoive que c’était plus qu’un ras-le-bol adolescent. » Pas plus que « Je suis angoissée par l’avenir » n’équivaut à « Je pique une crise d’angoisse quand on m’appelle suite à une candidature de stage que je croyais passée aux oubliettes car je m’étais faite à l’idée d’un autre stage dont la convention allait être signée. » Ces choses-là s’effacent un peu avec le temps, mais pour témoigner, pour montrer à cette personne et à ceux de mes lecteurs qui peuvent connaître des situations similaires, que vous n’êtes pas « les seuls terriens à passer par là » pour paraphraser mon premier Trou noir, j’ai ressorti mes vieux journaux intimes, mes vieux poèmes et « défouloirs », et c’est fou le bien que ça fait de voir le chemin parcouru.
Car je vais beaucoup mieux. On ne change jamais qui on est dans le fond, et je resterai toujours plus stressée et angoissée que la moyenne. Mais j’ai aussi appris à gérer le stress et l’angoisse mieux que la moyenne et j’aime à croire que cela me rend, sinon plus forte, du moins plus riche de certaines manières. J’ai eu le plaisir étonnant d’être celle qui enjoint mon père, stressé, de « voir venir » face à une incertitude concernant mon futur proche au gré des possibilités de stage. Nous en avons bien ri car il me l’a tant répété pendant des années qu’il devait désespérer que je prononce un jour ces mots… Je pense toujours à vingt choses à la fois et je suis toujours incapable de vider mon esprit. Mais j’ai trouvé des petits trucs tous simples pour concentrer mes pensées, pour ralentir les rouages et calmer les idées noires, repousser la culpabilité, vivre le moment présent.
Quid de cet épisode dépressif que je mentionnais en intro, alors ? Ou, comme je l’appelle affectueusement, ma mini-dépression. L’an dernier, au printemps, nous avons perdu notre vieille toutoune, Éva – j’en ai parlé sur ce blog. C’était un coup dur, mais c’était en quelque sorte dans l’ordre des choses et j’ai pu lui dire au revoir. Mais moins d’une semaine plus tard, nous avons aussi perdu l’un de nos trois chats, Boule-de-Poils (dit Bouldip, Boubou, Babou). Je n’en ai pas parlé ici. Il était très proche d’Éva d’autant que tous les deux étaient un peu malades, lui diabétique, elle âgée, et à sa disparition, il était tout perdu. Il errait dans la maison, cherchant son amie sans doute, et un soir a demandé à sortir comme nos chats le font souvent en été. Mais il n’est plus revenu. Nous nous sommes vite inquiétés, son diabète exigeant deux injections d’insuline par jour, l’avons cherché, avons distribué des prospectus et posé des pancartes. Quelques appels de personnes l’ayant vu, faux espoirs, il n’était jamais là et nous ne sommes même pas sûrs qu’il se soit agi de lui. Assez vite, nous avons dû nous résoudre à l’idée qu’il n’avait sans doute pas pu survivre sans insuline.
Ces deux pertes coup sur coup, et surtout l’absence complète de sens de cette seconde disparition, m’ont atteinte très fortement. J’ai perdu cinq kilos en deux semaines. Je m’en suis aperçue et j’ai essayé de contrer cet effet, mais mon appétit et mon sommeil ont souffert et j’ai perdu trois kilos de plus au fil des mois qui ont suivi. J’étais toujours là, je m’accrochais, et on ne peut pas vraiment dire que je me sentais vide, mais tout était un peu plus terne, et j’avais cette sensation horrible de perte de contrôle. Moi qui avais toujours eu bon appétit, même malade, me retrouvais avec l’appétit bloqué. Mon poids était descendu plus bas que quand j’avais 15 ans, encore en pleine croissance, et j’en sentais les effets : plus faible, plus frileuse, et après avoir enfin accepté mes formes méditerranéennes je me trouvais trop maigre. C’est terrifiant. J’ai regagné progressivement mon appétit, même si encore maintenant en période de stress, je rechute un peu. J’ai repris cinq kilos sur les huit et je laisse désormais venir les trois supplémentaires s’ils doivent réapparaître. J’ai traversé une période d’insomnies systématiques il y a huit à neuf mois, et je me suis réfugié dans la lecture à un point presque pathologique – de mai à octobre 2014, je lisais un à deux livres par jour, je lisais non seulement le soir, en mangeant et dans les transports comme je le fais souvent, mais aussi devant la télé, pendant mes pauses en stage, en cours… C’était non seulement la façon de m’évader qui a été salutaire au fil des années, mais vraiment une façon de m’échapper, sans doute pas tout à fait saine. Mais on gère comme on peut et je suis maintenant revenue à deux livres par semaine environ. J’ai commencé un poème pour Boubou il y a quelques mois, m’y suis un peu remise récemment, mais seulement quelques vers à la fois car cela reste très douloureux.
La conclusion ? On l’entend tellement que cela ne veut plus rien dire, mais croyez-moi, les choses peuvent s’arranger. Accrochez-vous, forcez-vous à bouger, à sortir respirer, à faire ce que vous aimez habituellement même si cela ne vous fait pas envie, à manger régulièrement, à vous coucher à heure fixe… Extériorisez vos ressentis en écrivant, en dessinant, en dansant… Si la situation dans laquelle vous vous trouvez vous rend malheureux, élaborez un plan pour en sortir.
Et surtout, parlez-en à quelqu’un de confiance. Ne gardez pas ça pour vous, enfoui à l’intérieur jusqu’à ce que ça explose. Croyez-moi, je sais à quel point c’est difficile, je sais que c’est une chose de dire rationnellement qu’il n’y a pas de raison d’avoir honte ou peur de décevoir les gens, et que c’est tout autre chose que de prononcer des mots que vos proches n’ont pas envie d’entendre. Mais prenez votre courage à deux mains, écrivez-leur si c’est trop difficile de leur parler, lancez une bouteille à la mer. Ayant été dans les deux situations, je peux vous dire que même si c’est dur pour eux, ils préfèreront savoir pour pouvoir vous jeter une bouée, plutôt que de vous imaginer buvant la tasse seul. Et si leur soutien ne suffit plus, s’il y a trop de choses à régler que vous n’arrivez pas à démêler, cherchez de l’aide auprès d’un professionnel. C’est terrifiant, c’est douloureux, mais c’est parfois la seule solution pour aller mieux.
Et souvenez-vous que vous n’êtes pas seul. Vous avez, j’en suis sûre, quelques personnes autour de vous qui, même si elles ne vous comprennent pas toujours, vous aiment du mieux qu’elles peuvent. Et vous pouvez avoir la certitude qu’il y a au moins une autre terrienne qui est passée par là et a vu qu’après la tempête le soleil revenait.
Quelques-uns de mes poèmes sur ce thème :
Angoisse
Comment te dire
Au fil de mes erreurs
Voici venir le soir
Nœud marin
Corridors of life
Le temps qui fuit
Ne t'en fais pas
Le soleil sur ma peau