 À propos du Journal berlinois (1973-1974) de Max Frisch et des Polonaises de Jacques Pilet. Comment j’ai failli foutre le feu à la forêt de la Désirade, avant de “circonscrire le sinistre” avec l’aide de Lady L., de prendre un bain nordique “au niveau du couple” et de découvrir L’Appartement de ma grand-mère d’Arnon Goldfinger...
À propos du Journal berlinois (1973-1974) de Max Frisch et des Polonaises de Jacques Pilet. Comment j’ai failli foutre le feu à la forêt de la Désirade, avant de “circonscrire le sinistre” avec l’aide de Lady L., de prendre un bain nordique “au niveau du couple” et de découvrir L’Appartement de ma grand-mère d’Arnon Goldfinger...
Le panopticon est ce lieu fictif d'où je poursuis sans discontinuer mes lectures du monde, dont j'emprunte le terme à ce poste d'observation qui permet au surveillant-chef, dans une prison, de voir tout son monde sans bouger. Le lecteur-chef que je ne suis guère (un tribunal militaire m’ayant d’ailleurs condamné pour refus de grader...), se sent plutôt veilleur que surveillant, et jamais, de ma vie, je n'ai eu la sensation physique d'être dans une prison , sauf en rêve dans le cauchemar classique de la cage de fer ou du boyau souterrain.
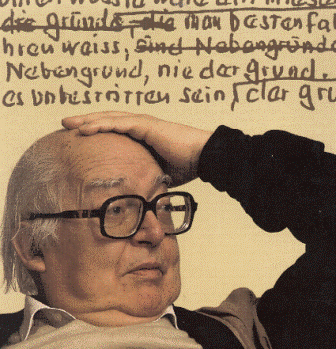
Dans son célèbre discours prononcé à Berne en présence de son collègue dramaturge Vaclav Havel devenu chef d'Etat, Friedrich Durrenmatt compare la Suisse à une prison sans barreaux dont les détenus feraient eux-mêmes office de gardiens. La métaphore est énorme et naturellement exagérée, mais elle dit quelque chose de vrai sur un pays dont les habitants des siècles passés furent souvent contraints à l’émigration, ce que leurs descendants ont tendance à oublier en se repliant sur eux-mêmes dans la crainte d'avoir à partager leur coin de paradis présumé ou leur cellule capitonnée de protégés privilégiés du Seigneur.

Dürrenmatt est cité dans le Journal que Max Frisch tint à Berlin au début des années 70 (1973-1974) comme exemple de l'écrivain totalement investi dans son travail alors que lui-même se sent “sans projet” et doute beaucoup de ses écrits du moment. À 62 ans, Frisch est pourtant connu dans le monde entier, ses livres "anciens" se vendent à des centaines de milliers d'exemplaires, et s'il a fui Zurich c'est qu'il en a assez d'être reconnu à tous les coins de rue; mais ça ne s'arrange pas à Berlin où le pharmacien et le banquier, le marchand de lampes ou l'apprenti tapissier ont tous lu l'un ou l'autre de ses livres, ce qui lui fait naturellement plaisir ("Je suis heureux de voir où vont mes livres") même s'il remarque que, peut-être, la non-reconnaissance le stimulerait plus que cette gloire qu'il n'est pas sûr de mériter; et le voici constater que le vol de sa machine à écrire lui serait plus dommageable que celui de sa Jaguar à 38.000 francs...
À Berlin, Frisch pense assez peu à son pays, mais ses observations sont d'une espèce d'honnêteté méticuleuse qu'on pourrait dire typiquement suisse, et la préparation de son fameux Livret de service l'y ramène, entre un aller-retour nécessité par la remise d'un prix littéraire et la réponse hautaine d'un conseiller fédéral a une lettre ouverte d'écrivains critiquant la politique d'asile de la Confédération, sur fond de polémique où lui-même est qualifié d'écrivain-devenu-riche et même propriétaire d’une “villa au Tessin”...

Les pages les plus étonnantes du Journal de Frisch ne sont pas celles où il parle des grandes questions politiques du moment mais plutôt celles qui touchent à sa perception de la réalité quotidienne, du sort des jeunes Allemands de Berlin-Est (qui croient à l’époque qu'ils n'en sortiront jamais) à la façon de vivre avec ses nouveaux meubles ou avec ses amis. À ce propos , l'épisode lié à la fin de son amitié avec Alfred Andersch, autre écrivain célèbre qui habite dans le même village tessinois que lui, est à la fois savoureux et indicatif d'une situation à éviter. Deux grands littérateurs risquant de se croiser tous les matins à la boulangerie ou à la poste de Berzona ? Aber nein !
On le sait aussi: le Journal de Frisch, même dans ses pages intimes, n'a rien du "cher Journal" des diaristes plus ou moins innocents ou candides: c'est un objet littéraire très construit, jusque dans ses ellipses parfois plus éloquentes qu'un long déballage . Exemple:"Parfois je m'étonne à l'idée d'avoir bientôt 62 ans. Aucune sensation corporelle. Je ne sens pas que d'ici quelques années ce sera la fin. Comme lorsqu'on jette un coup d'œil à sa montre: il est déjà si tard ?"
Il n'est pas encore "si tard”, en revanche pour le narrateur de Polonaises, premier roman de Jacques Pilet, journaliste de renom et (ex) patron de presse qui a choisi la fiction pour évoquer un pays qu’il connaît bien et dont il a commenté l'inquiétante évolution dans ses récents éditos de L'Hebdo.
Or le type en question, conseiller juridique dans une banque zurichoise, entre deux âges et divorcé d'une Juive américaine, possible lecteur de Frisch comme Pilet doit l'être à coup sûr, offre immédiatement à l'auteur une liberté de regard, de sensation et de sentiment, d'intime présence et de curiosité flottante dont le journaliste, si brillant fût-il, ne dispose jamais.
Sans faire de littérature au sens affecté de l'expression, Jacques Pilet parvient cependant rapidement à concevoir un espace romanesque crédible et intéressant, avec des personnages finement dessinés et des points de vue différenciés sur le monde actuel, ou plus précisément sur la Pologne d'après la chute du rideau de fer, sans que l'aperçu tourne au reportage ou à l'exposé politique.
Cela étant, passant d'Ischia (un salamalec à la mémoire de Visconti dont vous voyez la villa sur la hauteur) au Monte Cassino, ou l'emmène la Polonaise Karola dont il partagera la couche le temps d'une première nuit point trop romantique, le narrateur découvre la réalité historique de la participation des Polonais de l'armée Anders à la libération de l’Italie aux cotés des Alliés, qui impose un brin d'explication à l’auteur. Dans la foulée, celui-ci distille les notations comme les touches d'un tableau à la fois clair et vivant, phrases courtes et séquences bien distribuées dans le temps des personnages.
Je suis allé en Pologne une première fois en 1966, et mes souvenirs de tel cabaret souterrain de Cracovie, de la fantomatique usine à tuer d'Auschwitz ou d'un stade rassemblant la jeunesse socialiste pour manifester contre la guerre au Vietnam, me restent en noir et blanc, mais illico j'avais remarqué le ton résolu des jeunes filles dans leur réclamation de plus de liberté.

Quand j'y suis retourné en 1984, pour une grande exposition consacrée au peintre Joseph Czapski (ancien officier de l'armée Anders, soit dit en passant) des couleurs plus clinquantes avaient fait leur apparition avec les boutiques de Cardin et les espérances liées à l'après-communisme. Or je retrouve, dans le roman (dont je n'ai lu jusque-là que les deux premiers chapitres) de Jacques Pilet, les traces de ce noir et blanc autant que les couleurs plus ou moins criardes de la nouvelle société polonaise dont j’ai effleuré la réalité plus récente au printemps dernier pour l’inauguration du musée Czapski de Cracovie.

J'en étais là de mes notes sur les deux livres de Max Frisch et Jacques Pilet quand j'ai vu de la fumée s'élever d'un tas de feuilles mortes jouxtant la terrasse de la Désirade, sous les premiers arbres de la forêt.
"Le con !" me suis-je alors exclamé en me rappelant que je venais de balancer là-bas un plein seau de cendres encore tièdes de la cheminée, et me voici sauter sur un des trois extincteurs de la maison après avoir constaté que le tuyau d'arrosage récemment acquis pour le remplissage de notre nouveau bain nordique était trop court, et Lady L. de rappliquer en boitant sur sa jambe à peine remise de sa fracture, et les putains de flammes de s'élever du tas, et moi de courir au deuxième extincteur après avoir vidé le premier sans "circonscrire le sinistre", selon l'expression consacrée par les journaux, et l'eau sous pression du second extincteur de nous donner un peu de répit sans empêcher le fond du brasier de progresser, et ma bonne amie de trouver l'embout du tuyau d'arrosage permettant un jet à distance - ouf le louf ça finira par finir, et ça finit en effet, et nous aurons, au niveau du couple, fait œuvre pompière en moins de quinze minutes, évitant un feu de forêt qui se serait communiqué bientôt au chalet isolé sur sa hauteur, cramant 20.000 livres et une centaine de tableaux, mes 266 précieux carnets aquarelles en voie de transfert aux Archives littéraires de Berne, sans compter les innocentes bêtes de la forêt, etc.

Combien de lignes Max Frisch aurait il consacré à cet incident domestique virtuellement fauteur de désastre environnemental ? Je me le suis demandé après avoir retrouvé mon souffle - nous avons provoqué un feu de forêt en notre adolescence de sauvageons, dans notre quartier des hauts de Lausanne, et une vieille angoisse a ressurgi de ce souvenir avec son stress d'enfer - et l'eau chaude de notre bain nordique, trois heures plus tard, nous a fait oublier cette terreur momentanée.
Enfin le soir, autre partage au niveau du couple: Lady L. a attiré mon attention sur un docu israélien qu'elle était en train de visionner sur son laptop, et que j'ai regardé à mon tour en me connectant au site de la télé romande affichant "plus qu'un jour en ligne"...

Et c'était reparti pour un nouvel épisode d’un Travail de Mémoire me ramenant au Berlin de Max Frisch et à la guerre mondiale évoquée par Jacques Pilet dans Polonaises, à suivre l'enquête têtue d'Arnon Goldfinger, dans L'appartement de ma grand-mère, sur l'incompréhensible amitié liant le couple de ses grands-parents juifs allemands à un autre couple dont le conjoint, le baron Leopoold von Mildenstein, fut l'un des pontes du ministère de l'intérieur nazi , aux ordres de Goebbels et supérieur d'un certain Eichmann, recyclé après la guerre à la direction de la firme Coca-Cola et resté en relations cordiales avec les aïeux du jeune Israélien...
À préciser alors qu’en leurs belles années d’avant-guerre, les deux couples avaient voyagé ensemble en Palestine où le baron journaliste et pro-sioniste avait vu la terre d’accueil idéale de ces Juifs si encombrants en Allemagne...

Le Journal berlinois de Max Frisch relate les divers aléas de l’amitié de l'écrivain avec Günter Grass, suréminente figure de l'intelligentsia allemande, voire européenne, dont on se rappelle la soudaine disgrâce médiatique liée à son passé de jeune soldat de la Wehrmacht, exhumé de façon aussi peu glorieuse que lui-même l'avait caché.
Mais à la fin qui sommes-nous pour en juger ? C'est la question qui se pose à la fin du très troublant documentaire d'Arnon Goldfinger, quand celui-ci produit, à la fille du baron von Mildenstein, les documents prouvant que son père fut bel et bien une éminence grise du pouvoir nazi, à la fois impliqué dans la solution finale et pro-sioniste, blanchi et recyclé dans la nouvelle société qui nous a vu naître, etc.
