Marie-Hélène Lafon, Nos vies, Buchet-Chastel, 2017, p. 92.
Oui, un beau hasard, comme une autre luciole, que cette fête envisagée il y aurait presque cinquante ans exactement, en cette année 1967 que je sonde chaque dimanche, et ce conditionnel qui passe à l'imparfait dans la même phrase c'est l'imaginaire qui se charge de réel, le mélange de la fiction et de la réalité, le roman qui n'en est pas tout à fait un, car l'auteure l'a vraiment rencontrée - elle nous a raconté ça l'autre soir à Arcanes - cette caissière au corps inouï du Franprix parisien.
Et luciole encore, la mention du 11 septembre 2001 dans les deux livres, Nos vies et Une colère noire. Et certes l'événement, dans sa sidérante survenue, a nourri bien des pages en ce début de XXIe siècle, mais quinze ans ont passé, et cette rencontre n'a plus grand chose d'anodin. Chez MHL, cela coïncide avec la mort de la mère de la narratrice : "Je n'ai pas soigné ma mère, elle disait je partirai comme un coup de fusil et elle avait raison." Stop. Arrêt sur image. Juste avant de me plonger dans la rédaction de ce billet, je regardais La grande librairie, l'émission sur la 5 de François Busnel. Parmi les invités, il y avait Alexandre Jardin (dont je dois avouer n'avoir jamais lu un seul livre), qui publie "Ma mère avait raison."
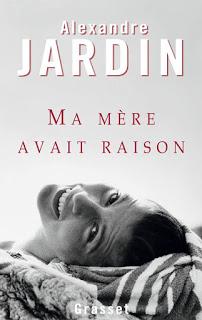
Fortuit, vraiment ? Pourtant lisez le laïus de présentation sur le site de Grasset, qui n'en finit pas de résonner avec ma propre entrée en matière sur le mixte indissociable du réel et de l'imaginaire :
"Ce roman vrai est la pierre d’angle de la grande saga des Jardin. Après le portrait du père merveilleux (Le Zubial), du sombre grand-père (Des gens très bien), du clan bizarre et fantasque (Le roman des Jardin), voici l’histoire de la mère d’Alexandre. On y découvre une femme hors norme, qui ose tout, et qui s’impose comme l’antidote absolu de notre siècle timoré.
Elle est dans les yeux de son fils l’héroïne-née, la tisseuse d’aventures, l’inspiratrice des hommes, la source jaillissante de mille questions – elle est le roman-même.Mais continuons :
Un roman qui questionne, affole, vivifie et rejoint la joie du fils. Mais la magicienne, hélas, n’est pas éternelle.
Certaines femmes, pourtant, ne devraient jamais mourir." [C'est moi qui souligne]
"Mon père l'a trouvée, il revenait du jardin [cela s'imposait, non ?] avec les derniers haricots, vraiment les derniers, juste une poignée à mettre en salade pour le soir pour eux deux, pas un de plus, au téléphone il m'avait donné des détails sur ces haricots de septembre ; elle avait l'air de dormir, la tête penchée sur le côté, les médecins ont parlé d'une rupture d'anévrisme ; c'était l'après-midi du 11 septembre 2001, à quatorze heures trente, mon père se souvenait que la demie avait sonné au carillon, dans le couloir, juste comme il entrait dans la cuisine ; elle n'a pas su pour l'attentat, les tours, les trois mille deux cents quatorze morts, elle n'a pas vu les images des gens qui se jetaient du cent-vingt-deuxième étage, elle en aurait parlé pendant des jours, elle s'était toujours intéressée à l'actualité, aux informations, elle aurait prié pour tous ces morts d'Amérique, elle les aurait appelés comme ça, les morts d'Amérique." (pp. 56-57)Les morts d'Amérique, on les croise donc aussi page 119 du livre de Ta-Nehisi Coates. C'est l'un des passages les plus forts d'Une colère noire.
"Nous sommes arrivés deux mois avant le 11 septembre 2001. Je suppose que les gens qui étaient à New York ce jour-là ont une histoire à raconter. Voici la mienne : le soir même, j'étais sur le toit d'un immeuble en compagnie de ta mère, de ta tante Chana et de son petit ami, Jamal. Nous discutions en observant les impressionnantes traînées de fumée qui recouvraient l'île de Manhattan. Chacun connaissait quelqu'un qui connaissait une personne disparue. Mais en regardant les ruines de l'Amérique, je suis resté froid. J'avais mes propres désastres à affronter. Le policier qui avait tué Prince Jones, comme tous les policiers qui nous considèrent avec tant de méfiance, était l'épée de la citoyenneté américaine. Jamais je ne considérerai le moindre citoyen américain comme quelqu'un de pur. La ville et moi, nous étions désynchronisés. Je ne pouvais m'empêcher de penser que toute la partie sud de Manhattan avait toujours été Ground Zéro pour nous. C'est là qu'ils vendaient nos corps aux enchères, dans ce quartier soudain dévasté qu'on appelait à juste titre, le quartier de la finance. Il y avait même eu une fosse commune pour les gens vendus aux enchères. On avait construit un grand magasin sur cette partie de la fosse et on avait ensuite essayé d'ériger un bâtiment gouvernemental sur une autre partie. Seule une communauté de personnes noires de bon sens avait empêché cette construction. Je n'avais pas formé de théorie cohérente à partir de tout ça. Mais je savais que Ben Laden n'était pas le premier à faire régner la terreur dans cette partie de la ville. Je ne l'ai jamais oublié. Ne l'oublie pas non plus. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai observé les ridicules défilés de drapeaux, le machisme des pompiers, les slogans pleins de colère. Qu'ils aillent tous au diable. Prince Jones était mort. Qu'ils aillent en enfer, ceux qui nous demandent d'être de bons petits soldats et nous tirent dessus quand même. Qu'elle aille en enfer, la peur ancestrale qui soumet les parents noirs à la terreur. Et qu'ils aillent en enfer, ceux qui pulvérisent le vaisseau sacré."* Le 8 octobre, j'ai revu le Blade Runner de Ridley Scott. En entendant le monologue final de Rutger Hauer, je ne pouvais pas ne pas penser aux lignes qui précèdent.
"Quelle expérience que de vivre dans la peur. Voilà ce que c'est que d'être un esclave."
Vingt-cinq ans après, l'acteur est revenu avec humour sur cette fin, dont il avait lui-même inventé une partie du monologue (et choisi d'ignorer une grande partie aussi de ce qui avait été initialement prévu).

