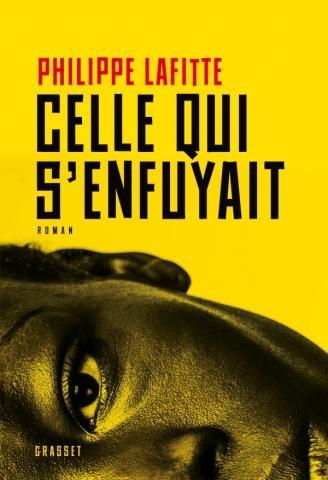Superbe portrait en mouvement d’une femme en quête de liberté, Celle qui s’enfuyait enjambe les décennies à grandes foulées, entre les années 70 des révoltes noires et notre époque, au fin fond du Larzac. Avec la tension d’un thriller: le roman d’un auteur à «papatte» en vive expansion...
On entre en courant au fil des lignes du dernier roman de Philippe Lafitte, dans la foulée d’une grande Black sexa dont la silhouette est plutôt d’une jeune gazelle; tout de suite on est pris par le récit, l’intense plasticité du décor (on est quelque part sur les causses du Larzac) et la sensation physique galopante communiquée à la lectrice et au lecteur dans l'aube nocturne jusqu’au moment où, crac, la toile matinale se déchire sur un coup de feu marquant la mort par balle du labrador Douze qui courait avec la joggeuse; et là, tant la lectrice que le lecteur, amis des chiens comme il se doit, pilent et s’indignent, et s’inquiètent et réclament une tête: non mais quel salopard a-t-il pu flinguer ce beau chien alors que la journée s’annonçait si belle loin des méchants, et c’est parti pour le chapitre suivant…
Traversé par une sourde angoisse, à la fois réaliste et d’un lyrisme épique rappelant certains romanciers américains (de Steinbeck à Cormac MacCarthy, en certes moins puissant), parfois saisissant par l’intensité de certaines séquences (le cadrage et le montage cinématographique faisant partie de l’écriture de Lafitte), Celle qui s’enfuyaitretrace une trajectoire existentielle qui marque à la fois la résilience de celle qui se reconstruit...
En quelques mots, sans déflorer une intrigue à découvrir, le roman détaille les péripéties d’une vendetta à l’italienne commanditée par la mère despotique d’une jeune étudiante, fille d’émigrants italiens enrichis, morte dans la confusion d’une embrouille terroriste à laquelle a participé la protagoniste du roman, désignée comme coupable que devrait abattre, quarante ans plus tard (!) le fils falot de la «padrina», lequel imbécile commence par flinguer le chien - à notre grand déplaisir…
Un auteur original lié à un certain nouveau réalisme littéraire français
Philippe Lafitte n’a rien encore, et c’est tant mieux, d’une star du roman français. Rien chez lui de la morgue récurrente des auteurs choyés par le sérail médiatique parisien. Rien non plus du faiseur à la traîne de la dernière mode, même s’il est bien campé dans son époque et ses pratiques de langage. Un clic et vous le retrouvez ainsi sur Facebook, un autre clic et par Amazon vous pouvez commander ses romans précédents, à commencer par les derniers, fort différents l’un de l’autre : Vies d’Andy (Le Serpent à plumes, 2010) où le mythique Andy Warhol revivait dans une forme transformiste, si l’on ose dire, à la fois paradoxale et révélatrice, et Belleville Shangai Express (Grasset, 2015) où l’auteur se fondait dans la communauté chinoise de Ménilmontant pour en tirer une love story à sa façon.
De la génération de quinquas tels Michel Houellebecq (il est de cinq ans son cadet) ou de Maylis de Kérangal, de Francois Bégaudeau ou d’Arno Bertina (un peu plus jeunes), Philippe Lafitte pratique, comme ceux-là, une espèce de nouveau réalisme attaché à l’observation fine des phénomènes sociaux de notre époque, avec un penchant particulier, chez lui, à moduler sa narration sur le rythme du thriller.




Entretien avec Philippe Lafitte
(À Paris, dans le patio de La Perle, rue des Canettes, le 15 mars).
- Quel a été le point de départ de ce nouveau roman ?
- Mes romans, contrairement à l’élaboration d’un scénario à thème unique, se constituent à partir d’éléments épars liés à des thèmes qui m’intéressent. En l’occurrence, un premier déclencheur a été la résurgence de la lecture, qui m’a durablement marqué, de L’Eloge de la fuite d’Henri Laborit, traitant d’un thème qui m’obsède depuis des années: comment échapper au déterminisme social, politique ou idéologique ? Laborit propose la fuite par l’art et la création, selon lui la meilleure façon de se «sentir bien», et j'abonde. En outre, en contraste avec mon roman précédent impliquant de nombreux personnages, j’éprouvais le besoin de me concentrer sur une seule figure de femme. À quoi s’ajoutait une composante plus anecdotique, liée à ma pratique du jogging et à la rencontre, régulière, le matin, d’une femme noire qui courait elle aussi et ne répondait jamais à mon salut. De surcroît, je me suis rappelé un fait divers des années 70, après l’enlèvement de Patricia Hearst, fille du magnat de la presse, par un groupe révolutionnaire délirant qui était devenue complice de ses ravisseurs sous l’effet du syndrome de Stockholm. L’affaire m’avait fasciné du fait qu’une jeune femme issue d’une famille richissime se retourne contre sa classe, mais je ne voulais pas pour autant faire une exofiction, pas plus que je ne me sentais armé pour brosser une fresque historique d’époque. Cela étant, je me suis beaucoup documenté sur ces années, et l’idée dominante qui s’est dégagée achoppait au décalage, dans un groupe révolutionnaire, entre l’idéologie, les beaux discours et la réalité, où l’on invoque l’égalité en même temps que s’impose un leader à tendance dictatoriale.
- Comment travaillez-vous ? Établissez-vous des plans de «campagne» ?
- À partir des premières intuitions que j’ai évoquées, je prends beaucoup de notes. Pas tant pour planifier à l’avance que pour dégager ce que j’appelle des hypothèses, qui peuvent d’ailleurs se modifier en cours de route. Ensuite vient l’écriture, et plus on écrit plus tout se modifie…
- D’où vous est venue l’idée de confronter les deux communautés, afro et italo-américaine ?
- J’ai été très marqué par le cinéma américain des années 70, et notamment par Taxi Driver de Martin Scorsese, où le thème des affrontements communautaristes apparaît déjà. Celui-ci m’intéressait avec ses fortes tensions et sa complexité, qui se retrouvent dans le personnage de mon Afro-américaine de père haïtien, dont la francophilie explique sa fuite ultérieure en France et sa reconversion dans le polar francophone.
- Comment expliquez-vous que votre protagoniste se sente encore menacée quarante ans après les faits ?
- En me documentant sur la période des luttes pour les droits civiques et sur les séquelles policières ou judiciaires des actes de terrorisme, j’ai constaté que des poursuites et des condamnations ont été opérées, par le FBI, jusqu’au-delà des années 2000-2010. Il est donc vraisemblable que Phyllis éprouve encore de l’angoisse, accentuée par son propre sentiment de culpabilité. Quant à la détermination vengeresse de la «padrina», elle s’inscrit dans la logique culturelle de la vendetta. En tant que scénariste, je suis soucieux de la crédibilité des histoires que je raconte, mais le roman a aussi sa «logique» et c’est dans ce sens d’ailleurs que j’aimerais travailler mon prochain livre. En fait chaque nouveau roman s’inscrit pour moi en rupture par rapport au précédent. C’est ma façon de me surprendre et, peut-être, de surprendre le lecteur...
Philippe Lafitte, Celle qui s'enfuyait. Grasset, 215p.