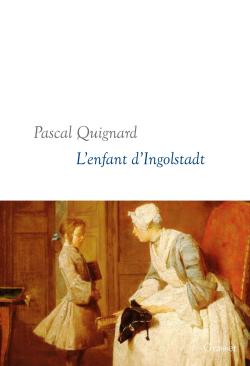CÛDAPANTHAKA (extrait)
I l y a un refrain très simple et très beau dans une chanson que composa Malherbe qui dit avec beaucoup de vigueur et de brusquerie ce que je cherche à définir ici ‒ et au fantôme de quoi il faut fournir sans fin à force d'offrandes alimentaires, de trésors monétaires, de gloire et de défi, de colliers et de brassards, de broches, d'agrafes, de parures, de perles, de dents, de larmes.
" Qui me croit absent, il a tort :
Je ne le suis point, je suis mort. "
Je me souviens qu'André du Bouchet offrit ‒ dans un état enfantin d'enchantement ‒ ces deux vers à Paul Celan, dans son petit appartement rue des Grands-Augustins, quand il les découvrit. Francis Ponge venait de faire paraître son livre sur Malherbe. J'assistai à ce don enchanté avant que Paul Celan se jette dans le fleuve.
Les larmes constituent ces libations naturelles que le corps verse sur les vides, sur les abandons, sur les sauts, sur les plongées, sur les ruines, sur les absences, sur les détresses que la langue parlée ne sait pas dire.
Une narration " dotée de sens ", voilà ce qui cherche à s'opposer à l'absence du souffle tiède d'un vivant. Une biographie. Mais la vie n'est pas une biographie. Mais être mort, c'est cesser de ternir le miroir. Tel était le geste que les Anciens faisaient pour s'assurer du décès de leurs familiers. On allait quérir un petit miroir de bronze qu'on approchait des lèvres des êtres immobiles.
Le défaut de buée ou, si l'on préfère, le reflet sans défaut, le contact sans écran de réel à réel, témoignait de la perte de la vie.
Ce petit miroir fait en bronze, frotté de laine, tout brillant, ce reflet pur c'est-à-dire vide, net de vapeur ou bien de brume lointaine ou bien de silhouette indécise sur la surface métallique et polie permettaient d'éloigner définitivement le mort dans son nom.
Alors ils l'appelaient trois fois.
Les hommes de l'Antiquité criaient très fort trois fois le nom du mort dans la chambre silencieuse où son corps avait été allongé. C'était comme une dernière danse où se soulevaient trois fois les ailes des grands oiseaux dévoreurs des chairs et porteurs des âmes dans l'ombre de l'Éther. C'étaient comme trois très lents et très grands coups de rame sur le fleuve mort qui traverse l'Érèbe. Baptême inversé comme l'était ce repas des pavements qui ne faisait rien pénétrer de solide à l'intérieur des lèvres. Dans une triste et triple clameur ils donnaient trois fois son nom à cet être pour qui ni le souffle ni le langage ni le faux ni le désir ni la faim ne faisaient plus écran à sa propre vision.
Aladin possédait une lampe qui suscitait à volonté toutes les richesses de ce monde. Le prince Hussein possédait un tapis qui transportait où l'on souhaitait être à condition qu'on se recueillît en soi-même (je note que le prince Hussein possédait presque un livre). Le prince Ahmed possédait une pomme qui guérissait tous les maux pour peu qu'on la portât à son nez ou qu'on la flairât. Le prince Ali possédait un petit tuyau fait en défense d'éléphant qui permettait de voir à distance. Sôsos possédait un non-balai qui permettait l'art.
Les moines bouddhistes de l'Inde ancienne racontaient cette légende qui courait sur Cûdapanthaka. Cûdapanthaka à l'âge de quarante-cinq ans avait atteint un tel état de perfection qu'il avait oublié son nom de génération. À cinquante-cinq ans il avait atteint un tel état de pureté que les frères lui mirent un balai entre les mains. À soixante-cinq ans Cûdapanthaka avait atteint un tel état de sainteté qu'il avait oublié le mot " balai ". Le jour anniversaire de ses soixante-quinze ans le moine Cûdapanthaka se souvint subitement du mot " balai " mais, comme les frères l'interrogeaient, ils découvrirent qu'il avait oublié le sens du verbe " balayer ". À quatre-vingts ans, quand il se souvint du verbe " balayer ", il y consacra tout son temps mais le mot " balai " s'enfuit de sa mémoire et tout à coup sa bouche fut quitte du langage. À quatre-vingt-cinq ans Cûdapanthaka était devenu si bienheureux qu'il ne se souvenait de rien. Mais alors il se trouva que ses mains étaient prises d'une sorte de petit tremblotement qui ne cessait pas. Aussi, balayant la cour du temple, levait-il plus de poussière qu'il n'en ôtait et les frères se plaignaient.
Pascal Quignard, L'Enfant d'Ingolstadt, chapitre XXIV (extrait), Dernier royaume X, Éditions Grasset & Fasquelle, 2018, pp. 165-166-167-168.