Éphéméride culturelle à rebours
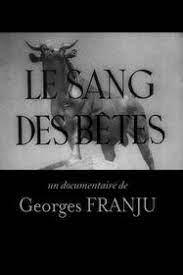
5 novembre 1987 | Mort de Georges Franju
Le 5 novembre 1897 meurt à Paris le réalisateur français Georges Franju. Né à Fougères en Ille-et-Vilaine le 12 avril 1912, Georges Franju est avec Henri Langlois le fondateur de la Cinémathèque française (1935). À l’automne 1945 sort sur les écrans Le Sang des bêtes, court-métrage qui assurera la notoriété du réalisateur et décidera de sa carrière. Suivront ensuite d’autres courts-métrages. Notamment En passant par la Lorraine (1950), Le Grand Méliès (1952). Parmi les longs métrages réalisés par Georges Franju figurent la Tête contre les murs (1958), Les yeux sans visage (1960), Thérèse Desqueyroux (1962), Judex (1963), Thomas l’imposteur (1965), La Faute de l’abbé Mouret (1970).
Je dois à Muriel Pic de raviver en moi l’intérêt qu’avait suscité, jadis, le court-métrage de Georges Franju -Le Sang des bêtes que je viens de revoir en streaming. Je dois ce renouveau d’intérêt à la lecture d’un récit publié en 2017, récit dont le titre est suffisamment explicite pour revisiter au travers du regard de la documentariste et vidéaste Muriel Pic, le film de Georges Franju, tourné aux abattoirs parisiens de la Villette et de Vaugirard, en 1949.
De Georges Franju, Le Sang des bêtes. Visa de censure numéro 9126. À Muriel Pic, En regardant le sang des bêtes.
« Vingt-deux minutes et sept secondes aux limites. Dehors, aux portes de Paris, l’atmosphère de novembre est douce, la lumière tassée par le gris et le poids des formations nuageuses. Une voix de femmes récite le poème de la banlieue. Dedans, une voix d’homme documente. Les séquences à la lumière électrique sont embuées par le sang fumant des bêtes. Ce doit être la Saint-Martin, entre un bref été indien et la pluie qui suinte, à la limite entre l’homme et l’animal.
Une image exemplaire de la cruauté est celle d’une main qui caresse négligemment les cheveux d’un enfant ou la fourrure d’un animal. Car la main qui flatte peut aussi détruire. Devant la caméra de Franju, les animaux me regardent. Ils me regardent avec cette insistance muette, sans concept, qui me fait penser, parler, réfléchir à mon humanité.
La situation géographique au milieu des terrains vagues me permettait de faire, non pas un document, mais un documentaire, un film. C’est le contrepoint lyrique qui m’amené à faire Le Sang des bêtes.
Autre décor, autre film. Pourtant, les images surgissent du court-métrage de Franju. C’est la même histoire de limites, d’irregardable, de banlieue, de poésie enfantine. C’est le même détour par l’enfance pour aller vers la mort ou l’inverse : un détour par la mort pour aller vers l’enfance. La maison était aux abords d’une petite ville pas très loin de Lyon. Il y avait toujours beaucoup de mouches dans cette maison. Je les suivais du regard derrière la transparence des vitres et je les attrapais en faisant glisser très vite ma main sur la surface. C’était plus facile les jours de soleil car elles somnolaient dans la chaleur. Une fois, je me souviens bien, j’ai fermé mon poing sur une dizaine de mouches que je transférais dans l’autre main après la capture. Je voulais un trésor de mouches. Un trésor d’ailes et de corps noirs, un trésor de diable. J’ouvrais la main pour contempler mon butin qui n’était plus que jus et marmelade d’insectes écrasés. Dans cette impeccable image du dégoût, les abattoirs étaient là, de l’autre côté de la route, mais c’était comme s’ils n’existaient pas.
00’:57/22’:07’’. Des rails de chemin de fer aux portes de Paris.
Un miroir, des tableaux, un chevalet, des chaises, des trouvailles, des rebuts, des restes, des objets à bricoler, des fins de vies, des départs ailleurs, des déménagements, une imagination qui passe, s’accroche ici ou là, s’ouvre à la divagation, l’errance, fragments d’histoires, un bric-à-brac de vies, un échantillon du monde, une brocante d’existences, un décor misérable, attachant, un décor de chiffonniers, de déchets, de vermines, d’usagés, d’entassements, d’objets désancrés du quotidien, en attente d’une nouvelle main, témoins de gestes passés dont ils portent la fêlure, la rayure, l’ineffacé. A la périphérie de la ville, un lieu où viennent les pauvres gens. Franju ne se préoccupera que des choses humbles, des objets et des créatures qui ne retiennent pas l’attention. Tout ce qui, délaissé par la société, en constitue le reflet involontaire. Il ne se préoccupera que de ces choses qui peuplent les marchés aux Puces de la société industrielle, de ces bêtes que l’on abat à la chaîne, de ces hommes qui sont chargés de les tuer. Il y a longtemps que ce sujet l’habite ; depuis longtemps, il voit, la nuit, le sang des bêtes. C’est une sorte d’idée fixe qui doit s’exprimer. Il n’a qu’à suivre ce que lui dicte son for intérieur. Franju fait un repérage aux Puces de la Porte de Vanves et dans le quartier de la Villette avec son ami le photographe Patrice Molinard. Les intérieurs, il les verra plus tard, avec la complicité d’un vétérinaire. C’est son premier film qu’il prépare.
À Alexandrie, avant même le temps de Ptolémée, on apportait, au milieu des repas et des meilleures chères, l’anatomie séchée d’un corps d’homme pour servir d’avertissement aux convives.
Une voix de femme, qui vient de recevoir et de donner un baiser, une bouche d’amoureuse commence à parler. C’est encore le marché aux Puces de la porte de Vanves, où sont éparpillés les singuliers débris de vagues richesses. Sur le terrain vague, jardin des enfants pauvres, tout un bonheur désassorti s’offre aux amateurs de brocante, poètes, et aux amoureux de passage, à la limite de la vie des camions et des trains. La voix féminine (une voix de fille plutôt enfantine, un peu navrée, mais qui ne cille pas) est celle de Françoise Ladmiral. Elle se jettera sous une rame de métro quelques années plus tard.
L’espèce humaine est la seule qui sache qu’elle va mourir. Les animaux en ont le pressentiment dans la proximité de l’instant, et non dans la durée. L’espèce humaine est la seule qui puisse penser sa mort. Mors certa, hora incerta.
Muriel Pic, En regardant Le Sang des bêtes, Suivi de Notes sur le montage documentaire, Trente-trois morceaux, 2017, pp. 9,11,12,13.

Muriel Pic, En regardant Le Sang des bêtes, Suivi de Notes sur le montage documentaire, Trente -trois morceaux, 2017, pp. 9,11,12,13.
