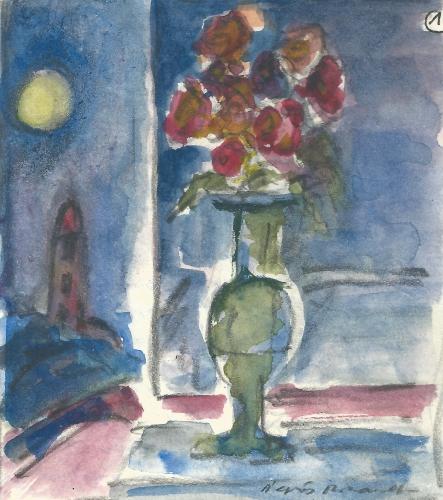
«Tout, au monde, existe pour aboutir à un livre», écrivait Mallarmé. Cela fait-il du monde un cabinet de rat des lettres ? Nullement. Car «l’écriture est un art d’oiseleur, et les mots sont en cage, avec des ouvertures sur l’infini», écrivait Charles-Albert Cingria, qui disait aussi que la meilleure critique ne fait que coudre ensemble des citations. Lui-même ne s’y tenait pas, mais l’art de la citation est en effet une composante de la bonne critique, et voici que Léon Bloy suggère une initiative non moins opportune: «On devrait fonder une chaire pour l’enseignement de la lecture entre les lignes».
°°°
Une mentalité me révulse,et c’est celle de la seiche philosophique, qui n’a rien à voir avec la seiche animale, laquelle se défend comme elle le peut et à bon droit.
Mais en quoi consiste la particularité de la seiche philosophique? La seiche philosophique a cela de particulier que, plongée dans un bac d’eau claire, elle y diffuse un jet d’encre noire avant de déclarer qu’il n’y a pas plus noir que le monde dans lequel elle, seiche de malheur, a été plongée.
Il y a la seiche du tout est moche. Lui désignez-vous une chose belle, un paysage ou un tableau, un film ou un livre, qu’elle en dénonce aussitôt le défaut.
Il y a la seiche de rien ne vaut le coup qui, arguant que tout a été fait ou que rien ne puisse plus advenir, n’a de cesse de ruiner tout projet et de dénigrer même toute idée de projet, pour mieux se complaire dans son amer bocal.
Enfin il y a la seiche du tout est foutu, dont le goût du noir touche à l’absolu, le seul fait d’être au monde lui semblant la calamité d’origine.
Or comment faire pièce à cette philosophie de la seiche? Essentiellement par un redoublement d’attention, je crois, au détail des choses. Cela seul compte en effet: le détail des choses. Ce qu’on appelle la réalité. L’origine des choses. Le Grand Récit. Les écritures multiples du grand palimpseste de la mémoire.
°°°

Le privilège d’un personnage de roman tel que Johanna Silber, et l’agrément de sa fréquentation, snobisme mis à part, tiennent autant aux facilités d’accès àdivers lieux plus ou moins mythiques - comme la couche du roi George VI (auquel Johanna cède après l’avoir baffé), la Fenice au temps de Toscanini, le Chelsea Hotel en 1940 ou le restaurant Cathy’s de Sunset Boulevard, où elle rencontra Fritz (Lang) et David (Selznick), entre autres – qu’aux multiples rêveries découlant de la vie d’une diva folle de Schubert et fondue en musique comme sainte Thérèse.
D’ailleurs la métaphore advient: «La musique vient de là, peut-être: le souvenir d’unbonheur oublié, le doux balancement du corps dans le flux maternel – cetunivers liquide et chaud où nous avons baigné hors du temps et de la mort. C’est le premier rivage et la douceur inexprimable du bord de mère. Toute la musique de Schubert est empreinte de cette nostalgie». Mais pas que la musique de Schubert, sans blague: à l’instant la voix mourante de Billie Holiday m’enveloppe de son nuage camé aux volutes d’Embraceable you, et du coup je me dis que Johanna la diva fut à peu près lacontemporaine de Lady Day, et aussi peu capable que celle-ci de vivre une vie ordinaire.

°°°
Le portrait de la petite ville norvégienne que Frode Grytten, brosse dans Les contes de Murboligen rappelleWinesburg-in-Ohio de Sherwood Anderson ou, plus encore, le Rimini de l’inoubliable Amarcord de Fellini, dont on retrouve d’ailleurs certains traits, à commencer par l’irrésistible caissière de cinéma du coin, tout à fait la dégaine d’une Gradisca des fjords.
Tissée de chapitres plus ou moins communicants (puisqu’on retrouve certains personnages de l’un à l’autre), cette évocation de la ville d’Otta commence par le portrait d’un charmant barjo fou des Smiths mais pestant de ne pouvoir se coiffer comme Morrissey (la pluie interdit d’avoir les cheveux dressés), absolument inadapté à la vie ordinaire (il s’est fait sacquer de l’administration postale pour refus de port d’uniforme) et se consacrant essentiellement, végétarien et chaste depuis l’âge de 19 ans (il en a vingt deplus) à soulager les derniers jours de sa mère en fin de course.
Quel bel et bon livre, fraternel et déjanté, plein de tendresse et de fines observations sur la vie des gens de notre drôle d’époque : voilà ce que précisément j’espérais lire en ce début d’année, dont je continue de me régaler ce matin en voyant fumer l’eau glaciale du lac aux airs de fjord. Oh, what a perfect day…
°°°
L’ami Pierre Gripari me disait qu’il ne suffit pas, pour un romancier, d’avoir quelque chose à dire, mais qu’il lui fallait quelque chose à raconter – et cela, qu’on dira The Plot, l’intrigue, se retrouve à tout coup dans les films d’Hitchcock. Les meilleurs fondent les deux éléments en une forme immédiatement singulière, dès A l’Est de Shangaï (1932) et jusqu’à Pas de printemps pour Marnie (1964). Or ce qui me frappe à (re) voir tous ces films en enfilade, de 
°°°
Je riais sous cape ce matin en me rappelant l’irrésistible histoire que raconte Alexandre Jollien, dans son Eloge de la faiblesse, évoquant son pote handicapé qui, dans le train, pour n’avoir pas à payer sa course, tire la langue au moment où le contrôleur se pointe dans son compartiment. Le drôle en question appelle ça: Opération Lézard. Or ce que je me dis ce matin, c’est que toute la philosophie de Jollien tient en ce programme de l’Opération Lézard. C’est en tirant la langue à sa poisse de naissance qu’il est devenu ce qu’il est: à savoir un clown de Dieu,un danseur à la Nietzsche, un resquilleur du SuperHandicap.
°°°
Celuiqui lit des romans de Jane Austen à sa marraine aveugle de Brisbane / Celle quimire les abricots le long de l’autoroute / Ceux qui aiment s’aimer en écoutantdu Johnny Cash dans leur Mobil home garé le long du canal des Maures, etc.
°°°
Genève, Brasserie hollandaise, ce12 janvier 2006. - «Mon père n’avait peur de rien, c’est ce qui l’a sauvé pendant la guerre, et je crois que je tiens de lui…», a-t-elle remarqué en me racontant l’Occupation qu’elle a vécue à Mulhouse tandis que ses deux frères étaient embarqués dans la Wehrmacht.
C’était hier, elle m’a accosté sur le quai de la gare de Lausanne, elle m’avait entendu une fois dans une soirée littéraire et venait de lire mon papier du jour dans 24 Heures, bref aux abris: la raseuse, me disais-je, mais plus moyen de m’en débarrasser ; nous allions tous deux à Genève et je n’avais pas le cœur de la remballer, d’autant moins que ce qu’elle a commencé de me raconter était intéressant…
Jen’en retiens que l’histoire du pharmacien Weiss. A Mulhouse, où les commerçants juifs abondaient, l’annexion de l’Alsace par les Allemands se solda, à part la germanisation à outrance des écoles, par l’humiliation publique, la spoliation de leurs biens et la déportation ultérieure des Juifs, dont Marguerite B. a retenu cette scène: les agents de la Gestapo traînant le pharmacien Weiss devant sa boutique, l’obligeant à s’agenouiller et le contraignant, devant une foule croissante et muette, à brouter l’herbe du pavé qu’il y avait là.
Bref, cette scène m’a rappelé la chèvre d’Umberto Saba, et c’est avec reconnaissance que j’ai quitté Marguerite B. sur le quai de la gare de Genève, hier, dans la lumière voilée de cette fin de matinée d’hiver…
°°°
Toujours pensé que le corps débordait ses frontières, comme un fleuve à l’orage.
°°°
L’écriture, comme la peinture, a besoin d’un fond. Ensuite on brasse la matière et tout à coup se dégage une forme. Pas du tout d’opposition, par conséquent, entre cequ’on appelle fond et forme.
°°°
Je me dis ce matin que Dieu doit se sentir aussi seul que moi, avant les premiers chants d’oiseaux. Le monde est si froid avant les premiers chants d’oiseaux.
°°°
Ce que nous savons du rabbi juif Iéshoua est peu de chose. Une biographie tenant en moins d’une page, disait Bultman.Quelques paroles qu’on suppose avérées, et c’est à peu près tout. A part quoi le portrait du personnage, son message, ses actes et ses enseignements reposent à peu près entièrement sur des témoignages de seconde main, contradictoires sur des points fondamentaux. L’ensemble des écrits du Nouveau Testament comporte 360.000 variantes. Et pourtant l’exégète juif André Chouraqui le disait bien : il y a là-dedans une voix unique…
°°°

°°°
Il y a des années que j’en veux férocement, à toute une caste d’intellectuels helvétiques sans entrailles, d’entretenir le cliché d’un pays mortifère, réduit à ses banques et à ses névroses, aussi est-ce avec un plaisir d’enfant que j’airetrouvé, dans le tourbillon farceur deMy name ist Eugen du jeune réalisateur Michael Steiner, qui vient d’obtenir le Prix du meilleur film de fiction aux Journées cinématographiquesde Soleure, ce que je ressens au fond de moi comme un atavisme sauvage et qui participe de l’esprit du conte.
C’est une belle petite ville que Soleure où il fait bon, dans les vieux bistrots de bois ciré fleurant l’Europe cultivée autant que la bohème artiste et le populo à cigares, discuter des derniers films de la cinématographie helvétique qu’on y projette à journée faite dans de multiples salles.
La Suisse est ce pays d’extrême-Europe, au fonds populaire terrien, aristocratiquement démocrate, à peu près méconnu par les temps qui courent, surtout en France, réduite qu’elle se trouve aux clichés du banquier à face blême, ou pire: du fonctionnaire chiant, ou pire encore: de l’intellectuel responsable convaincu que l’art et le commerce sont incompatibles. Ce fut le débat tournant à vide lancé par les médias à ces 41es Journées de Soleure, constituant les Etats généraux annuels du cinéma suisse, mais il a suffi de quatre chenapans fuguant à travers les monts de Heidi et les vaux de Guillaume Tell, dans la foulée de Bakounine et de Max und Moritz, sur un ton picaresque oscillant entre Mark Twain et Harry Potter, pour déplacer la discussion sur le terrain d’un cinéma renouant, contre toute attente, avec l’esprit du conte. Les héros de ce film sont des Lausbuebe, et ce seul nom, dont on m’a gratifié cent fois en nos séjours lucernois, ce nom de chenapan m’a rappelé bien des équipées.
Je me fiche bien, pour ma part, de ce qu’on stigmatise sous l’appellation d’helvétisme, à propos d’une idéologie qui a fait date, mais j’ai toujours pensé que les clichés contenaient une part de vérité et pouvaient être revivifié. Or c’est toute une Suisse profonde de nos enfances que j’ai retrouvée dans ce film - nos enfances de plusieurs siècles, jusqu’à ces bandes d’escholiers pieds nus qui sillonnaient l’Europe de la Renaissance en quête de maîtres de latin ou d’hébreu, qui filent aujourd’hui en skateboard et s’envoient par SMS des serments de fidélité à la vie à la mort…
°°°
L’homme peut-il se considérer lui-même d’égale façon avant et après Auschwitz, avant et après Hiroshima, avant et après les révélations faites sur le Goulag ?
Ces trois moments de l’ignominie contemporaine ne sont-ils que des péripéties de l’Histoire, ni plus ni moins affreuses que d’autres calamités du passé, ou faut-il y voir la manifestation d’une mutation de l’Espèce ? Comment croire encore à la “justice divine” en un temps où le “peuple de Dieu” a fait l’objetdu plus grand génocide scientifiquement planifié et accompli avec quelle haute compétence technique, réellement sans équivalent ? Comment envisager la finalité d’une créature devenue capable de son propre anéantissement ? Enfin comment espérer discerner le Bien et le Mal dans un monde dont les valeurs réputées les plus nobles sont perverties par l’usage des mots qui les désignent ?
Ces questions sont posées, implicitement, par le non-agir de l’homme de la pire des nuits que met en scène Aleksandar Tisma dans L’Ecole d’impiété. L’homme de la pire des nuits, que Tisma désigne ainsi, dans la nouvelle éponyme, comme s’il s’agissait d’un nouveau type humain, est l’un des millions de déportés confronté, à la veille de son arrestation, qu'il sait absolument sûre et certaine, à l’alternative de la fuite ou de la résignation. Pourquoi, conscient de ce qui va leur arriver àl’aube, l’homme de la pire des nuits ne réveille-t-il pas sa femme et sa fille pour se sauver avec elles ? Est-ce parce que, justement, certaine réalité faisait encore partie, avant Auschwitz, de l’impensable ? Ou bien est-ce parcequ’il est impensable de se sauver seul ?
°°°
Celui qui donne son gilet pare-balles à une jeune femme enceinte / Celle qui n’a plus même de haine en elle / Ceux qui espèrent que la guerre au Liban va relancer le tourisme en ville de Genève,etc.
°°°

Cette polyphonie douce obéit certes à ce parti pris du OUI, mais elle n’est jamais fade ni mensongère ou dogmatique, ni nombriliste non plus même si tout y est absolument personnel ou plus exactement: traversé par la personne du monde. La peinture de Bonnard n’est ni pointillliste ni tachiste, elle est tout ça et bien plus, nous lavant du NON en nous montrant simplement les choses aimées.
Le mystère est omniprésent chez Bonnard, consubstantiel à la vie même, dont les éléments ne sont jamais noyés dans la pure couleur (d’où ma réticence à l’égarddes Nymphéas de Monet et de toute l’abstraction lyrique ensuite) car le dessin reste net et l’objet, l’objet cher à Cézanne mais ici vu et dit tout autrement, avec un abandon et des effusions de père de famille très nombreuse ou d’Éternel en retraite fumant sa clope en regardant sa terre «qui est parfois si jolie», non sans se rappeler l’affreuse mélancolie des enterrements d’enfants…
Et Monsieur Bonnard d’ajouter : «J’espère que ma peinture tiendra, sanscraquelures. Je voudrais arriver devant les jeunes peintres de l’an 2000 avecdes ailes de papillon».
°°°

Et Monsieur Bonnard de noter sur son carnet, et c’était en 1939: «A l’instant oùl’on dit qu’on est heureux, on ne l’est plus».
°°°

Au demeurant, restant lui-même et farouchement, Léautaud ne m’intéresse pas moins à tout coup pour la justesse et la sincérité de tout ce qu’il note, et sa phrase seule a quelque chose de salubre et de revigorant.
°°°
Celui qui éventre le divan de sa cousine défunte à la recherche du magot de l’oncle arménien / Celle qui porte le deuil à ravir / Ceux qui estiment que le lait nuit à leur libido, etc.
°°°
Je me sens à l’âge où les âges s’empilent tout en se mêlant par osmose, ainsi ai-je toujours plus ou moins vingt ans et trente-cinq ou cinquante, parfois dix-sept, plus rarement quinze ou sept ans. Suis-je la somme de tous ces avatars ou leur juxtaposition dans autant de vases plus ou moins communicants? Je ne sais trop ce que «je» suis au total, et s’il est important de le savoir. Suis-je en outre le même aujourd’hui, aux yeux des autres (et quels autres serait une autre question) que j’étais à leurs yeux il y a dix ou vingt ans? Ce dont je suis sûr, c’est que mes douleurs veineuses, ce matin, me font mal et que ce n’est pas «un autre» qui les endure.
°°°

°°°
«C’est un grand art, écrivait Léon Chestov à ses filles, un art difficile, que de savoir se garder de l’exclusivisme vers lequel nous sommes inconsciemment entraînés par notre langage et même par notre pensée éduquée par le langage. C’est pourquoi on ne peut se limiter à un seul écrivain. Il faut toujours garder les yeux ouverts. Il y a la mort et ses horreurs. Il y a la vie et ses beautés. Souvenez-vous de ce que nous avons vu à Athènes, souvenez-vous de la Méditerranée, de ce que nous avons vu lors de nos excursions en montagne, ouencore au musée du Louvre. La beauté est aussi une source de révélation ».
°°°

Ce chef-d’œuvre méconnu s’intitule Vivre (Ikiru) et constitue le pendant de La mort d’Ivan Illitch de Léon Tolstoï. C’est l’éternelle histoire du soudain éveil de la conscience: tu te figurais, femme de peu, homme de rien, être immortel et, tout coup, tu te trouves face à ce mur, devant ce toubib froid qui t’annonce que tu n’as plus que six mois ou six semaines à vivre. Et comment les vivre nom de Dieu?
°°°
Au Cap d’Agde, en mai. - On était ce matin comme hors saison en ce bord de mer où tous les gris des dunes et du ciel se mêlaient dans une sorte de brume spectrale se déchirant de temps à autre sur des pans de bleu ou de jaune, comme d’une toile en trompe-l’œil ; on se serait cru du côté d’Ostende et non en bord de Méditerranée au seuil de l’été, et la longue perspective des dunes aux crêtes d’herbes sauvages, jusqu’aux lointains indistincts de la colline tachetée de minuscules carrés blancs de Sète, avait quelque chose d’un peu lunaireavec ses silhouettes de promeneurs emmitouflés, rappelant je ne sais quelle toile de Spillaert...
°°°
On voit toujours d’extraordinaires châteaux de sable le long des plages, et c’est le meilleur signe à mes yeux de la survivance de cette disposition créatrice qui caractérise la première enfance et la vocation d’artiste. N’est-ce pas un privilège absolu que de pouvoir faire quelque chose d’un tas de sable ? Rien n’est plus gratuit ni plus gratifiant que de construire un beau château de sable, poème ou roman.
À suivre…
Images: gouaches de JLK, et autres aquarelles. D'après Rouault, à la Maloja et à Soglio.
